
La fenêtre ouverte (1988)
Christine Genin. La fenêtre ouverte. Parcours d’un « livre d’images » : Orion aveugle de Claude Simon. Littérales, 3. Livre et littérature : L’espace optique du livre, 1988, p. 77-100
Sur le seuil d’Orion aveugle (1), avant la préface, avant même la page de titre, le lecteur découvre un dessin de la main de Claude Simon : il y a représenté, en effet, sa propre main écrivant, sur une table portant divers objets et placée face à une fenêtre ouverte sur un paysage urbain.
A l’ouverture de ce texte un peu particulier, ce dessin vient dire ce qui ne pourrait être dit autrement pour écrire, il faut se tenir face à une fenêtre ouverte sur le monde. Sont ainsi, dès l’abord, définis à la fois la posture et la technique de l’écriture et son projet, son dessein l’écriture, en effet, ne se conçoit pas pour Claude Simon sans ce regard sur le monde qui la fonde et la perpétue.
Le cadre de la fenêtre ouverte apparaît, certes, comme l’espace et la figure privilégiés de la description tant picturale que littéraire en Occident : depuis la Renaissance, toute représentation ne peut déployer ses feintes qu’à partir de la clôture d’une surface dans laquelle, en second lieu, commence l’inscription. Dans les romans simoniens, plus que partout ailleurs, la fenêtre est au commencement du texte : en témoignent, en particulier, les incipit de La Corde raide (2) et d’Histoire (3) ; La Bataille de Pharsale (4), de même, s’ouvre et se referme sur la description d’un bureau face à une fenêtre ouverte qui annonce, à quelques détails près, le dessin initial d’Orion aveugle ; et, tout au long de chacun des romans simoniens, de multiples rideaux, fenêtres ou fentes s’ouvrent sur les scènes les plus diverses. On peut donc parler, à propos de cette figure de la fenêtre ouverte, d’image emblématique et fantasmatique de l’écriture pour Claude Simon (5). C’est à travers cette fenêtre ouverte sur son seuil que je voudrais ici parcourir ce » livre d’images » qu’est Orion aveugle.
I. De la fenêtre ouverte au livre ouvert
Cette fenêtre initiale et comme initiatique s’ouvre dans le texte d’Orion aveugle sur elle-même, c’est-à-dire sur d’autres fenêtres ouvertes sur le monde : les images entre les pages du texte les décrivant.
Dans tous les romans de Claude Simon, les images tiennent une très grande place, et donnent lieu à de multiples descriptions ; elles sont cependant le plus souvent absentes de ces textes qu’elles ont engendrés. Dans Orion aveugle, c’est là l’originalité du livre, les images sont présentes.
Orion aveugle a en effet été écrit, à la demande d’Albert Skira, pour la collection « Les Sentiers de la Création » : Claude Simon déclare avoir
« accepté de bricoler quelque chose à partir de quelques peintures qu fil) aimait » (6) ; son projet, dit-il encore, n’était nullement de se livrer à une étude théorique ou critique sur la Peinture en général ou quelques peintures en particulier, mais de faire « un livre où l’on pourrait utiliser les images pour montrer le point de départ du texte et les propriétés des images » (7), c’est-à-dire, à partir d’images considérées comme des « stimuli », écrire un texte de fiction.
Un livre dé-lié
Orion aveugle, ainsi, est un « livre d’images », et, comme tel, invite d’abord au feuilletage plus qu’à une lecture linéaire ; la vision se trouve donc être un avant coup de la lecture tout autant que de l’écriture ; le livre, d’autre part, livré ainsi aux mains qui le feuillettent et à l’oeil qui le dissémine, peut à chaque instant se défaire, se dé-lier. De même que, dans le dessin initial, l’image est posée sur et hors du livre, les images s’échappent du livre, en font voler les pages au gré du regard devenu scalpel.
En feuilletant ce livre, le regard saisit donc, en plus du texte, une série d’illustrations que l’on peut répartir en deux catégories. Différents frontispices successifs, d’abord, qui ne cessent, sur une dizaine de pages, de présenter et d’annoncer le livre tout en en différant sans cesse la lecture : la couverture, d’abord, qui porte le tableau éponyme de Nicolas Poussin, Paysage avec Orion aveugle, ainsi que le nom de l’auteur et le titre en caractères d’imprimerie ; immédiatement après, on trouve le dessin de Simon représentant sa main écrivant devant la fenêtre ouverte, qui va, en quelque sorte, rendre possible tout à la fois l’écriture, le texte qui va suivre, et l’afflux massif – par la fenêtre ici ouverte – des images ainsi convoquées ; suit un fac-similé de texte manuscrit – se donnant ainsi implicitement comme ce que la main, à la page précédente, écrivait – qui fait office de préface au livre ; puis, et seulement alors, on trouve la page de titre, réplique déjà fortement modifiée de la couverture ; l’illustration qui y figure est cette fois un détail du Charlene de Robert Rauschenberg (au cadrage plus précis que celui qui figurera plus loin, p. 49, dans le texte) et elle est reproduite en noir et blanc (p. 49 le détail en couleur) ; cette couverture intérieure semble donc insister sur le rôle déterminant et générateur de Charlene dans le texte qui va suivre ; et cela d’autant plus que, sur la page de titre, le titre et le nom de l’auteur ne sont plus inscrits en caractères d’imprimerie mais manuscrits, comme pour prolonger dessin et préface, tout en signalant le caractère intime de cette couverture intérieure.
Le texte ensuite peut commencer, qui cependant est lui-même découpé par une série d’images inserrées entre ses pages : dix-neuf illustrations de natures assez diverses figurent, outre le dessin initial et les deux couvertures, dans le texte d’Orion aveugle : quelques reproductions de tableaux (le tableau de Poussin, une eau-forte de Picasso (n° 308), et Caballero de Jean Dubuffet), des photographies de divers montages en trois dimensions (de Robert Rauschenberg, Charlene et Canyon, Fernandez Arman, George Brecht et Louise Nevelson), des photographies, considérées ou non comme artistiques (de l’Amazone, d’un téléphone mural, et deux photomontages de Brassai et Andy Warhol), ainsi que divers dessins et gravures (plusieurs planches anatomiques, un Zodiaque, une couverture du Petit Journal, etc).
Générateurs
Dans la mesure où ce texte, inchangé, sera repris par Claude Simon au début des Corps conducteurs (8), débarrassé des images inserrées entre ses pages et par là même comme allégé, capable d’un nouvel essor et de multiples déploiements, il paraît nécessaire de s’interroger sur le rôle, éminemment ambivalent, des illustrations dans Orion aveugle.
Claude Simon insiste dans tous les entretiens où il évoque ce livre sur le fait que les images n’y sont en aucun cas des « référents » qu’il s’agirait de décrire et de commenter ; les vingt illustrations d’Orion aveugle sont plutôt, pour lui, des « stimuli » ou des « générateurs » de texte : « Mon travail, déclare-t-il (9), me semble s’apparenter à ce que l bn pourrait appeler (…) l’exploration des propriétés des figures (ou si l’on préfère des images). Et par le mot ‘propriétés’, j’entends ceci : quelles autres figures (ou images) telle figure (ou image) donnée a-t-elle le pouvoir de faire surgir, d’amener à l’esprit, soit par harmoniques, contrastes, assonances, ou, au contraire, dissonances, contrastes, oppositions ? Et quelles autres images, encore, vont, à leur tour, être « convoquées « par les premières images suscitées ?.. ». Au terme de cette multiplication incessante des images par les images, il n’existe souvent plus qu’un lien extrêmement ténu entre le texte produit et le document initial ; Claude Simon a donc toutes les raisons de s’opposer à ce que l’on assimile trop rapidement le texte au produit de la description de référents picturaux : les images certes engendrent des descriptions, mais en retour les descriptions engendrent d’autres images, en une circularité parfaite.
Il faut ainsi distinguer dans Orion aveugle les images engendrées au fil du texte, c’est-à-dire introduites souvent a posteriori pour servir de pendant objectal aux images obsessionnelles charriées par le texte 10 et les images véritablement génératrices, c’est-à-dire, par exemple, le dessin initial, l’Orion de Poussin et surtout le Charlene de Rauschenberg.
Le tableau éponyme de Nicolas Poussin, Paysage avec Orion aveugle, occupe bien entendu un rôle privilégié : il sert essentiellement de corrélatif à la situation de l’écrivain qui se reconnait dans le géant errant arc (plume) en main sur les sentiers (de la création) en un voyage qui ne peut avoir d’autre terme que l’épuisement du voyageur : Orion, aveuglé par les dieux, est condamné à errer jusqu’à voir le soleil se lever (11).
Cependant, dit Claude Simon, « le point de départ n’a pas été Orion qui se présenta à moi plus tard, mais la grande construction de Robert Rauschenberg, Charlene (…) Orion aveugle est sorti de ma recherche des propriétés de Charlene » (12). Contrairement au tableau de Poussin, le montage de Rauschenberg ne donne lieu à aucune description directe : il génère moins des mots et des thèmes qu’il n’organise l’espace du texte et l’espace décrit par le texte, désignant d’une part une structure, celle du collage textuel, et, d’autre part, engendrant des schémas visuels : une forme, le rectangle, une couleur dominante, le rouge sombre.
Jalousie
Au-delà de cette analyse des mécanismes de production du texte, on peut se demander quelles sont les conséquences de la présence réelle, dans Orion aveugle, de ces images ayant, comme dans la plupart des romans de Claude Simon -, où, pourtant, elles sont ensuite absentes du texte, comme gommées, éclipsées par ce texte – servi de point de départ et de stimuli. Ces images, en effet, semblent constituer, pour le texte, une gêne, et c’est tout à fait symptomatiquement que les seuls livres simoniens comportant des illustrations, c’est-à-dire Orion aveugle et Femmes (13), sont désormais introuvables en librairie, exclus, volontairement peut-être, du corpus lisible des oeuvres de Claude Simon.
Dans le texte même d’Orion aveugle, les illustrations apparaissent comme une série de chicanes entre lesquelles le texte va tenter de louvoyer, contre lesquelles il va parfois s’écrire et à l’emprise desquelles, à chaque instant, il tente d’échapper. Trop présentes, les images entravent le texte, trop séduisantes, elle le déroutent ; pour échapper à cette fascination, il va devoir opérer une série de décalages, d’écarts et de distorsions : écarts, tout d’abord, dans la composition du livre, qui mettent l’image et sa description à distance l’une de l’autre (la description, souvent préalable, se préparant ainsi à évincer totalement l’image décrite), inadéquation, également, entre la réalité décrite dans le texte et celle représentée par l’image, qui ne fait plus alors que « ressembler » en partie à ce qui est décrit (14), ou encore progressives déformations d’une image, subreptices ou soudaines mises en mouvement d’images préalablement immobiles. Le texte, de plus, se livre à plusieurs reprises à la description minutieuses d’autres images, absentes celles-là et donc moins gênantes (15).
Outre cette série de feintes et de fuites, l’une des illustrations d’Orion aveugle vient d’ailleurs souligner, de son immédiate visibilité, le sentiment diffus d’une envie jalouse de celui qui ne fait que tenter de décrire et d’écrire la réalité pour celui qui peut la représenter, immédiatement visible et offerte : comment, en effet, ne pas lire cette envie jalouse de l’écrivain pour le peintre, que Simon a exprimée à maintes reprises au détour d’un entretien, dans l’eau forte de Picasso (n° 308) représentée pp. 96-97. Elle représente un vieil homme au visage ridé qui regarde – sur une scène ? derrière une fenêtre ? un rideau ? ou peut-être sur un écran (de cinéma ?) : le vieil homme est en effet de taille inférieure à celle des autres personnages, pourtant placés derrière lui (16) – des amants jeunes, beaux, nus et accouplés, dont les rapports semblent être ceux d’un peintre avec son modèle (l’homme tient encore une palette et un pinceau, et sur un chevalet à l’arrière-plan est représenté un nu féminin) ; dans cette opposition entre l’impuissance et la vieillesse de l’époux (la femme porte une alliance fort visible), réduit à l’état de voyeur assis et immobile face à une fenêtre, et la jeunesse et l’activité du peintre, on peut voir l’expression d’une jalousie moins charnelle mais peut-être plus poignante : celle de l’écrivain, assis, comme le vieil homme de Picasso, face à la fenêtre ouverte sur le monde – une jalousie, en l’occurrence – l' »oeil agrandi, rond » (17) et comme lui réduit à une possession indirecte et douloureuse de la réalité (qu’il ne peut que re-présenter à travers la description des simulacres qu’en sont les images), pour le peintre qui possède la réalité dont il jouit en la représentant.
II. Propriétés des rectangles : l’espace du cadre
Ici, laissant les autres choses, je dirai seulement ce que je fais quand je peinds. Pour commencer, sur la surface à peindre, je trace un rectangle aux dimensions de mon choix, que je considère comme une fenêtre ouverte par où je regarderais la scène. Alberti, De Pictura (1435), I,19
Cadres
Tout comme le peintre, en effet – la fenêtre du dessin initial en témoigne – l’écrivain éprouve la nécessité de voir le monde à travers un cadre, c’est-à-dire de délimiter le visible. Toute conquête sur le chaos, que ce soit la fondation d’une ville ou le commencement d’un texte, n’est, depuis toujours, possible qu’après une séparation, une délimitation initiale : c’est la raison d’être aussi bien du sillon fondateur des cités romaines que de la fenêtre picturale d’Alberti ; c’est aussi celle de la présence récurrente, à l’incipit des romans simoniens, du motif de la fenêtre ouverte. Cette fenêtre inscrit tout ce qui suit dans les limites d’un cadre, métaphorise le désir de tenter de contenir, de retenir la réalité dans un espace clos et délimité : le cadre doit, avant toute chose, être tracé ; à l’intérieur de ce cadre, seulement, le récit peut déployer ses fuites et dire le chaos, la destruction de tout cadre. Le livre lui-même vient redoubler les cadres tracés à tout instant – et à chaque instant menacés – par les fenêtres et les images qu’évoque le texte : chaque livre, pour Claude Simon, est un cadre construit et reconstruit sans cesse pour lutter contre la force centrifuge des mots, arrêter leur fuite continuelle : « … peut-être, écrit-il dans la préface manuscrite à Orion aveugle, ai-je besoin de voir les mots, comme épinglés, présents et dans l’impossibilité de m’échapper » (18).
Sur la nature et la fonction de ce cadre, le dessin initial est riche d’enseignements : autour de ce dessin, tout d’abord, il n’y a pas de cadre, plutôt un cadrage, puisque l’arrête de la pagination coupe les lignes extrêmes du dessin ; c’est donc la page elle-même, devenue cadre, qui vient faire de la main tenant le stylo la seule partie visible du corps de l’écrivain. La fenêtre, cependant, fait appel à un élément essentiel se trouvant hors-cadre : le regard de l’écrivain, qui ne reste hors du cadre que pour pouvoir mieux, par la suite, mettre le cadre en danger et en jeu. Le cadre, dès l’abord, est donc présenté par ce dessin comme essentiel mais éminemment instable.
Dans ce dessin, de plus, parmi un certain nombre de cadres ouverts, coupés par le cadrage de la page (la fenêtre, la table de travail, la page à demi remplie…), un seul reste intact : celui d’une image posée, dans le coin droit de la table, sur un livre. Or cette image 19 est une carte postale représentant un détail de la Victoire d Héraclius sur Chosroês (20) de Piero Della Francesca, laquelle représente une mêlée sanglante mais géométrique et hiératique d’hommes diversement armés, casqués ou non, et surmontés d’étendards portant des figures d’oiseaux de proie ; le jeune trompette ici détaché par le cadre de la carte postale s’y distingue nettement du spectacle guerrier qui l’entoure de très près (sur le dessin on distingue un bras armé d’une hache au dessus de sa tête, et la moitié d’une armure) par son air détaché et son étrange coiffure (objet, dans La Bataille de Pharsale, de multiples développements et de correspondances proustiennes). Cette carte postale affirme donc l’absolue nécessité, au milieu de ce carnage chaotique qu’est le visible tout entier, d’un cadrage, d’un découpage ayant pour fonction de le rendre supportable et même lisible. C’est la fonction du livre simonien, habité lui aussi par de multiples images de bataille et de guerre.
Rectangles
Tout au long du texte d’Orion aveugle, d’ailleurs, le motif du cadre revient structurer l’espace décrit (21), et ce livre pourrait, comme un fragment des Corps Conducteurs publié l’année suivante, porter le titre générique de « Propriétés des rectangles » (22). Orion aveugle est en effet l’étude – la « considération » (23) plutôt – des propriétés de ce cadre à l’état pur qu’est le rectangle. Elle semble avoir pour but de montrer, au fil des figures déployées par le texte et ses illustrations, que le rectangle peut tout contenir, tend à tout contenir, tout comme il peut se contenir lui-même à l’infini.
C’est là, en particulier, la leçon essentielle du montage de Rauschenberg, Charlene, et de l’utilisation – dont on a dit plus haut l’importance – qu’en fait Claude Simon. Ce collage dynamique, qui n’est reproduit que partiellement dans Orion aveugle (24), est de dominante rouge sombre et ocre – il appartient à la série rouge de Rauschenberg -, couleurs auxquelles s’ajoutent deux taches rectangulaires noire et verte s’ouvrant comme des fenêtres ; l’artiste a en effet divisé et rempli l’espace grâce à des rectangles colorés de matériaux extrêmement divers (cartons d’emballage, dentelle, vieux journaux, métal, reproductions de photographies ou de tableaux célèbres, de Cézanne, Van Gogh, Degas, Goya, Piero Della Francesca, Hokusaï, etc., ainsi ramenés au rang de simples matériaux) et de toutes tailles, la multiplication des rectangles de plus en plus petits les faisant s’emboîter comme des cadres gigognes. Le rectangle et plus précisément le cadre (la présence des images enchâssées confère par ricochet à tous les rectangles du collage cette fonction) est donc l’élément à la fois essentiel et dynamique de ce montage, et le découpage opéré par Claude Simon dans cette oeuvre, dont il ne retient que la partie où figurent les reproductions d’art et les rectangles les plus nettement découpés, accentue cette fonction génératrice.
De ce collage, Claude Simon ne fait dans Orion aveugle aucune description, mais il se livre à une exploitation aussi complète que complexe de ses « propriétés ». les couleurs dominantes de Charlene (le rouge/rose/ocre s’opposant au vert et au noir) sont les paramètres du monde décrit dans le texte, et les formes, surtout, en débordent sur l’ensemble du texte, le rectangle – susceptible de se déformer de diverses manières – s’imposant comme matrice géométrique de l’espace visible. Les structures rectangulaires envahissent également les illustrations d’Orion aveugle, en particulier les montages de Louise Nevelson, Cathédrale du ciel, et George Brecht, Repository 25, la seconde ayant par exemple pour équivalent descriptif : « une vue en élévation du gratte-ciel tel qu’il apparaîtra une fois terminé, côte à côte avec une coupe longitudinale de l’édifice permettant de voir, comme si on en avait retiré la façade, l’intérieur divisé en casiers rectangulaires accolés et entassés les uns sur les autres » (26). Dans cet exemple comme dans de nombreux passages du texte, on s’aperçoit que Claude Simon n’a pas retenu seulement des formes, mais aussi la symbolique sociologique et anthropologique de l’oeuvre de Robert Rauschenberg : elle suscite la description et l’exploitation de tout un espace newyorkais de gratte-ciel et de boutiques à l’abandon, espace de pauvreté et de déchet, de chaleur et de poussière. Cependant, c’est aux possibilités, que contient déjà Charlene, d’exploitation de la forme du rectangle comme cadre que Claude Simon semble s’être intéressé avant tout : le rectangle, cadre vide, tracé délimitant l’espace de ce qui peut être vu, permet, tout comme la fenêtre ouverte dont il est un avatar, au regard sans cesse à l’oeuvre dans les romans simoniens de scruter le monde avec davantage de précision. Au regard, il offre des structures, une perspective et des lignes de fuite, qui viennent couper et unifier les lignes verticales et horizontales engendrées par la matrice rectangulaire : de la contemplation des gratte-ciel naissent ainsi « des lignes de fuite verticales et convergentes interrompues à la hauteur du vingtième étage et que l’oeil prolonge vers leur point de rencontre dans le vide éblouissant et décoloré » (27).
L’oeil
Cet oeil qui structure ainsi le vide est en effet un motif récurrent tout au long d’Orion aveugle, ainsi que de la plupart des romans simoniens, dont la présence forte et troublante – par les associations auxquelles elle donne lieu – signale assez l’importance du regard pour Claude Simon : l’oeil est l’objet, au terme du texte, de l’ultime image, une planche anatomique en couleurs décrite avec une précision extrême, « une coupe longitudinale de la tête de profil permet de voir les principaux organes (…) et la boule exorbitée de l’oeil, livide, enserrée par des racines rouges, avec son iris, son cristallin, son corps vitreux, et la mince membrane de sa rétine sur laquelle les images du monde viennent se plaquer, glisser, l’une prenant la place de l’autre » (28) ; il est fréquemment associé à l’idée de douleur, souvent privé de paupières protectrices (29) – comme pour mieux scruter -, et, associé avec les motifs de l’oiseau de proie et du serpent (30), ainsi qu’avec la couleur rouge (31), l’oeil, toujours avide et dévorant, se fait bouche pour mieux engloutir, avaler le visible que le texte restituera ensuite, au terme d’une lente digestion.
Aussi le corps de l’écrivain, tel que le montrait déjà le dessin initial, est-il avant tout, pour Claude Simon, un oeil et une main : son rôle est de porter sur le visible – par la fenêtre ouverte – un regard exigeant, avide, douloureux à force de se vouloir scrutateur ; de concentrer ensuite, en la focalisant – avec l’aide de la mémoire – l’immensité chaotique de ce qu’il a vu, pour tenter de rendre le monde enfin lisible en le restituant, de sa main qui tient le stylo. Au sein d’un tel projet, on comprend mieux la nécessité, pour le regard, de ne se porter sur le monde qu’au travers d’une fenêtre, on comprend mieux la nécessité, pour l’écriture, de contenir et de structurer l’incohérence du visible dans les limites d’un cadre, aussi fragile et aussi mobile soit-il : le regard, sans le secours d’un cadre, ne verrait du monde qu’un chaos, et l’écriture serait vouée à l’illisibilité ; le cadre délimite, distingue et structure ce qui sans lui ne serait que désordre.
Les nuages
Le regard lui-même, d’ailleurs, n’est jamais donné une fois pour toutes : une série d’obstacles et de difficultés surgissent à chaque page, qui viennent affirmer le caractère problématique, incertain et provisoire de la vision. Le texte, en effet, insiste de façon récurrente sur les seuils de visibilité, les limites imposées à la vue humaine, sur les continuels passages du net au flou, du visible à l’invisible, auxquels semblent sujettes les choses. L’oeil même, que son avidité à scruter rend douloureux, est toujours menacé d’aveuglement partiel et momentané (ce sont les jeux de paupières, les clignements d’yeux, les aveuglements suscités par une trop forte luminosité, etc). ou bien total : la figure de l’Aveugle, souvent présente dans les romans simoniens, trouve en Orion, aveugle mythique et gigantesque, son archétype.
Mais c’est surtout le motif des nuages qui vient représenter le germe, toujours présent à l’intérieur du cadre, de l’aveuglement de l’observateur par obstruction totale du champ de vision : les nuages sont ce que l’oeil voit d’abord par la fenêtre ouverte, ils sont, dans les tableaux, ce qui souligne ou au contraire ce qui nie et fait éclater les limites du cadre ; ils sont sans cesse à l’oeuvre dans Orion aveugle. Dans le tableau de Poussin, Paysage avec Orion aveugle, les nuages, qui forment une guirlande bleutée environnant la tête d’Orion et voilant son regard, symbolisent de toute évidence l’aveuglement d’Orion : Diane, déesse chasseresse jadis rivale d’Orion, peinte de la même couleur bleutée que le nuage sur lequel elle se dresse, représente la colère divine, responsable de l’aveuglement du géant.
Tout au long du roman, indépendamment du mythe d’Orion, les nuages viennent, par des notations récurrentes, rappeler que la vision est toujours difficile, troublée, et qu’au regard existent de multiples obstacles. Dès leur première apparition, « en écharpes, d’abord, fuyant rapidement, puis en paquets grisâtres s’agglutinant, laissant encore voir des morceaux de marécage par leurs déchirures, puis formant à la fin une nappe continue, les nuages s’interposent devant le paysage » (32), et à de multiples reprises ensuite (33), ils représentent le germe d’un possible aveuglement, signalent l’existence, au centre du cadre, d’un point aveugle menaçant.
Si la vision est souvent impossible ou difficile – si les nuages menacent toujours d’envahir le cadre – c’est qu’elle reste en quelque sorte interdite : le regard est interdit, de même que l’aveuglement d’Orion est du à un décret divin, car il rend les hommes capables de contempler des spectacles qu’ils ne devraient pas voir. La fenêtre, le cadre, se muent bien souvent dans les textes simoniens en fente par où l’on épie, et, dans Orion aveugle, la fenêtre ouverte sur le monde finit par s’entrebâiller sur les ébats gigantesques et cosmiques de dieux peuplant les constellations : « leurs formes immenses et accouplées emplissent le champ de vision tout entier. Elles grandissent encore, obstruant la vue tantôt par un membre ployé, tantôt par les délicats replis de la vulve ou par la broussaille ténébreuse d’une aisselle. Des senteurs mêlées de terre humide et de coquillage montent d’entre les cuisses ouvertes de la géante. Les corps tête-bêche tournoient lentement dans la nuit, précipités dans une chute sans fin et cramponnés l’un à l’autre » (34).
Ce qui ne devrait pas être vu peut donc à chaque instant envahir le cadre au point d’obstruer totalement la vue : le point aveugle peut se muer en aveuglement complet du cadre.
Les méandres
Le cadre est en effet une entité éminemment ambivalente dans les textes simoniens : substitut et auxiliaire du regard scrutateur, il se fait bouche et dévore ce qu’il contient ; lié à la mort et à la maladie, associé avec la figure maléfique du serpent qui se mord la queue, il détruit ou dénature souvent ce qu’il contient par les contraintes qu’il impose ; cette puissance mortifère apparaît par exemple lors de la description d’une salle de musée : « Les cadres dorés des tableaux se reflètent dans le plancher ciré, miroitant, de la salle du musée. Ils entourent des rectangles sombres où, la tête en bas, les fantômes de héros, d’évêques ou de femmes sortant du bain se distinguent vaguement, mêlés aux silhouettes verticales des visiteurs debout sur leurs doubles renversés » (35).
Mais, dévorant, le cadre est lui-même dévoré par ce qu’il tente de contenir, lui-même voué à la destruction : il paraît sans cesse menacé par un mouvement centrifuge, par une poussée visant à le faire éclater, à abolir ses limites (36).
Ainsi, dans Orion aveugle, le rectangle et le cadre se trouvent travaillés et concurrencés sans cesse par d’autres formes, qui ne sont plus de l’ordre de la droite – verticale ou horizontale, mais toujours rassurante – mais de l’ordre beaucoup moins immédiatement saisissable de la boucle, de la courbe, du sinueux ou du serpentin, formes dont la figure générique pourrait être le méandre, motif récurrent tout au long du texte (37).
Les méandres, tout d’abord, prolifèrent à l’intérieur du cadre : ce que le cadre tente de contenir et de délimiter est fréquemment animé de mouvements centrifuges et, devenant sinueux, échappe à son emprise. Ainsi, dans le passage où Claude Simon évoque ces incongrues et fascinantes fenêtres que l’homme a inventées pour voir à l’intérieur de son propre corps, sur les planches anatomiques ou les mannequins médicaux, les organes internes s’animent en méandres qui travaillent de l’intérieur le cadre les révèlant : « Sous la masse rougeâtre et sa petite poche verte vient se presser un gros tube livide, boursouflé, parcouru de fines veinules bleues dont l’ensemble dessine un carré approximatif inscrit dans l’ouverture en forme de guitare pratiquée sur le devant du corps. Le côté supérieur du carré s infléchit sous le poids, comme une guirlande. L intérieur est entièrement rempli par les replis sinueux d’un autre tube plus mince, semblable à un gros ver de terre, se tordant sur lui-même convulsivement. L ‘ensemble est animé de lents mouvements de contraction et de décontraction, se déformant imperceptiblement » (38).
Le cadre, d’ailleurs, n’est pas seulement travaillé par ce qu’il contient : lui-même se fait sinueux, s’incurve en spirale, boucle, guirlande, s’orne de méandres (39) ; et, très souvent, le sinueux triomphe et fait éclater le cadre, dans une série de motifs récurrents allant du fil d’un lapin mécanique à celui du téléphone, des méandres de l’Amazone vus d’avion aux spirales intestinales, etc. Le tableau de Poussin privilégie aussi la forme en S, que l’on retrouve dans le corps sinueux du géant, l’arc qu’il tient, le sentier qu’il arpente, et surtout les nuages, qui tout autour de lui « enroulent leurs volutes » (40). Toutes ces figures sinueuses sont présentées comme nettement néfastes, fréquemment associées à l’idée de souffrance (grâce, en particulier, au syntagme « se tordant convulsivement ») et à celle d’une puissance maléfique, qui trouve son expression la plus forte dans le motif omniprésent du serpent : ainsi, lors de l’une des mutiples descriptions des méandres boueux de l’Amazone – dont une photographie (41) à fonction symbolique fait pendant à cette figure de l’imaginaire – on lit : « Les tracés rougeâtres et boueux des rivières dessinent des méandres dont les boucles revenant sur elles-mêmes se rejoignent presque, se tordant convulsivement comme ces vers de terre sectionnés d un coup de pelle, ou des serpents » (42).
Entre les méandres et le cadre, c’est donc bien, dans le livre simonien, d’une lutte qu’il s’agit, mais d’une lutte sans fin puisqu’il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu : le cadre s’efforce sans cesse d’offrir au regard un monde ordonné, organisé, mais le monde visible résiste et s’échappe de toutes parts, travaillant le cadre de multiples forces centrifuges, qui très souvent le font éclater, pour se reconstituer ailleurs ou différent. Plus qu’un rempart contre le chaos du monde visible, le cadre est donc la délimitation d’un lieu de combat entre ordre et désordre, et le livre simonien une arène où se donne le spectacle de ce combat.
La fenêtre ouverte au début d’Orion aveugle semble donc être le lieu d’un enjeu essentiel pour le texte : trop grande ouverte sur le monde visible, elle expose, on va le voir, le livre à un certain nombre de menaces.
III. Porte aux ruines ouvertes
De toute habitation tu interromps le mur Par le propre maçon porte aux ruines ouverte Conjointe sous un voile aux rois extérieurs. Francis Ponge, « La fenêtre », Pièces (« Poésie », Gallimard, pp. 38-43)
1. La dissémination
Toutes les images, toutes les descriptions, disent, tout d’abord, la menace de la dispersion, de la dissémination, qui pèse sur le corps qui regarde et écrit, sur les corps et les choses décrits par le texte, mais aussi sur le texte lui-même. Le cadre, en effet, en ce qu’il a pour fonction de délimiter le champ du visible, découpe et disperse corps, choses et textes.
La dispersion des corps
Dès le dessin initial, ainsi, le cadrage choisi détache la main tenant le stylo du reste du corps, pour la faire entrer dans le monde des choses (elle est dans le dessin au même titre que ce stylo, le coquillage ou la boîte d’allumettes) ; la première illustration, après ce dessin et les couvertures, est un montage de Fernandez Arman, Les Petites mains, fait de mains de poupées arrachées, diversement abîmées et diversement disposées, qui fait un pendant décalé à la description qui ouvre le texte : « dans la vitrine une dizaine de jambes de femmes identiques sont alignées le pied en haut, la cuisse sectionnée à l’aine reposant sur le plancher, le genou légèrement fléchi » (43) ; tout au long d’Orion aveugle, de même, on trouve de nombreuses descriptions chirurgicales ou médicales qui, soutenues par la série de planches anatomiques plus ou moins détaillées qui figure dans la table des illustrations, donnent du corps humain une image extrêmement morcelée et dispersée.
Le corps archétypal d’Orion, lui aussi – dans le tableau éponyme de Nicolas Poussin et, plus encore, dans la description qu’en fait Claude Simon – est un corps morcelé et dédoublé : ‘La tête d’Orion, écrit-il (44), se profile parmi les nuages boursouflés de l’aube, encore grisés par la nuit (…) l’avant-bras gauche horizontal projetant en avant de lui, comme un aveugle qui tatônne, l’énorme main ouverte cachant presque toute entière
une légère éminence dans le lointain. Sur son visage en profil perdu, une tache de lumière posée par le jour qui se lève s étend de la tempe à la pommette, le nez restant dans l’ombre ainsi que la cavité orbitale où l’on distingue la paupière close. Quoique privé de vue, il avance à grands pas, guidé par le petit personnage qui se tient debout sur ses épaules, s’appuyant d’une main sur la chevelure du géant, la tête penchée vers lui pour lui parler et l’autre bras pointé vers le levant pour lui indiquer la direction à suivre, oubliant qu’il ne peut voir » ; la tête, l’oeil (absent) et surtout la main – de même que celle de l’écrivain dans le dessin – sont nettement détachés du reste de son corps, et ce corps lui-même semble dédoublé : à celui du géant s’adjoint celui du petit personnage qui, perché sur son épaule, le guide de la voix, et apparaît comme la matérialisation tout à la fois de la vue et du texte.
D’autres corps, dans Orion aveugle, sont morcelés et comme dispersés par la jouissance : les deux amants, dans l’eau forte de Picasso (45) semblent n’être plus qu’un amas de membres épars et presque indifférenciés, et les constellations se muent en grands corps étoilés déployés, déformés et disloqués.
Le texte Osiris
De même que le corps, sur les planches anatomiques qui fascinent Claude Simon, se fait texte – ses organes étant distingués et étiquetés – le texte est un corps écrit, et, comme tel, soumis à la même menace que les corps : Orion aveugle est un texte toujours envoie de dissémination et de déconstruction, un texte que l’on peut nommer « texte Osiris » (46). La multiplication des séquences narratives qui sans cesse, au carrefour d’un mot, se coupent et se recoupent l’une l’autre, en une série de « captures » et de « libérations » brutales qui très souvent, égarent le lecteur, le rend extrêmement fragmentaire et morcelé. La présence des images, qui, on l’a dit, appelle le feuilletage – c’est-à-dire la dispersion des pages par le regard – rend ce livre doublement découpé et l’installe au bord de la dissémination et donc de l’illisibilité.
Cette menace de dispersion qui pèse sur lui, le texte, d’ailleurs, la met en abîme, par le biais de la description de textes extrêmement morcelés ou partiellement détruits : ainsi, dans la séquence narrative évoquant le colloque sur le rôle des écrivains, les discours des orateurs, rendus obscurs, déjà, par la langue étrangère, se réduisent à des bribes – entrecoupés par d’autres séquences narratives – et parfois à des mots isolés (47). Le spectacle de ce morcellement extrême est aussi la raison d’être des descriptions récurrentes d’enseignes abîmées et d’affiches en lambeaux – également motivés par le montage de Rauschenberg, Canyon, où en figurent de semblables – qui montrent un texte abîmé, presque illisibles : « La palissade de planches est couverte de lambeaux d âfches superposés et déchirés, aux couleurs délavées par la pluie et par le soleil, et dont les lettres, de même que celles des enseignes vues en enfilade, s’entremêlent et se chevauchent. (…) Aucun mot n’est lisible en entier. Il n’en subsiste que quelques fragments énigmatiques, parfois impossibles à compléter, permettant d’autres fois une ou plusieurs interprétations (ou reconstitutions) comme, par exemple, ABOR (IABOR, ou ABORto, ou ABORecer ?), SOCIA (SOCIAlismo, asSOCIAtion ?) et CAN (CANdidato, CANibal, CANker ?) » (48).
Le collage
Ces exemples le montrent, cependant, ce n’est pas seulement le texte qui est morcelé et fragmentaire, mais avant tout le monde visible. L’écriture ne recherche sa propre dissémination que par souci de rendre le désordre et le morcellement du réel. Dans cette tâche, le cadre est l’un de ses outils de prédilection, puisque cadrer, délimiter, c’est toujours découper.
Mais paradoxalement – et ce paradoxe fait à mon sens toute la force des textes simoniens – l’écriture se doit aussi, pour rester lisible et ne pas sombrer, comme les fragments d’affiches, dans l’illisibilité, de réunifier, d’ordonner, ce qui sans elle serait disjoint, désordonné. Le cadre, là encore, est un auxiliaire nécessaire.
La multiplicité des montages, parmi les illustrations d’Orion aveugle, met en évidence cette volonté de recomposition et de reconstruction du réel visible : à l’origine des montages de Robert Rauschenberg, Louise Nevelson ou Andy Warhol se trouve en effet un désir de rendre compte de l’incohérence et de la fragmentation du monde, tout en lui inventant – selon des critères de forme, de couleur ou de signification – une cohérence nouvelle. Le montage photographique d’Andy Warhol (49), ainsi, apparaît comme une tentative pour susciter un certain type d’interprétation de la société américaine grâce à la juxtaposition (en un damier rectangulaire que l’on peut parcourir en tous sens, construit grâce à des rapprochements de couleurs), d’images diverses mais significatives : des photographies de Marylin Monroe et de Che Guevara, des réclames lumineuses très suggestives et une série de photogrammes successifs extraits du film montrant l’assassinat de John Kennedy. Les montages de Rauschenberg, de même, sont intéressants dans la mesure où ils mettent sur le même plan ouvres d’art extrêmement célèbres et matériaux de récupération (papier journal, vieux cartons, etc.) pour créer de toutes pièces une nouvelle logique des valeurs.
Le travail d’écriture de Claude Simon se fait de manière comparable : tout comme dans les collages que lui-même prend plaisir à réaliser, il ne s’efforce dans ses romans de rendre le morcellement du réel visible que pour mieux tenter ensuite – en un effort qui ne peut avoir d’aboutissement véritable – de le réordonner en le recréant. Il compare d’ailleurs à maintes reprises son propre travail à celui des peintres modernes, qui ont compris la nécessité de cet effort de réécriture et de recréation du monde visible : « Si l’on pense, dit-il dans un entretien (50), à l effort de transposition auquel est tenu le peintre, par exemple, obligé pour être vrai (exact) de recréer complètement ce qu fl veut restituer (…) nécessité qui l’a poussé à ces véritables tours de force techniques qu’ont été la fragmentation de la couleur chez les impressionnistes, ou de la forme chez les cubistes, on aura une idée du travail de recomposition que le souci de « copier » avec exactitude exige de l’écrivain ». Caballero, le tableau de Jean Dubuffet (51), pour lequel Claude Simon a une grande admiration, illustre à merveille cet effort, de même que les multiples descriptions pointillistes que l’on trouve dans Orion aveugle, qu’il s’agisse de la description d’un tableau impresioniste représentant des danseuses (52), ou de celles de la réalité extérieure : les rues de New York, en particulier, donnent lieu à des descriptions très intéressantes : « Les passants ou les groupes qui la composent marchant en directions opposées, se croisent, s’infiltrent les uns dans les autres de sorte que, de loin, les divers mouvements se neutralisant, elle offre l’aspect d’un amalgame de petites taches aux dominantes pastels, l’oeil ne pouvant suivre aucune d’entre elles en particulier, leur masse paraissant stagner, constituer un élément statique dans l ensemble géométrique des constructions (…). Il semble que les mêmes particules se cognent, se faufilent, réapparaissent, recomposent inlassablement un autre ensemble à la fois différent et en tout point pareil au précédent et où, pas plus que dans une poignée de gravier, il n’est possible de déceler ni structure ni ordre » (53).
2. L’indifférenciation
Cet effort de recomposition et de recréation du réel visible se heurte cependant, dans sa lutte contre la dissémination, à la menace contraire mais tout aussi présente, et peut-être plus troublante encore, de l’indifférenciation : la trop grande cohérence, la trop grande convergence qui naissent d’une tentative d’harmonisation ont pour effet parfois une uniformisation dans laquelle les éléments se trouvent abolis ; dans la fusion, les parties s’annihilent, et tout se dissout dans la convergence. Sur le texte plane donc en permanence cette menace de la fusion, de l’indifférenciation, c’est à dire, selon une image souvent reprise par Claude Simon, la transformation de tout ce qui est perçu par le regard en une surface plane, grise et uniforme.
Le fond
L’intérêt de Claude Simon pour la peinture lui fait choisir, comme première manifestation sensible de cette menace d’uniformisation, le « fond » pictural : la Peinture est en effet l’expression de la diversité du monde visible, sur la toile, au moyen d’une unique manière ; cette réduction aussi bien des corps humains et des choses que des paysages naturels à la seule pâte picturale peut aisément représenter pour l’imagination le retour à la matière indifférenciée des origines. C’est cette angoisse fondamentale qui transparaît dans le seul passage de commentaire esthétique – le discours critique servant ici de rempart à l’irrationnel – que l’on trouve dans Orion aveugle – alors que dans La Bataille de Pharsale ils foisonnent : « Le peintre s’est contradictoirement attaché à multiplier les artifices qui ont pour résultat de détruire cet effet de façon que le géant se trouve partie intégrante du magma de terre, de feuillage, d’eau et de ciel qui l’entoure (…) il apparaît comme une figure de bas-relief, collé au décor qui est censé l’encadrer ou lui servir de fond (…) le rocher qui surplombe la colline, aux pans violemment éclairés ou obscurs, le bouillonnement tumultueux des nuées aux noirs replis, sont de la même nature que le dos musculeux, rocheux du géant englué dans cette même argile où le créateur a pétri indifféremment les formes du monde vivant et inanimé (…) désignant de son doigt au visage aveugle un but idéal, fait seulement, comme le doigt lui-même, les paupières closes, les épaules bosselées et les empreintes des pieds monumentaux dans la poussière du chemin, dune mince pellicule de couleur » (54). Ce passage rend bien compte de la menace d’indifférenciation que renferme le fond pictural : le corps humain tel que le représente le peintre peut à chaque instant se fondre dans le paysage ; et c’est dévoré par la matière, englué dans la nature qui l’encercle que Claude Simon imagine l’Orion de Poussin, dont le corps, on l’a dit, est aussi celui de l’écrivain.
Dans Charlène ou Canyon – l’autre montage de Robert Rauschenberg présent parmi les illustrations d’Orion aveugle – c’est à une même indifférenciation que l’on assiste, sur le fond rouge-ocre superposés ou juxtaposés par le collage, réunis par une même gamme de couleurs, matériaux nobles (la dentelle, par exemple), matériaux de récupération (lambeaux d’affiches, vieux cartons ou journaux déchirés) et oeuvres d’art extrêmement célèbres se trouvent amalgamés en un même ensemble indifférencié où ils ont tendance – à première vue, pour le spectateur indifférent, ou, tout au contraire, au terme de la réflexion suscitée chez le spectateur averti – à se confondre en abandonnant totalement aussi bien leurs différences préalables que leur identité.
Le gris
Autre manifestation sensible de cette menace d’indifférenciation, la couleur grise est chez Claude Simon le paradigme récurrent de l’opacification et de la confusion : les couleurs, de par les correspondances et les oppositions qu’elles permettent, jouent un grand rôle dans la structuration aussi bien des romans simoniens que du monde qu’ils décrivent ; le gris, par opposition, c’est, plutôt que l’absence de couleur, l’absence de différenciation entre les couleurs, résultant de la fusion de toutes les couleurs en une seule.
La récurrence du syntagme « comme recouvert par une uniforme couche de peinture grise » dans tous les textes de Claude Simon, ainsi que, dans Orion aveugle, le choix de certaines illustrations ou l’option du noir et blanc pour certaines d’entre elles, sont symptomatiques de cette hantise du gris. Le montage de Brassai, Ciel postiche (55), ainsi, réunit quatre éléments au départ totalement disparates (un corps de femme nu, la mer, la terre et le ciel) qui sont juxtaposés par bandes horizontales, et homogénéisés, amalgamés, grâce d’une part aux formes communément courbes et sinueuses des quatre éléments, et d’autre part, à la sélection d’une même lumière grise et mate pour chacun d’eux : c’est donc, ici, avec la complicité du sinueux – dont on a signalé plus haut l’importance – que le gris parvient à fondre en un même motif presque géométrique et abstrait un corps humain et les éléments naturels. Ailleurs, c’est avec la complicité d’une fenêtre ouverte sur la nuit que le gris fait retourner les corps d’un couple d’amants reposant sur un lit à la matière indifférenciée : ils sont à la fois amalgamés et transformés en des gisants de pierre, par la seule vertu de la lumière grise nocturne : « Dans la lumière laiteuse qui entre par la fenêtre ouverte sur la nuit, les deux corps emmêlés sont d’une teinte grisâtre, comme recouverts d’une uniforme couche de peinture… » (56).
Le gris de l’indifférenciation a, on le voit, partie liée avec la mort, mais aussi avec le passage irrémédiable et douloureux du temps : le gris est en effet associé à « l’usure, à la poussière, à l’invisible pellicule qui recouvre les choses désaffectées ou les êtres sortis de la vie présente : le vieillissement inéluctable de toute chose est ainsi traduit par l’affadissement de toutes les couleurs jusqu’au gris (celles des constellations représentées sur un plafond, et dotées des mouvements de la vie, dont les années, l’oxydation ou les fumées de cigares ont grisé les couleurs, les corps dont les flancs se soulèvent et s’abaissent au rythme de leur respiration » (57), ou celles des enseignes, « primitivement rouges, bleues ou vertes, les lettres sont à présent rose fané, vert olive ou bleu gris sur le fond lui-même gris » (58) ).
Le magma
Mais la menace essentielle est celle du retour au magma informe, à la matière élémentaire et indifférenciée : cette matière informe risque à chaque instant, semble-t-il, de recouvrir toutes choses et d’engloutir les corps des vivants, tels celui d’Orion « collé au décor qui est censé l’encadrer ou lui servir de fond » (59), ou celui de l’homme malade qui erre dans les rues de New York l’été, auquel il « semble se traîner sur place, englué dans une espèce de pâte tiède et visqueuse dont il ne parvient pas à se détacher » (60).
La matière indifférenciée prend dans Orion aveugle des formes diverses : couches de peinture, pellicules de poussière, affadissement des couleurs, mais aussi et surtout la boue, qui, fusion de la terre et de l’eau, motif à la fois tellurique et aqueux, motive les descriptions récurrentes de rivières ou de marécages équatoriaux (la boue se trouvant alors associée au méandre, comme elle dangereux). La dimension de l’élémentaire, plus généralement, se montre dans ce livre extrêmement prégnante : Claude Simon s’y livre en effet à un jeu anagrammatique complexe à partir du nom d’Orion, et en particulier à partir de ses deux premières lettres, O et R, c’est-à-dire « eau » et « air », mais aussi « terre » (t’R), qui, associés, donnent la boue (O + tR) et le nuage (O + R) (61). Les éléments eau, air et terre (le quatrième, le feu, semble être délibérement écarté par souci de souligner l’assimilation, qui court tout au long du roman, entre le personnage principal, souffrant d’une maladie du foie, et Prométhée) sont donc convoqués à de multiples reprises lors des descriptions de forêts, montagnes et rivières vues d’avion ; la fusion de ces trois éléments, souvent évoquée, nous ramène au fantasme de la matière élémentaire, état d’avant les êtres et les choses, qui est incarnée dans l’effrayante image d’un monstre aquatique surgi hors du temps, « quelque furieux et gigantesque saurien (…) se convulsant, écrasant sous son ventre de terre, ses millions de tonnes, la fange verdâtre et puante des marécages et des forêts invisibles, tout en bas, sous l’étouffant couvercle de nuages » (62).
Avec Lucien Dallenbäch (63), on peut donc parler, plutôt que d’un retour à (ou de) l’élémentaire, d’une « sortie sans cesse recommencée hors de l’élémentaire », le texte simonien s’efforçant d’arracher au magma de l’élémentaire le monde visible. La fonction du cadre de la fenêtre est celle-ci : distinguer êtres et choses du désordre du visible, les en détacher pour les faire échapper à l’engluement.
Cette menace du magma élémentaire, ce danger de l’indifférenciation ne pèsent pas seulement sur le monde visible mais également, bien entendu, sur les livres simoniens qui tentent d’en restituer avec exactitude le chaos. Claude Simon a en effet pleinement conscience de ce que sa volonté littéraire de recréation, de recomposition et de réunification du monde peut avoir pour conséquence une annihilation dans l’indifférencié, une fusion de toutes choses en un magma de mots : son travail consiste en effet en particulier à établir d’incessantes correspondances entre des réalités très différentes voire opposées, grâce à l’utilisation de termes identiques – qu’il nomme « carrefours » – pour chacune d’entre elles ; cette série d’échos textuels permet le passage continuel de l’une à l’autre des séquences narratives, qui se trouvent ainsi pour un temps – ne serait-ce que celui de la réaction du lecteur, volontairement abusé – conjointes et confondues. Tout peut ainsi devenir semblable (l’avion survolant l’Amazone, les corps de deux amants et le lapin mécanique qu’un enfant tire au bout d’un fil se trouvant, par exemple, soudain amalgamés dans la description d’un même mouvement de soubresaut) et le texte se muer en une pellicule de mots dont le sens échappe : certains passages ne sont plus qu’un rythme, un flot fangeux et sinueux où le lecteur ne fait plus que reconnaître des mots désormais détachés de toutes les réalités évoquées (ou bien, ce qui revient au même, associés à la fois avec chacune de ces réalités). La simultanéité de toutes choses dans le monde, le magma qu’est le visible, sont alors parfaitement rendus par le texte, qui n’est plus – devenu lui-même magma informe de mots – que le résultat de la fusion indifférenciée des réalités qu’il évoque.
Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses… Orion aveugle, préface, p. 14.
Par la fenêtre ouverte au début du livre simonien, tout peut donc entrer. Scruter le visible expose tout à la fois le corps et le texte à une série de périls opposés et néanmoins conjoints, qui posent le problème fondamental de toute écriture : tenter de rendre avec exactitude le chaos du monde visible voue le texte à l’illisibilité de l’indifférenciation, mais essayer de réduire son incohérence – en recourant aux puissances de découpage et de structuration du cadre – ne conduit qu’à l’illisibilité de la dissémination. Tout échappe, ou bien tout se dissout dans la convergence. Tout fusionne et s’uniformise, ou bien tout s’éparpille et se dissipe.
L’une des descriptions pointillistes des passants new-yorkais que l’on trouve dans Orion aveugle pose d’ailleurs très bien cette alternative se fondre / se détacher, mettant en abîme le dilemme de l’écriture simonienne, « soit que, s’éloignant, les silhouettes des passants décroissent peu à peu, s’amenuisent, aillent se fondre dans le magma tacheté le long des hautes façades, soit qu’au contraire, s’en détachant et grandissant au fur et à mesure de leur avance, les contours des petites particules anonymes se précisent peu à peu, chacune d’entre elles s Individualisant à mesure qu °elle se rapproche, devenant femme, homme ou enfant » (64).
Face à ce dilemme, l’écriture simonienne refuse de trancher, et c’est là ce qui fait sa force et sa beauté : cette écriture sans cesse menacée demeure à l’état naissant, donnant et redonnant sans cesse le spectacle d’une lutte originelle, gigantesque et insoluble entre ordre et désordre. Quand quelque chose existe dans les textes simoniens, quand le livre lui-même surgit, c’est toujours « sur fond de » (le syntagme est récurrent chez Claude Simon) chaos et de magma : cette continuelle émergence du cadre et du livre hors de l’indifférencié est à la source de l’émotion suscitée par ces romans chez leur lecteur.
Notes
1. Coll. « Les Sentiers de la Création », Ed. Skira, Paris-Genève, 1970 (les pages citées en note le seront désormais dans cette édition, que l’on notera OA).
2. Ed. du Sagittaire, 1947: ce récit autobiographique et fondateur s’ouvre sur un clin d’oeil proustien : « Autrefois, je restais tard au lit et j’étais bien. Je fumais des cigarettes, jouissant de mon corps étendu, et je regardais parla fenêtre… », p. 9.
3. Ed. de Minuit, Paris, 1967, qui s’ouvre sur l’évocation de moments d’écriture nocturne : « quand je travaillais tard la nuit assis devant la fenêtre ouverte », pp. 9-10.
4. Ed. de Minuit, 1969, pp. 9-11 et pp. 256-271.
5. On peut, sur ce sujet, lire l’intéressant article de Jean-Claude Vareille, « What we learn from an open window », in The Review of contemporary fiction, print. 1985, pp. 114-27.
6. Dans « Claude Simon à la question », Colloque de Cerisy, 1975, ed. UGE 10/18.
7. Traduction d’un entretien avec Claud DuVerlie, Sub-Stance, hiver 1974, n° 2, p. 14.
8. Les Corps conducteurs, Ed. de Minuit, 1971, sont une extension d’Orion aveugle : les 86 premières pages (le livre en compte 226) en sont la reprise presque intégrale (la première phrase, seule, a été supprimée).
9. Dans « Roman, description, action », Studi di Leteratura Francese,1982, vol. 17, pp. 12-27.
10. Les planches anatomiques, par exemple, ou encore la photographie des méandres de l’Amazone.
11. On peut lire sur ce sujet l’article de Tom Bishop, « La vue d’Orion ou le processus de la création », Entretiens, n° 31,1972, pp. 35-39.
12. Traduction de l’entretien avec Claud DuVerlie, op. cit., p. 14.
13. Femmes. Sur vingt-trois peintures de Joan Miro, court texte édité en tirage limité par les Editions Maeght (1966), repris, allégé lui aussi de ses illustrations, en 1984 par les Editions de Minuit, sous le titre La Chevelure de Bérénice.
14. Le rapport de dépendance se trouvant, là encore, inversé : pp. 20-21, par exemple, les mains de poupées éparses dans le collage d’Arman ne font que rappeler les jambes de mannequins décrites au début du texte, et, sur la photographie, p. 80, le téléphone mural est parisien et sa cabine mouillée de pluie, alors que celui précédemment décrit par le texte est newyorkais et mouillé seulement par la sueur du personnage.
15. Par exemple, p. 111, un tableau impressionniste ou pointilliste (de Seurat, peut-être), représentant des danseuses.
16. Claude Simon s’interroge sur cet effet dans Les Corps conducteurs, op. cit., pp. 131 sq.
17. ib., p. 131.
18. OA, p. 15 (c’est l’auteur qui souligne).
19. Cf. sa description dans La Bataille de Pharsale, op. cit., p. 268.
20. Cette célèbre fresque fait partie des fresques de San Francesco (Arezzo) relatant l’ » ‘Histoire de la Vraie Croix ».
21. Voir en particulier OA, pp. 32, 48, 75,109,138.
22. Ce titre fut donné par Claude Simon à un fragment des Corps conducteurs publié dans Tel Quel, n° 44, pp. 3-16.
23. Claude Simon utilise ce terme dans son article « La fiction mot à mot », Colloque de Cerisy : Le Nouveau roman, II, Pratiques, UGE, 10/18, 1972. 24. pp. 17-18 (page de titre) et p. 49.
25. OA, pp. 135 et 56.
26. OA, p. 55.
27. OA, p. 29 (c’est moi qui souligne).
28. OA, pp. 145 et 146.
29. OA, par exemple p. 40: « la tête porte des yeux sans paupières », ou p. 146 « contemplant de leurs yeux aux paupières brûlantes ».
30. Voir sur ce motif du serpent et ses corrélations avec l’oeil et la bouche l’article de Raymond Gay-Grosier, « Orion aveugle ou les configurations du serpent : la palette du verbe », French Forum, mai 1977.
31. OA, par exemple p. 40, le serpentaire « à l’oeil entouré de cartilages d’un rouge sanguinolent », ou p. 60, le condor et son « oeil cerclé de rouge ».
32. OA, p. 40 (c’est moi qui souligne).
33. OA, en particulier pp. 43, 53-54, 79, 82, 102.
34. OA, p. 95.
35. OA, p. 109.
36. Sur cette ambivalence du cadre chez Claude Simon, l’article de Joan Brandt, « History and Art », The Romanic review, n° 3, mai 1982, pp. 373-384, apporte des éléments intéressants.
37. Les sortilèges de la boucle, répertoriés par Gilbert Lascault dans Boucles et Noeuds, Ed. Balland, « Le commerce des idées », 1981, semblent être explorés dans leur totalité par les livres simoniens.
38. OA, p. 32, cf. aussi pp. 113-114: « une petite fenêtre vitrée, ménagée sur la poitrine, un membre, permet de voir à l’intérieur… ».
39. OA, par exemple pp. 48 ou 75.
40. OA, p. 129.
41. Reproduite dans Orion aveugle pp. 38-39, et sur laquelle on peut lire les commentaires de Michelle Rogers, dans « Fonction des quatre photographies dans l’Orion aveugle de Claude Simon », French Review, oct. 1985, pp. 74-83. 42. OA, p. 36, voir aussi pp. 32,37-40,54.
43. OA, p. 19 (Les petites mains se trouve pp. 20-21).
44. OA, p. 99.
45. Reproduite dans OA, pp. 96-97.
46. En hommage à l’analyse exemplaire qu’a faite Jean Ricardou des mécanismes qui vouent les textes des Corps conducteurs et Triptyque (Ed. de Minuit, 1973) à une segmentation méthodique, dans « Le Dispositif osiriaque », Nouveaux problèmes du roman, Ed. du Seuil, 1978, pp. 179-240.
47. OA, cf. par exemple pp. 61 ou 88.
48. OA, p. 60.
49. Reproduit dans OA, pp. 140-141.
50. Dans « Pourquoi des romans ? »,Les Lettres Françaises, 4-10 déc.1958, p. 5.
51. Reproduit dans OA, p. 124.
52. Qui n’est ni nommé ni reproduit, cf. p. 110-111: « La lumière qui monte des quinquets se fragmente en une myriade de confetti jaunes, vert Nil, mauves ou noirs qui tantôt s’éparpillent, tantôt se concentrent en taches sombres à la façon de la limaille sur un champ magnétique ».
53. OA, pp. 63-64-65.
54. OA, pp. 126 sq. (c’est moi qui souligne).
55. Publié en 1934 dans Le Minotaure, n° 6, et reproduit dans OA, p. 101.
56. OA, pp. 94-95 (c’est moi qui souligne).
57. OA, p. 93.
58. OA, p. 60.
59. OA, p. 63.
60. OA, p.126.
61. Jean-Claude Raillon a analysé ces jeux de façon fort détaillée (à propos du texte des Corps conducteurs), dans « Eléments pour une physique littérale », Degrés, oct. 1973,1, 4, pp. 1-29.
62. OA, p. 54.
63. Dont on peut lire, sur ce sujet, le récent article, « La question primordiale », Sur Claude Simon (recueil de communications faites au colloque de Genève), Ed. de Minuit, 1987.
64. OA, p. 119.


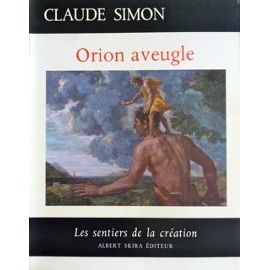
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.