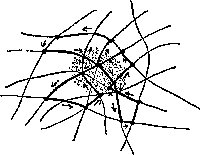
Roman, description et action (1978)
Claude Simon. “ Roman, description et action ”, Studi di Letteratura Francese, VIII, vol. 170, 1982, p. 12-27 [conférence prononcée en 1978, déjà publiée dans The Feeling for nature and the landscape of man [Proceedings of the 45th Nobel Symposium]. Textes réunis par Paul Hellberg, 1980, p. 78-89
Dans un article publié à Léningrad en 1927 et intitulé De l’évolution littéraire, l’essayiste russe Tynianov écrivait :
En gros, les descriptions de la nature dans les romans anciens, que l’on serait tenté, du point de vue d’un certain système littéraire, de réduire à un rôle auxiliaire, de soudure ou de ralentissement (et donc de rejeter presque), devraient, du point de vue d’un autre système littéraire, être considérés comme un élément principal, parce qu’il peut arriver que la fable ne soit que motivation, prétexte à accumuler des descriptions statiques.
Ce texte (qui à certains égards apparaît comme prophétique) appelle, me semble-t-il, un certain nombre de remarques.
* * *
Observons tout d’abord que, pour qualifier l’action d’un roman, Tynianov emploie le mot fable.
Or, selon le dictionnaire, ce mot a deux acceptions.
La première est la suivante : “ petit récit d’où l’on tire une moralité ”.
Tout de suite, alors, une objection vient à l’esprit : c’est que, en fait, le processus de fabrication de la fable se déroule exactement à l’inverse de ce schéma et que c’est le récit qui est tiré de la moralité. En d’autres termes, pour le fabuliste il y a d’abord une moralité, et ensuite l’histoire qu’il imagine (histoire fictive faut-il le souligner), élaborée en fonction de ce sens, à titre de démonstration imagée pour illustrer une maxime, un précepte ou une thèse que l’auteur cherche, par ce moyen, à rendre plus frappante. Cette thèse, ce précepte, cette maxime préexistants à la fabrication de l’histoire (de l’action) relèvent de ce que l’on appelle le sens institué.
Et c’est cette tradition qui, en France, à travers les fabliaux du Moyen Age, les fabulistes et la comédie dite “ de mœurs ”” ou “ de caractère ” du XVIle siècle, puis le conte philosophique du XVIIIe, a abouti au roman prétendument “ réaliste ” du XIXe affirmant, comme le proclamait Balzac, donner une “ reproduction rigoureuse ” de la société et prétendant par cela même à une vertu didactique.
Novateur à son époque, porté par un certain style et une certaine démesure qui le haussaient au-delà de ses intentions, ce type de roman a peu à peu dégénéré pour donner naissance à des oeuvres qui n’en ont retenu que l’esprit purement démonstratif et dont un exemple caricatural dans la littérature contemporaine est offert par une fiction comme La peste d’Albert Camus. Chacun sait bien en effet qu’il ne va pas trouver dans ce roman une description de ce fléau (dont Camus, au contraire de Daniel de Foe à Londres, n’a d’ailleurs jamais été témoin), que le titre doit être pris dans son acception symbolique, et que, de même que dans la fable de La Fontaine intitulée Les animaux malades de la peste, ce qu’on va lire est un apologue destiné à montrer, selon les idées de l’auteur, les comportements de divers types d’individus en présence d’une catastrophe ou d’une épreuve subie par une communauté.
Ce savoir que Camus pense posséder, il nous le transmet par le biais d’une fiction forgée par lui de toutes pièces, et il est bien évident alors que, dans une telle optique, toute description apparaît non seulement superflue mais, comme le souligne Tynianov, importune, “ à rejeter ”, puisqu’elle vient se greffer sur l’action, l’interrompt, ne fait que retarder le moment où le lecteur va enfin découvrir le sens de cette histoire dans laquelle les descriptions qui, toujours dans cette optique, sont, par excellence, non action, ne lui apparaissent, très exactement, que comme non sens.
* * *
“ L’apologue, écrit La Fontaine, est constitué de deux parties dont on peut appeler l’une le corps, l’autre l’âme : le corps est la fable, l’âme la moralité ”.
Voilà les choses bien mises à leur place, et la vieille dichotomie âme/corps, esprit/matière, contenu/contenant, fond/forme, fonctionne avec ces catégories bien tranchées, accordées à la morale chrétienne qui veut que l’âme, l’esprit, soient choses nobles, sacrées, et le corps, la matière, choses basses, sinon honteuses.
Cependant, si l’on s’arrête, ne serait‑ce qu’un peu, à examiner ce corps, cette matière méprisée (indépendamment de laquelle pourtant jamais aucun esprit ne s’est manifesté), une constatation s’impose aussitôt : c’est que le langage (sans quoi il n’est pas de fable, et donc, pour s’exprimer comme le bon La Fontaine, pas d’âme … ), ce langage, sa caractéristique “ matérielle ” si j’ose dire, mesurable, c’est qu’il appartient à l’ordre du linéaire et qu’il s’ensuit que toute personne qui parle ou écrit, tout discours (qu’il soit narratif ou descriptif), est obligé de tenir compte qu’il doit transposer dans une dimension unique (la durée) un monde qui est, lui, multidimensionnel, soit dans la simultanéité des perceptions, soit dans celle des qualités d’un objet, des aspects d’un spectacle, soit encore dans celle des actions.
Et de ce simple fait découle une série de conséquences complexes que, très schématiquement, on peut résumer de la façon suivante :
Forcé que je suis d’énumérer successivement ce qui est simultané, je dois décider d’un ordre, ne serait-il que syntaxique, ce qui implique une priorité (comme on l’a remarqué, si je dis : “ La rivière passe sous le pont ”, ou “ Le pont franchit la rivière ”, je ne dis pas la même chose).
De plus, les composantes, les aspects de toute action, de tout spectacle, de tout objet étant d’une multiplicité presque infinie, il m’est impossible d’entreprendre de les énumérer tous (je parle bien entendu d’un texte littéraire, pas d’un traité d’anatomie, de botanique ou de géologie) car l’accumulation des informations ainsi éparpillées dans le temps, outre son caractère fastidieux, aurait pour effet inéluctable de détruire dans l’esprit du lecteur toute cohérence.
L’action, l’objet ou le spectacle écrits ne peuvent donc être que :
1) déformés selon l’ordre de priorité donné dans le successif à ce qui est simultané;
2) partiels, c’est-à-dire réduits à quelques-unes seulement de leurs composantes (ainsi nous ne savons rien d’autre de “ la dame en rose qui mangeait des mandarines ” de Proust que : dame, rose, manger et mandarines ‑ et si, bien sûr, par la suite, de loin en loin, d’autres informations nous seront données sur Odette de Crécy, il est à souligner que chaque fois c’est un groupe (ou une combinaison) d’informations extrêmement fragmentaires, que jamais le personnage d’Odette ne nous sera donné d’une fois, en son entier, et que, de plus, ces informations sont souvent contradictoires, faisant d’Odette un être aux multiples facettes, essentiellement ambigu (une “ fonction variable ”, comme l’on dirait en mathématiques) en accord, comme d’ailleurs tous les autres personnages de Proust, avec la polysémie du texte).
De ces observations, il ressort à l’évidence qu’inévitablement impuissante à représenter, à reproduire (contrairement à ce que prétendent les “ réalistes ”), la langue et par conséquent l’écriture produisent des objets qui, avant d’être écrits n’existaient pas.
* * *
Quant à la nature de ces objets, quelle est‑elle?
Eh bien, si l’on y réfléchit, on découvre, comme je viens de le dire pour Odette de Crécy, qu’elle s’avère d’une complexe ambiguïte, et je crois que c’est une question sur laquelle il est encore nécessaire de s’arrêter sous peine de tomber dans l’une ou l’autre de ces simplifications dogmatiques, aussi opposées qu’absurdes, aboutissant soit à la recherche terroriste et naïve d’un sens, soit, au contraire, à une volonté tout aussi naïve et terroriste de répudiation du sens, double naïveté spirituellement stigmatisée par la boutade d’un critique rappelant qu’il y a un siècle, lorsque les Impressionnistes faisaient scandale en exposant ce que l’on appelait alors des “ barbouillages informes ”, leurs rares défenseurs disaient aux gens : “ Eloignez‑vous, éloignez‑vous, et vous verrez que cela représente quelque chose ”, tandis qu’il y a quelques années, au moment de la grande vogue de la peinture “ abstraite ” ou tachiste, ses défenseurs qui lui cherchaient des appuis dans une certaine tradition, disaient aux gens en leur montrant les mêmes oeuvres des impressionnistes (en particulier de Monet) : “ Rapprochez‑vous, rapprochez‑vous, et vous verrez que cela ne représente rien ”! …
Alors, que peut‑on dire?
Ma foi, je hasarderai ceci : la langue étant, par essence, métaphorique, les mots ne sont pas seulement signes mais, selon l’expression de Lacan, “ noeuds de significations ” ou, si l’on préfère, comme je l’ai dit dans ma préface à Orion aveugle, des “ carrefours de sens ”, en fonction de quoi l’on peut, me semble‑t‑il, énoncer ce qui suit, à savoir que l’objet décrit ou plutôt écrit se trouve en rapport avec l’objet (ou le concept) auquel le mot renvoie mais, en même temps (et c’est là que réside l’ambiguïté) il se trouve aussi, au sein de la langue, en rapport avec une multitude d’autres objets qui, dans le monde quotidien, le temps ou l’espace mesurables, se trouvent très éloignés de lui et souvent sans rapports apparents, de sorte que Chklovski peut définir très pertinemment le fait littéraire comme “ le transfert d’un objet de sa perception habituelle dans la sphère d’une nouvelle perception ”, définition qui va d’ailleurs de soi si l’on veut bien se rappeler qu’en grec le sens concret du mot metajora est, très exactement, transport.
* * *
Mais prenons un exemple.
Dans Les jeunes filles en fleurs, Proust, parlant des repas qu’il prend avec sa grand_mère dans la salle à manger du Grand Hôtel de la Plage, à Balbec, écrit ceci :
“ Pour ma part, afin de garder, pour pouvoir aimer Balbec, l’idée que j’étais sur la pointe extrême de la terre, je m’efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d’y chercher des effets décrits par Baudelaire et de ne laisser tomber mes regards sur notre table que les jours ou y était servi quelque vaste poisson, monstre marin qui, au contraire des couteaux et des fourchettes, était contemporain des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l’Océan, au temps des Cimmeriens, et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses, avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer ”.
Avant d’aller plus loin dans l’étude de ce texte étonnant, ce que l’on peut tout de suite noter c’est à quel point une telle description illustre la définition proposée par Chklovski, c’est à dire que par le travail de la langue un poisson bouilli posé sur un plat est soudain arraché à son contexte dans le monde quotidien (les couteaux, les fourchettes, un déjeuner vers 1900 dans la salle à manger d’un hôtel) pour être tranporté dans un cadre aux tout autres dimensions.
Les mots que Proust a choisis pour en parler (et notons encore au passage la sélection qu’ils constituent, car pas plus qu’il ne nous précise son espèce, Proust ne nous dit ni la couleur de sa peau, ni sa forme particulière, ni sa saveur, etc. …), les mots, donc, employés (convoqués) pour cette description (soit : vaste, monstre, marin, époques primitives, vie, afflux, Cimmérien, innombrable, vertèbres, bleu, rose, construit, nature, plan, architecture, cathédrale, mer), ont le pouvoir de susciter soudain dans cette banale salle à manger de Palace tout un ensemble de majestueuses résonances ou harmoniques mettant en jeu les concepts de préhistoire, de biologie et de structure qui font que, soudain nous prenons conscience que cet objet n’est pas un accident isolé mais un élément de cette immense et rigoureuse organisation dans l’espace et le temps qu’est le monde auquel il est étroitement lié par tout un réseau de correspondances qui font de lui un véritable monument.
Assis avec Proust, sa grand-mère et une marquise bavarde à cette table d’un grand hôtel normand, nous sommes soudain pénétrés, comme devant une peinture de Cézanne ou de Rubens, par ce sentiment pour ainsi dire cosmique que tout dans la nature se commande, est organisation, dépendances, rapports.
* * *
Voilà donc quels peuvent être, à un premier degré (car cela va bien plus loin encore) les pouvoirs de la langue et de la description.
Mais ce qu’il faut observer aussi (et c’est là, me semble-t-il, un fait de première importance), c’est le démenti qu’un texte comme celui‑là apporte à la timide proposition de Tynianov qui, cherchant à imaginer une nouvelle forme de roman, ne peut concevoir que des descriptions “ statiques ” et “ accumulées ”.
Je reviendrai sur le concept d’accumulation. Quant au “ statique ”, on voit encore par là à quel point l’illusion réaliste a pu marquer les esprits, puisque même une intelligence comme celle de Tynianov ne parvient pas à s’en dégager.
Car tout se tient : si, en effet, l’écriture est censée “ représenter ” (thèse des “ réalistes ”), alors il est bien certain que la “ représentation ” par la langue d’un objet immobile (comme par exemple un poisson cuit) ne peut être aussi, en toute logique, qu’immobilité ou, en d’autres termes, “ statique ” …
Or, bien au contraire, ce que nous montre Proust (et en ceci il apparait comme le grand écrivain revolutionnaire du XXe siècle, l’écrivain véritablement sub-versif, c’est-à-dire renversant sens dessus-dessous l’optique romanesque traditionnelle), c’est le prodigieux dynamisme de la description qui, littéralement, projette autour d’elle, comme une pieuvre, des tentacules dans toutes les directions, sélectionne et convoque des matériaux, les assemble, les organise.
Et dès lors s’ouvrent de tout autres perspectives, car on voit nettement que, dans le roman, il existe deux sortes d’actions, et par conséquent de sens :
d’une part l’action de la fable, l’histoire racontée qui établit des rapports de causes à effets entre des événements fictifs (sujets donc à caution), rapports découlant d’un projet préexistant à l’écriture;
d’autre part l’action de la description qui, entre l’objet, le lieu ou le personnage décrit et d’autres objets, d’autres lieux, d’autres personnages, établit dans et par la langue des rapports dont découlera un sens (ou plutôt du sens) que j’appellerai sens produit.
Il n’est pas, j’imagine, besoin d’insister pour montrer à quel point ces deux types d’action s’opposent, et d’abord sur le plan de la fiabilité, car s’il m’apparaît irrécusable (et profondément significatif) que le squelette du poisson de Proust sorti de l’immensité de la mer et du fond des âges soit rigoureusement structuré et évoque le plan d’une cathédrale (“ vaste ” nef ou navire), par contre, tel ou tel événement simplement relaté et non décrit dans le même ouvrage (la mort d’Albertine, par exemple, tuée fortuitement dans un accident de cheval) me parait simplement possible et très exactement in-signifiant, ne serait-ce que parce qu’on fait là appel à ma seule crédulité : d’où la seconde définition que donne le dictionnaire de ce mot fable judicieusement employé par Tynianov et qui est la suivante : “ récit faux, imaginaire ”, de même qu’aujourd’hui toute information publique ou privée qui semble fantaisiste, abusivement déformée ou tendancieuse, fait aussitôt dire aux gens avec un haussement d’épaules : “ C’est du roman !… ”.
* * *
à juste titre, donc, il ne semble plus possible à Tynianov de s’intéresser à des “ fables ”. Toutefois, abusé par le vocabulaire des prétendus réalistes, il ne parait pouvoir imaginer d’autre solution pour le roman qu’une fable prétexte à une accumulation de descriptions statiques, ce qui, il faut le dire, ressemble fort à une solution de désespoir.
Pourtant, dans le même essai, il a formulé, peu avant, une autre proposition beaucoup plus suggestive et qui est celle‑ci :
“ J’appelle fonction constructive d’un élément de l’oeuvre littéraire comme système, sa possibilité d’entrer en corrélation avec les autres éléments du même système et par conséquent avec le système tout entier ”.
Et cette proposition me semble capitale car, en quelques mots, elle ouvre au roman de tout autres perspectives et le fait accéder à une tout autre dimension que celle d’une fable plus ou moins amplifiée, plus ou moins ornée : à la conception traditionnelle qui veut que le roman ne soit qu’une simple succession d’événements entrecoupés de descriptions décoratives accumulées, il oppose maintenant la notion de système, c’est-à-dire, précisément, celle d’un vaste ensemble de rapports et de jeux de miroirs.
Je viens d’essayer de montrer, avec le poisson de Proust, comment |p19 fonctionne activement ou, si l’on préfère, comment, au premier degré, peut agir une description. Mais ce n’était là qu’un examen très superficiel de quelques‑unes des propriétés de ce micro-texte aux multiples implications qui, en fait, semble bien être une véritable “ mise en abîme ” de l’oeuvre tout entière à laquelle renvoient chacune de ses composantes, c’est-à-dire que le réseau de rapports que tisse Proust entre le poisson et un certain nombre d’images ou de concepts étrangers à son contexte immédiat dans l’espace et le temps est un réseau qui, par l’effet d’une série de dérapages et de métaphores, le rattache à plusieurs des principes constitutifs de l’oeuvre tout entière, y compris la construction de celle-ci.
Entrer dans le détail de ce dispositif et en faire une analyse poussée, comme le l’ai tenté ailleurs, nous entraînerait trop loin. Sans m’y attarder, donc, je crois qu’il n’est cependant pas inutile de signaler, très sommairement, ce qui m’apparaît comme les principaux points d’ancrage, soit :
1) l’importance toute particulière dans Les jeunes Filles de l’élément marin :
déception éprouvée par Proust lorsqu’il découvre que contrairement à ce qu’il avait imaginé d’après les descriptions de Swann et de Legrandin l’église de Balbec n’est pas “ battue par les flots ” (ce pourquoi non seulement il nous dira que pour pouvoir aimer Balbec et afin de garder l’idée qu’il se trouve sur la pointe extrême de la terre il s’efforce de ne voir que la mer, mais encore il édifiera de toutes pièces et avec une extraordinaire abondance de termes d’architecture sacrée son église de Balbec, sous la forme de cette cathédrale qu’est le Grand Hôtel de la Plage, bati sur ce que l’on appelle un “ front de mer ”, et où celle-ci est perçue sans cesse, soit à travers les baies, soit encore qu’elle y pénètre par tout un jeu de reflets.
2) Albertine passion/poisson :
de même que le Christ miraculeux représenté sur l’un des vitraux de l’église de Balbec tiré de la mer par les pêcheurs, Albertine (Christ/Itchys/poisson) qui sera sa passion dans le double sens du terme, apparaît pour la première fois à Proust sur fond de mer, de même que Sant-Loup qui, en un certain sens, redouble Albertine dont, en outre, Proust dira très expressément qu’il l’a pêchée comme un poisson. à signaler sur ce point les troublantes parentés entre la description de ce “ vaste poisson ” et celle que fait Proust dans son Sainte-Beuve de la |p20 fameuse (et fort suggestive) raie de Chardin, description reprise ici à peu près mot pour mot.
3) enfin l’organisation générale de l’oeuvre :
On sait en effet qu’à plusieurs reprises Proust a dit qu’il voulait composer La Recberche sur le plan d’une cathédrale.
Ainsi s’établit un vaste système d’échos (ce que Baudelaire appelait les “correspondances” ) qui montre bien (lorsqu’on s’aperçoit que l’oeuvre de Proust est sans cesse le lieu de tels dispositifs) que l’on se trouve ici non plus en présence d’une simple accumulation mais, à l’opposé, d’une combinatoire.
Et enfin, je hasarderai une proposition : ne serait‑il pas possible en effet, en partant de l’impulsion donnée par Proust et du rôle sans précédent que joue chez lui la description, ne serait‑il pas possible de concevoir un système romanesque entièrement inversé, c’est-à-dire où la description deviendrait pour tout de bon cet “ élément principal ” dont parle Tynianov, en ce sens qu’au lieu d’en être simplement le “ prétexte”, l’action en serait au contraire le résultat, serait engendrée par elle et, dès lors, nécessaire, incontestable et non plus fortuite?
Soit, par exemple, ces lignes de Faulkner, dans la dernière partie de The Sound and the Fury :
a man in a dirty apron came to the door and emptied a pan of dishwater with a broad gesture, the sunlight glinting on the metal belly of the pan, then entered the car again.
Il y a deux façons de lire ce petit texte :
Première lecture : la lecture traditionnelle. Dans cette optique, ce qui importe (ce qui a un sens), nous savons que c’est l’action : homme apparaissant sur la porte d’un wagon, vidant un chaudron et rentrant à l’intérieur. Mais alors, pourquoi nous ennuyer, “ ralentir ” l’action, avec ce petit détail visuel insignifiant qu’est l’éclat du soleil sur le flanc du récipient? Que nous importe! et, comme le dit André Breton dans le Premier Manifeste du Surréalisme, de quel droit l’auteur vient‑il ainsi nous ennuyer en “ nous refilant ses cartes postales ” ?…
Mais (deuxième façon de lire ces lignes) imaginons au contraire que ce qui importait à Faulkner c’était, avant tout, d’écrire ce bref scintillement de soleil.
Et alors tout change! Parce que pour que ce scintillement ait lieu (ce scintillement qui, en un éclair, amène à notre conscience l’ensemble de la nature, de l’univers, la conjoncture qui fait que par le biais d’un angle d’incidence un rapport s’établit entre l’observateur, l’homme qui vide le chaudron, la rotation de la terre, la position du soleil à cet instant précis) … pour que ce scintillement ait lieu, donc, il faut l’homme, il faut le chaudron, il faut le geste, il faut cette micro‑action qui se trouve du coup indispensable, justifiée, générée par la description, comme le signifie bien la conjonction then montrant clairement que l’ “ événement principal ” c’est bien, en fait, cet éclat de soleil en fonction duquel tout ce petit scénario semble avoir été monté, car c’est seulement alors, après que ce scintillement a eu lieu, que l’homme a le droit de rentrer dans le wagon, à la façon de ces personnages des horloges astronomiques qui sortent de leurs niches ou les réintègrent à un moment précisément détermine par la position des astres : maintenant, Faulkner n’a plus besoin de lui …
* * *
Cet exemple, me semble-t-il, nous éclaire mieux que toute théorie sur la nature de l’écrit littéraire, car si, dans ces lignes, on supprime “ dirty apron ”, “ broad gesture ”, “ sunlight glinting ” et l’articulation “ then ”, il ne reste plus, alors, qu’une simple information. C’est dans la langue travaillée, dans l’unité phrasique où jouent et s’ordonnent tout ensemble les sens, le rythme et ce que l’on a appelé “ un rapport de solidarité réciproque ” que chez Faulkner, comme chez Proust, sont liés tout ensemble la nature, l’homme et les choses.
* * *
Voilà, en gros, quelques-unes des considérations qui ont joué un rôle dans la conception que, peu à peu, je me suis faite du roman, conception d’ailleurs beaucoup plus fondée sur une pratique et un certain sentiment de la littérature que sur des théories abstraites …
Il m’est souvent arrivé de dire que mon travail me semble s’apparenter à ce que l’on pourrait appeler, en employant le vocabulaire des mathématiques, l’exploration des propriétés des figures (ou, si l’on préfère, des images).
Et par le mot “ propriétés ”, j’entends ceci : quelles autres figures (ou images) telle figure (ou telle image) donnée a-t-elle le pouvoir de faire surgir, d’amener à l’esprit, soit par harmoniques, associations, assonances ou, au contraire, dissonances, contrastes, oppositions ? Et quelles autres images encore vont, à leur tour, être “ convoquées ” par les premières images suscitées, la suite des opérations effectuées sur ces ensembles d’images ainsi obtenues pouvant être à son tour assez bien définie par cet autre titre d’un chapitre des mathématiques qui est : “ Arrangements, Permutations, Combinaisons ”.
Par exemple, toute La route des Flandres a été écrite à partir de l’image initiale, restée gravée dans ma mémoire, du colonel de mon régiment tué en 1940 à quelques mètres de moi et s’écroulant avec son cheval en brandissant son sabre. Cette image (et les mots employés pour la décrire) en ont fait se lever une quantité d’autres dont les combinaisons, les reflets, les “ correspondances ”, ont fini par composer un roman, une action.
Seulement, au contraire du roman traditionnel où tout est mis en oeuvre pour faire oublier au lecteur que cette action ainsi que les personnages sont fictifs, faits de mots, celle-là et ceux-ci sont, dans La route des Flandres, donnés seulement pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire, exactement et au sens propre du terme, les produits de la langue, du discours…
Toute l’action, en effet, que ce soit l’histoire de Reixach, de Corinne et du jockey, que ce soit celle, qui la redouble, de la mort de l’ancêtre de Reixach, n’est faite que des supputations de Georges et de Blum qui la remettent sans cesse en question, élèvent de constantes objections, l’un disant sans cesse à l’autre : “ Mais peux‑tu affirmer que c’est bien comme cela que les choses se sont passées. Est-ce que tu ne fabules pas? Est‑ce que cela n’a pas pu se passer au contraire de telle ou telle autre façon tout à fait différente? etc …, etc … ” ‑ et il n’est pas jusqu’à l’action elle‑même vécue par le narrateur qui ne soit contestée, mise en doute, puisque les dernières pages du roman (où Georges raconte la marche de Reixach vers sa mort) sont ponctuées à plusieurs reprises par la question que Georges se pose à lui-même, mettant en doute la justesse de sa propre perception, de sa mémoire : “ Mais comment était-ce, comment était-ce, comment savoir ? ”.
Autrement dit, constamment et avec insistance, la fiction se dénonce elle-même comme fiction, met à nu son élaboration et se présente pour ce qu’elle est, c’est‑à‑dire une transposition subjective, incertaine, et pouvant être contestée.
La “ réalité ” de ces personnages, de cette action, c’est, comme pour les Nymphéas de Monet ou l’Albertine de Proust, la “ réalité ”, incontestable celle‑la (que ce soit en bien ou en mal), du médium (couleurs, formes, mots) qui les instaure, autrement dit, ce style qui selon la parole de Flaubert, est “ une manière absolue de voir les choses ”.
En résumé, je dirai ceci : il me semble (comme il semble à quelques autres) que le temps est passé du romancier qui se posait en observateur privilégié, sorte d’homme‑orchestre, de dieu omniprésent qui connaît tout, voit tout, sait tout.
D’autre part, je ne suis ni philosophe, ni psychologue, ni sociologue, et n’ai donc pas de “ message ” particulier à délivrer par l’intermédiaire d’une fable. Dans ce sens, je n’ai donc rien à dire alors que, par ailleurs, ma mémoire est remplie d’un désordre, d’un chaos d’innombrables images, d’innombrables souvenirs de gens, de choses, d’événements.
Et encore ceci : ce que je ressens (comme, je pense, le ressent tout écrivain) c’est, avant tout, l’envie d’écrire ‑ ou le besoin : comme l’on voudra. Ecrire pour écrire ‑ de même que le peintre, ressent avant tout le besoin de peindre pour peindre, d’étaler des couleurs sur une toile.
De plus, si jamais j’ai un projet, une vague idée préalable d’un roman, ce projet a chaque fois subi, au cours de mon travail, de telles modifications ou plutôt de tels bouleversements, qu’à la fin il n’en subsiste presque rien. “ je n’ai jamais fait le tableau que je voulais faire ”, a dit Picasso ‑ et Raoul Dufy que j’ai bien connu, me disait aussi : “ Il faut savoir abandonner le tableau que l’on voulait faire au profit de celui qui se fait ”.
Que ce soit donc en peignant ou en écrivant (et, je suppose, en faisant de la sculpture ou en composant de la musique) quelque chose se fait. Quelque chose d’imprévu au départ et qui est le résultat du travail du peintre ou de l’écrivain aux prises avec leur matériau dont les contraintes et les pouvoirs à la fois gauchissent leurs actions et les enrichissent.
Il y a plus de quinze ans déjà que j’ai dit dans une interview : “ Le roman se fait, je le fais et il me fait ”.
Car il y a un constant dialogue, un constant va‑et‑vient entre l’impulsion première donnée par l’écrivain et les résistances que lui oppose la langue en même temps que les propositions qu’elle lui fait au fur et à mesure qu’il progresse pas à pas à partir d’un quelconque point de départ, d’un premier “ stimulus ” qui, pour moi, est presque toujours constitué par quelque image, soit qu’elle m’ait particulièrement frappé (comme celle de la mort de mon colonel ou encore, pour Les corps conducteurs, le tableau de Rauschenberg intitule Charlène qui se trouve au musée municipal d’Amsterdam), soit que je me mette à écrire en décrivant simplement ce qui se trouve devant mes yeux au moment ou j’écris, comme l’arbre dont les branches touchaient presque ma fenêtre pour Histoire, ou le vol d’un pigeon dont l’ombre passe rapidement sur mon visage, pour La bataille de Pharsale.
Mais peut-être me ferai-je mieux comprendre en prenant pour exemple le dernier roman que j’ai publié, Leçon de choses, et en en racontant l’histoire, c’est-à-dire comment l’idée m’en est venue, comment elle s’est développée, enrichie peu à peu, et à quoi cela m’a mené.
Il y a environ cinq ans, alors que j’avais déjà commencé à travailler au gros ouvrage que je suis en train de terminer, j’ai reçu une lettre de la galerie Maeght qui publie aussi des éditions d’art, me demandant si, dans le cadre d’une série de lithographies intitulée “ Placards ”, je voudrais écrire “ quelques lignes ” qui seraient illustrées par un peintre, en l’occurrence Alechinsky.
Or, pas plus que je ne suis philosophe ou sociologue, je ne suis ni poète, ni faiseur d’aphorismes, et après avoir imprudemment donné mon accord, je me suis demandé ce que je pourrais bien écrire, moi, romancier, en “ quelques lignes ”.
En désespoir de cause, j’ai eu alors l’idée de décrire une pièce à ce moment à-demi en ruine qui se trouvait dans une maison que je possède à la campagne et où je faisais procéder à des réparations.
Cela a donné un texte d’une page et demie environ et qui se terminait par les lignes suivantes :
“ La description (la composition) pourrait se continuer (ou être complétée) à peu près indéfiniment selon la minutie apportée à son exécution, l’entraînement des métaphores, l’addition d’autres objets (…) sans compter les diverses hypothèses que peut susciter le spectacle ”.
Ce qui s’est passé ensuite a été curieux : c’est qu’une fois envoyé ce petit texte à Maeght, la phrase par laquelle il se terminait a commencé à agir sur moi en ce sens que des métaphores issues de cette description ou impliquées par elle surgissaient des séries d’images qui se sont groupées pour produire, comme dans Triptyque (mais avec cette différence qu’elles sortaient toutes d’un même moule), trois petites fictions qui étaient comme trois variations sur le même thème : celui de la pièce en ruines où pouvaient se trouver :
1) quelques soldats arrêtés là au cours d’une retraite et utilisant la maison comme point fortifié ;
2) un groupe de promeneurs qui figure sur une reproduction de Renoir restée punaisée au mur ;
3) deux maçons en train de procéder à des travaux.
J’ai parlé de thème et de variations : effectivement tout le livre s’est construit peu à peu sur le modèle d’une fugue en contrepoint telle que la définit le dictionnaire Littré, c’est-à-dire :
“ composition de musique ainsi dite parce que des phrases semblables, se présentant successivement dans toutes les parties semblent se fuir et se poursuivre tour à tour ”.
Mais ce qui me paraît intéressant et bien montrer comment l’esprit de l’homme qui travaille la langue est en même temps travaillé par elle, c’est que, alors que j’écrivais les dernières pages, je me suis soudain rendu compte que ces diverses fictions ou variations ainsi que leurs divers épisodes m’avaient en quelque sorte été dictées par les mots (et principalement l’un d’eux) qui avaient servi à la première description.
Pour ne pas donner lieu à des malentendus, je dois bien souligner que j’ai fait cette découverte alors que j’en avais presque terminé, que c’est à mon insu que ce phénomène s’est produit et qu’il n’a été en rien le résultat d’une expérience systématique du genre de celles que Roussel a mis en oeuvre.
En ouvrant donc un jour, pour je ne sais plus quelle raison, le dictionnaire Littré au mot chute j’ai ainsi pu lire :
1) Le fait de choir, de tomber. Ex : une chute de cheval, de bicyclette (dans le roman, l’un des soldats, un cavalier, dégringole pêle‑mêle avec son cheval dans une profonde tranchée de chemin de fer).
2) Le fait de s’écrouler. Ex : chute d’un pan de mur, d’un rocher (des plâtras, des pierres se détachent et tombent sur le sol dans la pièce où travaillent les deux maçons. Le pan de mur qu’ils démolissent s’écroule sur l’un d’eux. Un pan de falaise s’écroule dans la mer (falaise représentée sur une reproduction restée punaisée au mur de la pièce). Le plafond de la pièce où se trouvent les soldats s’écroule également.
3) Le fait de tomber. Lois de la chute des corps. Ex : la chute d’une bombe. Le point de chute : point atteint par le projectile à la fin de sa trajectoire (Un obus tombe à côté de la maison dans laquelle se fortifient les soldats).
4) Par extension : La chute du jour. Voir : Tombée, fin (Fin de la promenade, fin de la journée de bataille ou plutôt d’attente de la bataille, tandis que la nuit tombe … ).
5) Prise. La chute d’une place forte, d’une ville assiégée. (ce qui va très vraisemblablement arriver à la maison fortifiée).
6) Action de tomber moralement. Voir : Déchéance, faute, péché. Ex : La chute d’Adam; chute d’une femme (L’une des promeneuses séduite), etc.
Et puis, à la fin, Littré donne encore une autre définition du mot chute. Elle a trait, cette fois, à son acception littéraire : la chute d’une période, d’une phrase musicale : la partie finale sur laquelle tombe la voix. Voir Cadence, ajoute‑t‑il.
Et ce n’est sans doute pas là le moins important.
Car lorsque tout à l’heure j’ai parlé de rapports irrécusables établis dans un texte et que je les ai justifiés seulement par des considérations de sens, j’ai passé sous silence la référence qui constitue peut-être, en définitive, la garantie des garanties, et faute de quoi toutes les autres considérations, toutes les autres analyses ne peuvent être, au mieux, que des travaux d’approche, du déblayage, mais négligeant l’essentiel, la question que Flaubert posait en ces termes : “ …pourquoi y a‑t‑il un rapport nécessaire entre le mot juste et le mot musical ? (…) La loi des nombres gouverne donc les sentiments et les images ?… ”.
* * *
De plus qualifiés que moi pourront sans doute répondre de façon satisfaisante à cette question. Pour ma part, je peux seulement dire que je partage sans restriction avec Flaubert cette même conviction que la musique, le rythme d’un texte, ces qualités en somme dites purement “ formelles ” de la matière littéraire, sont, en définitive, ses plus sûrs garant.
BIBLIOGRAPHIE
1. Tynianov J. : De l’évolution littéraire, ds : Théorie de la littérature, Textes des Formalistes russes, présentés par T. Todorov, Paris, Seuil, 1965, p. 126.
2. La Fontaine J., Fables, Contes et Nouvelles, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1948, Prétace, p. 11.
3. Simon Cl., Orion aveugle, Paris, Skira, 1970.
4. Chklovski V., L’art comme procédé, ds : Théorie de la littérature cit., p. 94.
5. Proust M., à la recbercbe du temps perdu, Paris, Gallimard, IV, p. 122‑123.
6. Tynianov J., op. cit., p. 123.
7. Faulkner W., The Sound and tbe Fury, London, Penguin Modem Classic, 1970, p. 273.
8. Simon Cl., La Route des Flandres, Paris, Minuit, 1960.
9. Simon Cl., Les corps conducteurs, Paris, Minuit, 1971.
10. Simon Cl., La Bataille de Pbarsale, Paris, Minuit, 1969.
11. Simon Cl., Histoire, Paris, Minuit, 1967.
12. Simon Cl., Leçon de choses, Paris, Minuit, 1975.