pas des hommes et pourtant des hommes
Par cgat le lundi 26 octobre 2009, 01:42 - écrivains - Lien permanent
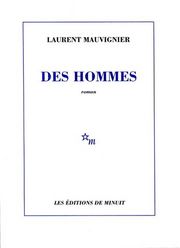
Il a le temps de réfléchir aussi, pas seulement aux derniers événements, au cadavre du médecin, à Châtel, qui est de plus en plus renfrogné et ne parle plus à personne. Il pense aux Algériens ; il se dit que depuis qu'il est ici il ne connaît que la petite Fatiha, pas même ses parents, que la population est pour lui comme pour les autres une sorte de mystère qui s'épaissit de semaine en semaine, et il se dit que, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi, il a peur.
Il ne sait rien, et, tout seul, en se promenant le matin très tôt dans Oran, cette idée lui fait honte.
Plus le temps passe, plus il se répète, sans pouvoir se raisonner, que lui, s'il était Algérien, sans doute il serait fellaga. Il ne sait pas pourquoi il a cette idée, qu'il veut chasser très vite, dès qu'il pense au corps du médecin dans la poussière. Quels sont les hommes qui peuvent faire ça. Pas des hommes qui font ça. Et pourtant. Des hommes. Il se dit pourtant parfois que lui ce serait un fellaga. Parce que les paysans qui ne peuvent pas travailler leur terre. Parce que la pauvreté. Même si certains lui disent qu'on est là pour eux. On vient donner la paix et la civilisation. Oui. Mais il pense à sa mère et aux vaches dans leurs champs, il pense aux nuages épais et lourds dont les ombres tombent sur le dos des bêtes et dans le ruisseau, sur les peupliers. Il pense à son père et à sa mère qui mettaient leurs mains devant leurs bouches de bébés, lui a-t-on répété, à lui et à ses frères et sueurs aussi, lorsque tout le hameau abandonnait les fermes pour se cacher dans des trous creusés par les obus et qu'on entendait les pas des Allemands tout près. Il pense à ce qu'on lui a dit de l'Occupation, il a beau faire, il ne peut pas s'empêcher d'y penser, de se dire qu'ici on est comme les Allemands chez nous, et qu'on ne vaut pas mieux.
Il pense aussi qu'il serait peut-être harki, comme Idir, parce que la France c'est quand même bien, se dit-il, et puis que c'est ici aussi, la France, depuis tellement longtemps. Et que l'armée c'est un métier comme un autre, sur ça Idir a raison, être harki c'est faire vivre sa famille alors que sinon elle crèverait de faim.
Mais il pense aussi que peut-être tout ça est faux. Qu'il ne faudrait croire personne. Qu'on ment partout. Il pense depuis toujours qu'on lui ment. Quelque chose, qui ment. Partout. Jusqu'à lui donner l'envie de vomir et de retourner tout ce qui est le monde devant lui. Il a presque envie de pleurer. Il ne sait pas pourquoi. Pourquoi le cafard et la mélancolie. Alors qu'aujourd'hui. Quatre jours. Et Mireille comme unique horizon de ces quatre jours. (p. 201-202)Et je me souviens de la honte que j'avais lorsque j'étais rentré de là-bas et qu'on était revenus, les uns après les autres, sauf Bernard - il se sera au moins évité l'humiliation de ça, revenir ici et faire comme on a fait, de se taire, de montrer les photos, oui, du soleil, beaux paysages, la mer, les habits folkloriques et des paysages de vacances pour garder un coin de soleil dans sa tête, mais la guerre, non, pas de guerre, il n'y a pas eu de guerre ; et les photos, j'ai eu beau les regarder encore et en chercher au moins une seule, une seule qui aurait pu me dire, C'est ça, la guerre, ça ressemble à ça, aux images qu'on voit à la télévision ou dans les journaux et non pas à ces colonies de vacances, ni non plus à ces gens qui remplissent les rues d'Oran, et les magasins ouverts, la circulation dans la ville, et alors, pourquoi sur les murs que j'avais photographiés je n'ai pas trouvé un seul graffiti disant l'Algérie vaincra, pas un mur peint, gratté, poncé, repeint, pas un graffiti, pas une arme, rien, et pas autre chose que ce vide et ce beau temps monstrueux de soleil et de ciel bleu.
Les photographies de la mer.
Tous les gars sur le pont en train de fumer et de regarder la ligne d'horizon, brumeuse, lointaine - ou au contraire, dans la nuit, le vacarme des machines et du vent, l'étonnement que c'est pour un paysan de savoir l'hélice hors de l'eau, comme si le bateau allait s'envoler et son fracas lorsqu'il retombe, le sol si instable et mouvant.
Sur certaines photos, c'est seulement le flou dans le lointain, sans qu'on puisse deviner alors si c'est l'arrivée ou le départ. La seule chose dont je me souvienne, c'est que la première fois où j'ai vu la mer c'était à Marseille, le temps était froid et gris, et j'allais embarquer pour l'Algérie. (p. 261-262)Peut-être que ça n'a aucune importance, tout ça, cette histoire, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une histoire tant qu'on n'a pas soulevé celles qui sont dessous et qui sont les seules à compter, comme les fantômes, nos fantômes qui s'accumulent et forment les pierres d'une drôle de maison dans laquelle on s'enferme tout seul, chacun sa maison, et quelles fenêtres, combien de fenêtres ? Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il faudrait bouger le moins possible tout le temps de sa vie pour ne pas se fabriquer du passé, comme on fait, tous les jours ; et ce passé qui fabrique des pierres, et les pierres, des murs. Et nous on est là maintenant à se regarder vieillir et ne pas comprendre pourquoi Bernard il est là-bas dans cette baraque, avec ses chiens si vieux, et sa mémoire si vieille, et sa haine si vieille aussi que tous les mots qu'on pourrait dire ne peuvent pas grand-chose. (p. 270)
Laurent Mauvignier, Des hommes (Minuit, 2009)
D’abord je n’ai pas aimé ce livre, l'ai trouvé trop à l'estomac, puis je me suis laissée prendre par sa construction en spirale (la blessure de la guerre au cœur de l’unité de temps - après-midi, soir, nuit, matin – tragique) et la superposition des monologues circulaires d'hommes pareillement blessés qui ne débouchent sur aucune conclusion ni résolution, mais sur une question : « je voudrais savoir si l’on peut commencer à vivre quand on sait que c’est trop tard. » (p. 281, les derniers mots).
Et lorsqu’ensuite j’ai lu la description par Mauvignier de ce qu’il souhaitait faire dans l’entretien avec Nelly Kaprièlian (Les Inrockuptibles, 8 septembre 2009) qui est repris sur la page des éditions de Minuit, j’ai trouvé que le pari était réussi :
« J’ai essayé d’écrire de la littérature qui dise quelque chose sans renoncer à ce qu’a été le XXe siècle formellement. Je sais que beaucoup de gens n’acceptent pas le rapport à l’émotion et aux clichés en littérature, alors qu’ils le font sans aucun problème au cinéma. C’est comme s’il y avait un machisme littéraire : l’émotion et les sentiments, c’est bon pour la littérature populaire, c’est des trucs de femme, il faut s’en méfier. Alors qu’au cinéma, les meilleurs cinéastes ne se posent pas la question. »
Laurent
Mauvignier est né en 1967. Il a publié :
- Loin d'eux (Minuit, 1999)
- Apprendre à finir (Minuit, 2000) Prix Livre Inter 2001
- Ceux d'à côté (Minuit, 2002)
- Seuls (Minuit, 2004)
- Le Lien (Minuit, 2005)
- Dans la foule (Minuit, 2006) Prix du roman Fnac 2006
- Des hommes (Minuit, 2009)
Commentaires
J'aime cette prise de position, dans l'entretien.
J'ai fortement aimé ce roman, merci d'éclairer ce sentiment.
Suis totalement d'accord avec ce qu'il dit : ce qu'on appelle cliché en littérature, qui passe fort bien au cinéma, l'émotion ... Un livre magnifique. (mais l'accusation de "cliché" est devenu le plus petit dénominateur commun de nombre de ces - mauvaises - "critiques")
Un excellent premier film, de Laurent Herbiet (2006), avec notamment Robinson Stévenin, a été diffusé sur Arte le 22 octobre.
Sujet : la torture pendant la guerre d'Algérie.
Et la force du film est ici dans l'absence de pathos - mais pas de l'émotion - ce qui prouve que cela est compatible également au cinéma.
Le titre : "Mon colonel" (avec aussi Olivier Gourmet et Cécile de France).