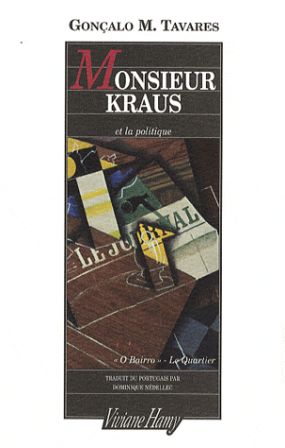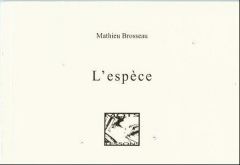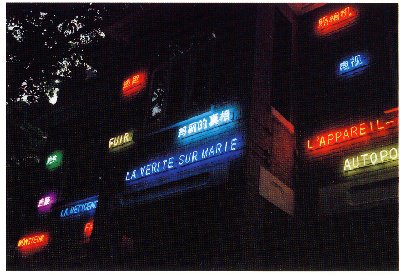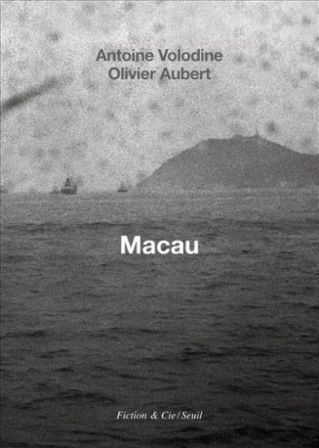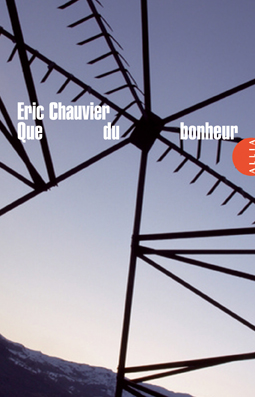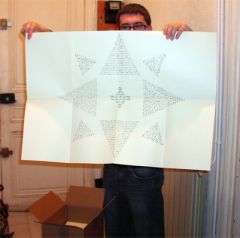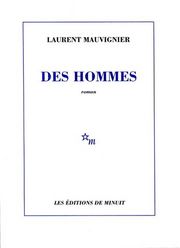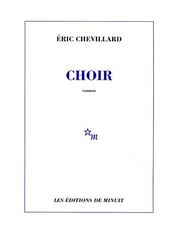
Il y a beau temps que les esprits éclairés en ont fini avec ces simagrées de poésie. Nous préférons modeler dans la glaise - nous baisser où que nous soyons, ramasser une poignée de Choir et malaxer la matière ici appelée glaise abusivement, mais qui sera de toute façon suffisamment visqueuse et malléable - des copies scrupuleuses de la statue de Yoakam - on trouve même des yeux de poisson dans cette colle -, mais il ne saurait ici être question d'art, entendons-nous bien, ce sont des prières, des rites d'adoration que nous exécutons sans regarder nos mains, le regard tourné vers le ciel. Est-ce Ilinuk enfin, cette blancheur immaculée qui descend sur Choir ? Puis nous baissons les yeux : est-ce la blanche clarté d'Ilinuk qui s'étend maintenant sur Choir ? Hé non ! (p. 104)
Nos artistes sont finalement mieux récompensés de leur peine. Suspendus par la taille à une corde fixée à un mât puis poussés avec force contre un mur blanc sur lequel ils s'écrasent et rebondissent une fois, deux fois, trois fois, les artistes ensanglantés exécutent là, avec leurs tripes aussi bien qu'avec leur tête, des fresques qui ne nous laissent pas insensibles. Si elles ne nous tirent pas des larmes non plus. (p. 161)
Nous travaillons la pierre avec obstination, avec rage, dans le but d'user nos outils, puis nos ongles donc, mais animés surtout par la volonté de parsemer Choir de ruines désolantes. Car jamais nous n'achevons nos constructions - nous n'allons tout de même pas nous installer à Choir ! -, nous les livrons en chantier aux araignées et aux punaises, aux chauves-souris, aux hiboux, aux champignons, aux mousses, aux orties. Sous la lune, Choir paraît presque abandonnée. Nous avons beau savoir - et pour cause (nous sommes tapis derrière les blocs) - qu'il n'en est rien, ce songe fugace nous emplit l'âme d'une joie sauvage. (p. 228)
Nous expérimentons sur une brebis des remèdes à ces lourdeurs de tête et d'estomac qui font de nous des êtres si pesants, créatures des boues et des poussières. Nous lui coupons une première patte : la voici déjà moins assujettie au sol. Nous lui coupons une deuxième patte, et c'est une déception : la brebis s'affaisse (quelle que soit la patte choisie). Hypothèse la plus vraisemblable, que nous devons à Nganamba : dans le feu de nos recherches, nous n'avons pas attendu suffisamment avant de pratiquer la deuxième amputation. La brebis - qui n'est pas un aigle - a défailli, effrayée par cette légèreté nouvelle, le vertige de cet infini qui soudain s'ouvrait pour elle. Il lui faut du temps entre chaque opération afin qu'elle s'adapte ; et il en faudra davantage encore lorsque nous en serons à l'amputation de sa dernière patte, l'ultime amarre. Si l'expérience se révèle concluante, et le contraire serait étonnant, alors nous ouvrirons le protocole à des volontaires humains. Tous les habitants de Choir se sont déjà portés candidats. (p. 229)
Éric Chevillard, Choir (Minuit, 2010)
Quelques citations pour inviter ceux qui n'auraient pas encore découvert les sombres beautés de l'île de Choir a l'explorer au plus vite - et quelques liens vers des critiques, des vraies :
::: « Éric Chevillard : Choir « sans intention » — mais vers le haut ». Entretien avec Roger-Michel Allemand (@nalyses)
::: trois billets chez Didier da Silva (halte là), ici, là
et là
::: Philippe
Annocque (hublots)
::: François
Bon (tiers livre)
::: Christophe
Claro (Le Clavier Cannibale II)
::: Erwan
Desplanques (Télérama)
::: Éric
Loret (Libération)
::: Patrick
Kéchichian (La Croix)
::: Isabelle
Rüf (Le Temps)
::: et aussi bien sûr L’autofictif, le blog d’Éric Chevillard, dont le deuxième volume de l’édition papier L’autofictif voit une loutre, vient aussi de paraître aux éditions de L’Arbre vengeur.