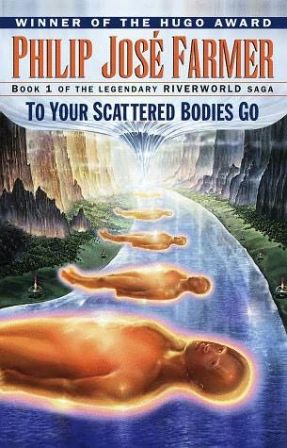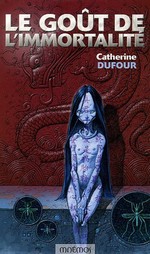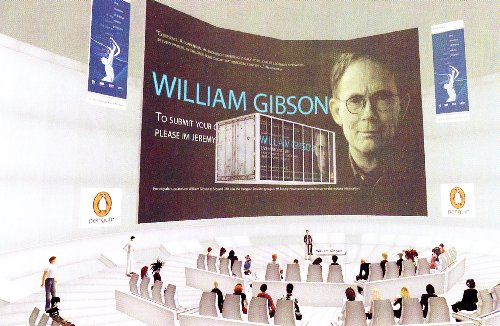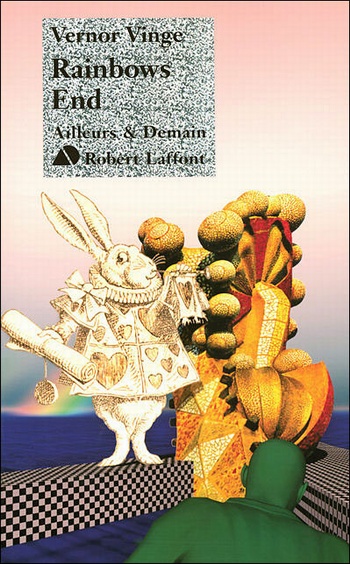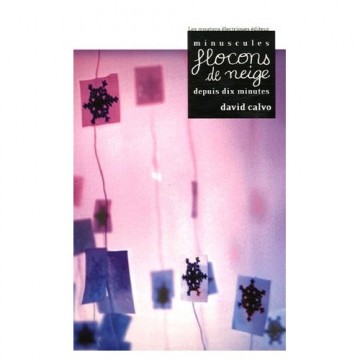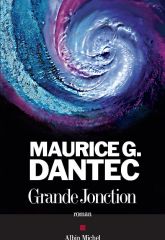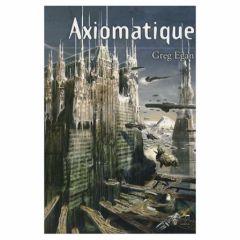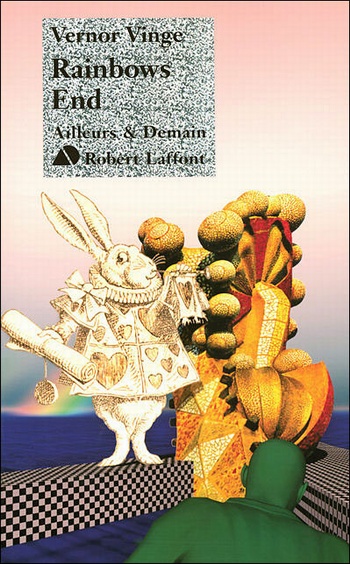
Robert franchit la porte entrouverte et jeta un coup d'œil autour de lui. Ce
n'était pas le cinquième étage de la Bibliothèque Geisel sur la planète Terre.
Il y avait bien des livres, mais c'étaient des objets démesurés, posés sur des
étagères en bois qui semblaient s'élever à l'infini. Robert pencha la tête en
arrière pour regarder. Les lumières violettes montaient le long des étagères et
nimbaient leurs montants tordus. Cela ressemblait un peu à ces forêts fractales
qu'on voit dans les vieux dessins. À la limite de sa vision, il y avait encore
d'autres livres que la distance faisait apparaître minuscules. (...)
Robert posa une main sur une étagère pour se soutenir. Le bois semblait réel,
épais, solide. Il baissa les yeux et examina l'allée devant lui. Le passage
entre les étagères serpentait - et il ne se terminait pas au mur extérieur qui
devait se trouver là-bas, à une dizaine de mètres seulement. Au lieu des baies
vitrées normales, il y avait des marches en bois usées. C'était le genre de
menuiserie bricolée qu'il avait tant aimée dans les vieilles librairies de
bouquins d'occasion. Au-delà des marches, les étagères elles-mêmes semblaient
inclinées, comme si la pesanteur pointait dans une autre direction. (...)
Ils parcoururent lentement l'allée étroite. Il y avait des petites allées
latérales qui menaient non seulement de chaque côté, mais également vers le
haut et le bas. On y entendait parfois comme des sifflements de serpents. Dans
d'autres allées, Robert vit des « Chevaliers Gardiens » penchés sur
des tables couvertes de livres et de parchemins ; leurs visages étaient
éclairés par une lumière provenant des pages des livres ouverts. Des manuscrits
réellement enluminés... Robert s'arrêta pour en examiner un de plus près. Les
mots étaient en anglais, imprimés en caractères gothiques biscornus. C'était
apparemment un ouvrage sur l'économie. Un des lecteurs, une jeune femme avec
des sourcils broussailleux, jeta un bref coup d'œil aux visiteurs et agita la
main en l'air. En haut des étagères, on entendit un bruit sourd, et une dalle
de cuir et de parchemin de un mètre de large tomba sur eux en tournoyant.
Robert sauta en arrière et faillit marcher sur le pied de Tommie. Mais le livre
s'arrêta et se mit à flotter juste à portée de main de l'étudiante. Les pages
s'ouvrirent d'elles-mêmes.
Ah. Robert se retira prudemment de l'alcôve.
- J'ai compris. Ce sont les numérisations de ce qui a été détruit jusqu'à
présent.
- La première passe de numérisation, confirma Blount. Avec ça, ces salopards
d'administrateurs modernes ont eu plus d'articles élogieux dans la presse
qu'avec tout le reste de leur propagande. Tout le monde trouve que c'est
tellement astucieux et mignon. Et la semaine prochaine, ils vont déchiqueter le
sixième étage.
(…) Il y avait des livres devant et derrière eux, et aussi sur les côtés,
cachés dans des allées. Des livres au-dessus d'eux, comme des cheminées
disparaissant dans la lumière violette. Robert en voyait même au-dessous, là où
des échelles branlantes semblaient s'enfoncer dans les profondeurs. En
regardant les livres tout en détournant légèrement les yeux, les caractères sur
les dos et les couvertures semblaient dégager de la lumière noire, un violet
presque trop foncé pour qu'on puisse le voir, mais très net, avec les codes de
la Bibliothèque du Congrès qui ressortaient comme des runes mystérieuses. Les
livres étaient les fantômes - ou peut-être les avatars - de tout ce qui avait
été détruit.
Ils émettaient des bruits, des grognements, des sifflements et des
chuchotements. Des conspirateurs. Au fond des allées, certains livres étaient
enchaînés.
- Il faut faire attention à Das Kapital, dit Rivera.
Robert vit un des tomes - pour une fois, le terme est parfaitement
approprié ! - qui tirait sur ses chaînes, et les maillons cliquetaient
bruyamment contre les anneaux massifs scellés dans le mur.
- Ouais, le Savoir Dangereux brûle du désir d'être libre.
Certains livres devaient être de véritables accessoires en tâtouche. Dans une
allée, des étudiants finissaient d'empiler des volumes. Ils reculèrent et les
textes commencèrent à se frotter les uns contre les autres dans une orgie de
pages ouvertes.
- C'est ainsi qu'on procède à une synthèse bibliographique ?
Rivera suivit la direction de son regard.
- Heu, oui. Comme l'a dit le doyen Blount, ça a commencé par cette mascarade,
qui visait à gagner la faveur du public pour le projet de déchiquetage. Nous
présentons les livres sous forme de créatures presque vivantes, qui sont au
service de leurs lecteurs tout en les ensorcelant. Terry Pratchett, et Jerzy
Hacek après lui, ont joué de ce thème pendant des années. Mais nous n'avions
pas bien mesuré son pouvoir. Quelques-uns des meilleurs cercles de croyance en
Hacek nous aident dans l'opération. Chaque action sur la base de données a une
représentation physique ici, exactement comme dans les histoires des
Bibliothécaires Militants de Hacek. La plupart de nos utilisateurs considèrent
que c'est beaucoup mieux que les logiciels d'accès standard.
Winnie se retourna vers eux. Il était suffisamment loin devant pour paraître
rapetissé, comme s'ils l'observaient de très loin à travers un télescope. Il
fit un geste de dégoût.
- C'est cela la trahison, Carlos. Vous autres bibliothécaires n'approuvez pas
le déchiquetage, mais regardez ce que vous avez fait. Ces gamins vont perdre
tout respect pour l'enregistrement permanent de l'héritage humain.
Tommie Parker était derrière Robert. Il marmonna d'un air réjoui :
- Winnie, les gamins ont déjà perdu tout respect. Rivera baissa les yeux.
- Je suis désolé, doyen Blount. C'est le déchiquetage qui est criminel, pas la
numérisation. Pour la première fois de leur vie, nos étudiants ont un accès
moderne aux connaissances du pré-millénaire. (Il montra les étudiants au fond
de l'allée.) Et pas seulement ici. On peut accéder à la bibliothèque à partir
du réseau, sauf qu'on n'a pas les gadgets en tâtouche. Huertas a accordé un
accès limité gratuit, même pendant sa période de monopole. Ce n'est que la
première passe de numérisation, et il n'y a que HB à HX, mais nous avons eu
plus d'accès à nos archives pré-millénaires en une semaine qu'au cours des
quatre dernières années. Et une grande partie de cette nouvelle activité
provient de la faculté !
- Bande de salopards hypocrites, dit Winnie.
Robert observa les étudiants dans leur alcôve. Les ébats amoureux des livres
étaient terminés, mais ils flottaient maintenant au-dessus des étudiants et les
pages s'adressaient aux volumes non encore exploités en chantant d'une toute
petite voix. Une métaphore incarnée.
Vernor Vinge, Rainbows
End (2006, traduction française Robert Laffont, 2007, p. 211-215)
Rainbows End (publié dans l'une des collections de
« vraie » science-fiction les plus réputées, « Ailleurs &
Demain », dirigée depuis 1969 par Gérard
Klein) se déroule en 2025 sur le campus de l’université de San Diego.
L’informatique, omniprésente, a envahi la vie quotidienne : des vêtinfs en
textiles nanotechnologiques remplacent les ordinateurs personnels, des
lentilles de contact digitales reçoivent et projettent des mms ; chacun a
accès à toutes les informations du monde, peut visualiser les endroits les plus
éloignés, s’y transporter sous forme d’avatars plus ou moins élaborés, entrer
en contact à tout moment avec qui il le souhaite, etc. ; le projet
« bibliotome » prévoit la numérisation globale des connaissances
humaines, qui passe par la destruction complète et définitive de tous les
documents physiques et la constitution d'une base de données orientée
objet ; après le déchiquetage de tous les livres qu’elles contiennent, les
Bibliothèques sont relookées virtuellement de fort séduisante façon et peuplées
d’avatars ludiques des livres détruits.
Moins réussi à mon sens que La Captive du temps perdu (1986) ou Un feu sur
l’abîme (1992, Prix Hugo), car son côté thriller est assez raté (comme
l’écrit fort bien cette critique du Cafard cosmique), ce roman présente néanmoins de manière
très stimulante (car incarnée) les questions que posera une société du tout
numérique (avec ses virus, ses armes de destructions massives, ses loisirs et
ses intelligences artificielles - le Lapin façon Alice!), une société qui
inquiète mais qui fait aussi très envie (et tel est bien le problème) :
Rainbows End est d’ailleurs malicieusement dédicacé à Wikipedia et
Google !
Vernor
Vinge est né le 10 février 1944 aux Etats-Unis.
Professeur d’informatique et de mathématique à l'Université de San Diego, il
est aussi célèbre pour son essai de 1993 sur la singularité
technologique.