le titanic après l'iceberg
Par cgat le jeudi 15 février 2007, 00:28 - écrivains - Lien permanent
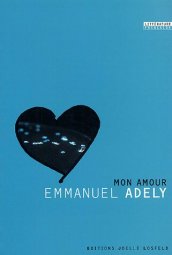
je pose aujourd'hui que ce qu'on appelle roman (officiel) ce qu'on offre en tant que roman (officiel) ce qu'on achète en tant que roman (officiel) ce qu'on critique en tant que roman (officiel) ce dont on parle comme étant de l'ordre du roman (officiel) dans la presse et dans l'édition en France en général n'est pas de l'ordre du roman et moins encore de l'ordre du contemporain mais autre chose
je pose que ce qu'on nous offre en tant que roman (officiel) cet autre chose est en général aussi pertinent que Druon pétitionnant pour rebâtir les Tuileries et aussi contemporain que les écrits des Émigrés en 1815 qui n'avaient rien appris ni rien compris ce qui dans la description la dénonciation l'appréhension du monde dans lequel on vit dans lequel on est revient à faire jouer l'orchestre du Titanic après qu'il a heurté l'iceberg
je pose que cet autre chose ces textes en général appelés romans (officiels) par les éditeurs et les journalistes dénaturent ce qu'est le roman et que ce sont des produits culturels c'est-à-dire des produits destinés à la vente et qu'il n'est donc plus possible de parler de roman contemporain visible ou reconnaissable en France au risque de mélanger les aveux les confessions les relations de viol d'inceste d'euthanasie les histoires de la Première Guerre mondiale les histoires de la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi pas si la langue était tentait osait quelque chose qui ressemble au réel se remette en question si la langue
Emmanuel Adely, « Sans titre », Devenirs du roman (Inculte / Naïve, 2007, p. 37-38)
Emmanuel Adely est né à Paris en 1962.
Il a publié :
- Les Cintres, roman (Minuit, 1993)
- Dix-sept fragments de désirs (Fata Morgana, 1999)
- Agar-agar, roman (Stock, 1999)
- Jean, Jeanne, Jeanne, roman (Stock, 2000)
- Fanfare, roman (Stock, 2002)
- Mad about the boy, roman (Joëlle Losfeld, 2003)
- Mon amour, roman (Joëlle Losfeld, 2005)
- « Edition limitée » (Inventaire/Invention, 2006)
Commentaires
Le roman, c'est ce qu'on veut, et plus souvent n'importe quoi... Mais "si la langue..." fait plutôt penser à la poésie. Sur l'obsolescence des formes et la nécessité d'aller en avant, je suis d'accord !
Pour moi, la question est encore plus épineuse : si je suis prêt à partager en grande partie le constat d'Emmanuel Adely, je crois qu'il faut aussi reconnaître que, sous l'étiquette "roman", il continue à se faire, vraiment, de la littérature, de celle qui travaille la langue et tout et tout... Pire : parfois même ça se vend (Echenoz p. ex.) ! Il est à peu près impossible de dresser une frontière claire entre les "méchants" romans de l'industrie culturelle et les "gentils" livres de vraie littérature qui ont néanmoins gardé une étiquette désuète, parfois pour des raisons de survie. C'est extrêmement poreux entre les deux, et chacun placera le curseur où il veut. Ca ne simplifie pas le débat. Ca n'empêche pas de prôner, avec Adely, l'abandon d'une étiquette qui entretient la confusion. Mais il y a fort parier que ce changement, s'il doit avoir lieu, ne se fera pas du jour au lendemain.
je suis tout à fait d'accord avec vous, jenbamin, sur la porosité du roman : l'étiquette même de "roman" n'est un problème que si automatiquement on pense à un certain type de roman (que l'on dit en général balzacien mais c'est une simplification) ; mais si on remonte aux origines du roman, bien au-delà du 19e siècle, on se rend compte que ce genre a pu présenter bien des formes et absorber bien des contenus
davantage que la nouveauté, c'est la liberté et la complexité qui pourraient peut-être le mieux qualifier ce genre : "ce que l'on veut et n'importe quoi", comme tu l'écris, berlol
destinées de tout temps, et ce très strictement, aux lettrés aristo et bourgeois, et presque toujours réalisées par ces mêmes, conçues donc pour leur complaire (et pour se complaire en leur complaisant : angot, beigbedder, moix, zeller... quatre de ces bourgeois parmi les moins mauvais à ce verdurinage, qui est au fond un libertinage, une putasserie germanopratine que tant d'autres ont exercée avant eux, certes avec moins de "lâché", mais c'était époque pré-soixante-huit où l'esprit bourgeois n'était pas encore gagné par l'ultralibertarianisme et le parler banlieue...), sous couvert parfois de les choquer, mais c'est alors pour mieux se faire aimer d'eux, les formes d'art et de littérature écrite, quelles qu'elles soient, ont toujours, de tout temps dans leur grande majorité, produit d'infâmes clichés de nantis, laids à en mourir, racoleurs, bourrés de pathos, sans aucune inventivité, sans risque pris, indignes et bas, traversés par un narcissisme qui plaît en France, parce qu'il est baigné d'une jouissive bonne mauvaise conscience, celle du nanti éclairé, c'est-à-dire instruit à Sc Po, normale sup, louis le grand ou tout autre lycee chic à souffrir de la haute idée qu'il se fait de lui-même (à ce titre et à celui de la vraie fausse transgression, le quatuor cité plus haut : champion du monde) et qu'il fonctionne sur l'identification du lecteur.
Le roman d'aujourd'hui - pourquoi le ferait-il? - ne fait pas exception : il est aussi nul, dans sa grande majorité "visible", que le tout venant du roman du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe... Même chose pour la poésie ou les arts plastiques, souvent boursouflés de prétention universalisante, forcément inauthentique, car, pour être acceptables, ils répondent avant tout à un marché de formes symboliques rétrecies. La grande majorité joue le jeu de ces contraintes. Hier, comme aujourd'hui : franchement quel rimailleur des deux siècles derniers pourrait prétendre au statut de poete, du moins à l'idée étrange - et pour tout dire impossible - que l'on s'en fait aujourd'hui ? Ne surnagent au fond que des exceptions, des écrits qui n'ont, dans leur majorité, pas voulu ou pu faire le jeu du carcan - roman, poésie, peinture - qui étaient le leur - un carcan imposé aussi, ne l'oublions jamais, par ces éditeurs prestigieux de la rive gauche de la Seine, grands bourgeois eux aussi, et qui ont participé à leur manière, chuchottante, policée, à l'assassinat de la littérature, ces types souvent peu recommandables, une fois éliminé le vernis littéraire dont ils s'enduisent pour mieux glisser, ceux-là dont tel journaliste critique moyen du Monde ne peut pourtant jamais s'empécher (en toute bonne fois !) de faire le panégyrique, opposant leurs vues toujours présentées commelarges et désintéréssées aux dures lois du marché... qu'ils ont pourtant TOUS contribué à importer chez eux ! C'est au fond exactement l'inverse de ce que dit Adely (même si je le rejoins sur bien des points) : si nous sommes submergés par beaucoup de romans médiocres, paresseux, idiots en somme, ce sont pourtant de vrais, d'authentiques romans : tous répondent en tout point à une "fonction roman". Mauvais roman : pléonasme! Les seuls textes qui surnagent vraiment sont des grains de sable dans la machine, ils ne sont souvent pas à proprement parler des romans, ils transcendent - presque toujours involontairement et c'est important de le dire, car la clé est là - le genre. Finalement, ils sont moins malins que les autres, ces pseudo romans là... Ainsi des textes de Tarkos, exemple pris totalement au hasard : roman, poésie, autofiction ? On peut se poser la question dix mille ans... On s'en fout. Ce sont des textes qui grandissent... Quand aux 99% romans 'tête de gondole', faussement subversifs et vraiment serveurs de soupe, ils n'usurpent rien : ce sont bien des romans et leurs auteurs font leur boulot de romancier. ces derniers sont d'ailleurs les seuls à en vivre et à ce titre sont légitimemement les seuls à revendiquer le 'titre' bouffi - qu'au fond n'acceptent que les bourgeois qui aiment se regarder dans ces livres-là - de romancier.
même si je comprends parfaitement la rage qui vous anime, tout n'est pas faux mais tout n'est pas juste non plus dans ce que vous dites, Jean-François Paillard, et le problème est plus complexe.
nombre des lecteurs des romans "têtes de gondole" ne sont pas des "lettrés aristos et bourgeois" mais des lecteurs issus d'un milieu populaire : j'en viens, et certains membres de ma famille sont de gros lecteurs, mais qui ne lisent pas les mêmes livres que moi ; mon père par exemple a du arrêter l'école après le certif pour aller travailler, et si je lui donne à lire Tarkos, ou Simon, ou Jean-François Paillard, ou même Christine Angot, il les lit éventuellement pour me faire plaisir, mais sans plaisir, car ce sont des textes qui nécessitent un apprentissage préalable, d'avoir fait d'autres lectures, de disposer des codes que les études littéraires délivrent.
on peut toujours ressortir le discours convenu (qui pour le coup me semble assez bourgois et paternaliste) : " il faut leur expliquer, leur montrer les richesses de ces textes, ne pas les laisser livrés aux marchands de soupe, etc. " : j'ai essayé, ça ne marche pas comme ça. Mon père a lu deux romans de Claude Simon pour essayer de comprendre pourquoi ils m'intéressaient au point d'y consacrer plusieurs années de travail, mais j'ai bien senti qu'il avait eu du mal ... et bien sûr dans ces cas là il y a la pudeur et la honte qui, d'un côté comme de l'autre, empêchent de parler vraiment de cette incompréhension.
alors décréter que les romans qu'aiment lire tous ces gens sont définitivement "mauvais" ne me parait pas une bonne chose, à moins de décerner des permis de lecture à quelques centaines de personnes dûment sélectionnées ... mais la sélection va être difficile, car je connais aussi beaucoup de gens (dans des milieux moins populaires, pour le coup) qui certes disent lire Tarkos, mais uniquement par snobisme, car la littérature exigeante n'est pas toute pure et a elle aussi une "fonction" sociale.
Vous avez raison tous les deux, je crois, en disant pile et face vous montrez le même objet. Je crois que venant des humains, les romans sont comme eux, d'une grande diversité, d'origine, de facture, de destination, et il ne me paraît pas possible d'en éliminer ou de les empêcher d'exister (sauf à faire de l'eugénisme littéraire).
Reste néanmoins le besoin de séparer production courante et création véritable, avec une large zone d'intersection, et surtout le besoin de (dé)partager, notamment la notoriété — car ce qui déplaît je crois le plus péniblement à un créateur expérimentateur, c'est de voir la notoriété de "création" aller à des produits commerciaux, des produits de série commandés ou validés par les hautes instances de l'édition, alors que les créateurs véritables sont gommés du paysage (puisqu'ils ont des copies plus dociles et plus prévisibles). Qu'en penses-tu, Jean-François ?
L'un des gros problèmes de notre époque, pour ce qui concerne la création artistique, n'est pas seulement la porosité d'une frontière entre "production courante" et "création véritable", mais, à mon sens, l'absence complète d'une telle frontière. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Adorno et Horkheimer ("La dialectique de la raison", p.ex.) pouvaient encore penser une séparation entre la "camelote" de l'industrie culturelle et la création de l'avant-garde, exclue de la culture officielle ; mais déjà avec Arendt ("La crise de la culture") se dessinait la future abolition, dans les faits, de cette séparation — on peut d'ailleurs, éventuellement, reprocher à Arendt cette démission. Plus de cinquante ans plus tard, ce combat-là est malheureusement perdu : même l'avant-garde s'est fait récupérer par l'industrie culturelle — c'est ce que décrit Christine en disant que certains lisent (ou disent lire, peu importe) Tarkos ou Simon par snobisme, c'est plus généralement le fait qu'on trouve aussi des bons livres dans ces lieux de dépravation que sont les FNACs. Des gens comme Rainer Rochlitz ("Subversion et subvention") ou Marc Jimenez ("La critique — crise de l'art ou consensus culturel ?") ont essayé de penser les contradictions du monde culturel contemporain, et dieu sait qu'il y a du boulot... Bref, tout ça pour dire que j'abonde dans le sens de nôtre hôtesse ; j'ai peur que la position de Jean-François Paillard, pour compréhensible qu'elle est, ne soit susceptible que de couper la création authentique de ce qui lui reste de public. Ceci dit, avec le plus grand respect, puisque lui est du côté des créateurs, quand je ne suis que de celui des commentateurs (sans parler du fait que je porte le fardeau d'être passé à la fois par le mauvais lycée chic et par la mauvaise école'sup... ).
Je verse au dossier ce petit extrait, auquel j'ai souvent cherché à réfléchir (sans jamais entièrement m'y résoudre), de "Corps du roi" de Pierre Michon :
" Qu'il n'y ait pas de bonne littérature, qu'on déduirait par opposition à une autre, mauvaise, c'est suggéré dans Madame Bovary. Homais affirme en effet qu'il existe de la mauvaise littérature, et on sait que tout ce que dit Homais relève de l'opinion, de la bêtise, de ce qui ne doit pas être. Voici : "Certainement, continuait Homais, il a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie." D'où peut-être on pourrait tirer cet axiome : quiconque postule qu'il y a de la mauvaise littérature, et aime cette idée, n'écrira jamais de bonne littérature. "
("Corps du roi", P. Michon, Verdier, p. 28-29)
Pour ma part, je me rassure en me disant, à chaque fois que me vient la tentation de penser qu'il y a de la littérature-camelote, qu'en tout cas je n'aime pas cette idée...
A la relecture, mon texte, comme beaucoup d'autres, me paraît effectvement excessif, outrancier, porté par le voile d'une haine peu raisonnable, presque honteuse, qui sent le dépit à plein nez, assurément injuste et présomptueuse (car qui suis-je, microbe, pour distribuer des blames et des éloges etc.) Bref, tout ceci est bien décevant et je comprends que l'on ait envie un peu de me tirer amicalement l'oreille. Et pourtant, s'il fallait le réécrire, je le réécrirais, ce texte. Et en plus haineux encore à l'encontre de ce roman néo-bourgeois (psychologisant, ethnocentré, paresseusement néo-naturaliste, soit verbouilleux soit purement descriptif, à la fois élitaire (revendiquant notamment le statut magique d'écrivain pour dire et faire n'importe quoi) et démago ("voyez comme je suis un peu comme vous"), pseudo libertarien, mais profondément réactionnaire : pensée-bouillie dominante qui au fond justifie le système qui l'enfante) et qui, porté par les "grands éditeurs" trustent les têtes de gondole de nos nouvelles librairies que sont les centres commmerciaux, quitte à se présenter aux yeux du peuple pavillonnaire, via les notules de Voici, Elle ou Nouvel Aspirateur, autoproclamés derniers bastions de la critique littéraire, comme la pensée quintessenciée et révélée d'un "monde littéraire", en réalité construit de toute pièce par une clique germanopratine, inauthentique et laide (les "homogénéisateurs"), laide comme le cirque bovarien auquel angot se livre avant chaque lancement télé, (je suis étonné qu'un journaliste de retour-coktail à la fondation Cartier n'ait pas encore évoqué, s'agissant d'angot - ses dicts, facts et écrits -, le mot chic d''installation'...) Mon propos n'est pas de faire honte à des vrais auteurs populaires comme Exbrayat ou Clavel ou à des auteurs régionalistes comme Daniel Croze par exemple. C'est par ailleurs en lecteur que j'écris ici et non en romancier (je ne me considère pas tel) ou en créateur de quoi que ce soit... Bon, j'arrête-là mon braillement, je vais finir par vous indisposer et cela, je ne le veux pas...
L'époque, consensuelle, a bien besoin de textes un peu excessifs. Sur le fond, je crois qu'on est tous un peu d'accord, comme le faisait remarquer Berlol.
je le crois, en effet.
pas de problème en effet, jean-françois paillard, l'excès fait parfois du bien ... et je ne m'autoriserais pas à vous tirer (même amicalement !) les oreilles
ce que vous dites des critiques littéraires est très juste et je n'en sauverais que très peu
mais si on se place du point de vue du lecteur, il me semble que le roman, plus encore que les autres genres littéraires, est justement l'expression la plus juste de la complexité du réel et de la diversité des points de vue : chaque roman (chaque écriture) est l'expression d'un point de vue individuel que les individus lecteurs partagent ou pas
aucun roman (aucune écriture) n'est donc jamais "mauvais" pour cette raison même qu'il existe de multiples façons d'appréhender le monde, et que la mienne n'est pas plus vraie qu'une autre
(merci beaucoup, jenbamin d'avoir versé au dossier cet extrait de Michon, que je ne connaissais pas)
Je pense que les éditeurs puissants, en filtrant les oeuvres jugées dignes d'être ou non publiées par eux et promues auprès du grand public, ont un rôle moteur dans la diffusion et la définition du "goût", du style, bref du paradigme littéraire d'une époque. Or, il ne me semble pas, Christine, que la complexité du réel ni la diversité des points de vue soient aujourd'hui à l'oeuvre dans leur politique éditoriale... Ce serait même le contraire, non ? Faire simple et direct, charger en pathos et "pensée unique" : j'ai l'impression qu'au final leur politique éditoriale promeut une certaine homogénéisation des pratiques et des discours littéraires, chaque auteur maison prié de se cantonner, de se conformer à son "genre" (ce que les attachées de presse appelle "trouver son public"), comme le suggère d'ailleurs Adely : la femme violée au récit larmoyant, vengeur ou hystero, le sage revenu de tout aux puissantes effluves métaphysiques, l'ex taulard au fruste vernaculaire, le fils à papa dévoyé qui ose écrire 'slip' dans son roman-rédaction de troisième, la star lasse de son statut de star lasse etc. Je ne parle pas des éditeurs indépendants (POL par ex), mais des grosses machines à sous plus ou moins dépendantes de grands groupes de presse-communication. Ni d'ailleurs de tous les livres publiés par ces grosses machines (ce qui n'interdit pas d'ailleurs de se poser des questions du style: tiens, Marie N'Diaye passe chez Gallimard... tiens, comment lirait-on echenoz s'il était chez gallimard, justement ?), mais de certains d'entre eux qui font les unes des magazines et les têtes des gondoles...
cette fois je suis entièrement d'accord avec vous ... mais je ne vois pas tellement comment inverser cette tendance, qui n'est d'ailleurs pas propre à la littérature