désemparés
Par cgat le mardi 25 mars 2008, 00:30 - écrivains - Lien permanent
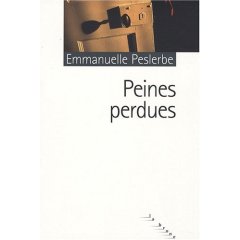
Un homme est mort. D'une mort provoquée par un tiers. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer, une maladie du cerveau qui se caractérise par une perte de la mémoire. Les médecins n'y peuvent rien, ils la décrivent comme on le ferait pour un coucher de soleil. Les souvenirs disparaissent les uns après les autres, on ne sait où et encore moins pourquoi. Pas de microbes à combattre, pas d'hémorragie à stopper, pas de tumeur à opérer. On assiste impuissant à l'extinction des feux. Il est étrange d'appeler cela une maladie. Il serait préférable de ne pas imaginer qu'il s'agisse d'une volonté de fuir une réalité trop pesante. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui efface lentement la vie sans faire mourir. Elle n'est pas contagieuse et cependant se propage. Et nous laisse désemparés. (p. 12-13)
Il se trouve que je n’ai que ce cheveu, je ne le coupe pas en quatre, je le suis comme un fil d’Ariane. (p. 78)
Jean, dans son costume gris sombre, les avant-bras sur les accoudoirs, tout en gardant les yeux fixés sur Ghislaine, reste interdit par le sentiment que la situation lui échappe. Impuissant. Comme face à un corps inerte rétif au déplacement. Il se fait tard. Ses convictions s’effondrent. Et s’il avait eu tort. Pourquoi tourmenter cette femme si démunie ? Parce qu’il est commissaire et qu’il en a plus qu’assez d’être inutile. Il tient toujours son fil, mais après ce moment de flottement, il ne sait pas dans quel sens il se déplaçait au moment de l’interruption, à cet endroit du labyrinthe où l’avant ressemble à l’après. Il hésite car le risque est de revenir à la case départ. Et le temps s’écoule, les traces de pas s’estompent dans la neige qui fond. Tragique. Ghislaine remonte à la surface :
- Vous vouliez me demander quelque chose ? (p. 81-82)Le commissaire a le sentiment de s’être déplacé pour rien. Rien d’autre que pour voir la misère humaine. La sienne. (p 112)
Le commissaire Jean Brossin, assis à son bureau, regarde le fauteuil vide devant lui. L'amnésie du père s'appelle maladie d'Alzheimer, celle de la fille s'appelle comment ? Un blanc dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un puits sans fond. Il passe la main sur son menton. Le temps a poussé. La vie pousse. Il passe la main sur ses cheveux. Le code pénal grand ouvert ne parle pas du délit d'oubli. Un puits sans fond où dégringolent des cadavres. Il n'a pas de témoin, pas de preuve, que des billes de plastique dans un vieux paillasson. Une affaire minable. Un commissaire mal rasé, un père absent. Quelques kilos à perdre. Il dirige les investigations, il mène l’enquête, il est commissaire de police. Il ouvre son tiroir et, dans le fond, sous quelques feuilles oubliées, délaissées, sa main cherche un dé laissé là par un tricheur pris sur le fait. Il décide : pair je l’inculpe, impair je laisse tomber. Il lance l’objet qui tombe, roule et s’arrête contre la boîte de cachous. Sur le quatre. Il recule son fauteuil, se lève, attrape son manteau, son écharpe. Il va jusqu’au radiateur et baisse le chauffage. Il revient au bureau pour prendre la feuille de notes. Elle est sous le dé. Il la fait glisser. Le dé roule et s’arrête sur le deux. Il le regarde. Entre le pouce et l’index, il s’en saisit et le tourne délicatement pour le mettre sur le trois. Il relève le col de son pardessus et ferme la porte derrière lui. (p. 115-116)
Roman singulier, que Clarabel ou Le littéraire n’ont pas aimé, sans doute parce qu’ils en attendaient autre chose que ce qu’il est : la trame policière n’y a que peu d’importance, et, comme dans son premier roman, Un bras dedans, un bras dehors, ce que traque Emmanuelle Peslerbe c’est l’opacité des êtres, l’insignifiance de leurs paroles, les moments où tout devient égal ; et si ses personnages scrutent aussi souvent leur image dans le miroir, c’est peut-être que, ainsi désemparés, ils sont aussi notre miroir.
Emmanuelle Peslerbe, née le 23 mai 1962 à Nantes, est aussi
kinésithérapeute, et a publié :
Un bras dedans, un bras dehors (Éditions du Rouergue, 2007)
Commentaires
pas assez sexy comme on disait ?
Que ne cites-tu ceux qui l'ont aimé !
http://www.berlol.net/dotclear/inde...
désolée, Berlol, tu fais bien de me rappeler à l'ordre ...
et comme j'avais moi-même ajouté un lien chez toi vers mon billet sur le premier livre d'Emmanuelle Peslerbe, le cercle est vertueux !