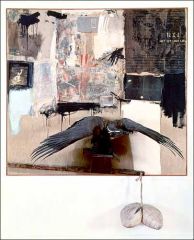Spécialement pour les commentateurs de mon précédent billet, un petit bonus proustien (sans statue ni boulons, s'entend!) :
Sans doute, l’amitié, l’amitié qui a égard aux individus, est une chose frivole, et la lecture est une amitié. Mais du moins c’est une amitié sincère, et le fait qu’elle s’adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C’est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous ne sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonctions, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement et où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes. De plus, – dès les premières relations de sympathie, d’admiration, de reconnaissance, – les premières paroles que nous prononçons, les premières lettres que nous écrivons, tissent autour de nous les premiers fils d’une toile d’habitudes, d’une véritable manière d’être, dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes ; sans compter que pendant ce temps-là les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer, ou que nous paierons plus cher encore toute notre vie des remords de les avoir laissé protester. Dans la lecture, l’amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d’amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c’est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu’à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l’amitié : Qu’ont-ils pensé de nous ? – N’avons-nous pas manqué de tact ? – Avons-nous plu ? – et la peur d’être oublié pour tel autre. Toutes ces agitations de l’amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu’est la lecture. Pas de déférence non plus ; nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle ; quand il nous ennuie nous n’avons pas peur d’avoir l’air ennuyé, et quand nous avons décidément assez d’être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s’il n’avait ni génie ni célébrité. L’atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l’auteur et la nôtre il n’interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée, de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur (si le livre mérite ce nom), rendu transparent par la pensée de l’auteur qui en a retiré tout ce qui n’était pas elle-même jusqu’à le rendre son image fidèle, chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l’inflexion unique d’une personnalité ; de là une sorte de continuité, que les rapports de la vie et ce qu’ils mêlent à la pensée d’éléments qui lui sont étrangers excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l’auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir. Nous savons nous plaire tour à tour aux traits de chacun sans avoir besoin qu’ils soient admirables, car c’est un grand plaisir pour l’esprit de distinguer ces peintures profondes et d’aimer d’une amitié sans égoïsme, sans phrases, comme en soi-même.
Marcel Proust, Journées de lecture (Contre Sainte-Beuve, Gallimard, Bibliothèque de ma Pléiade, 1971, p. 186-187)