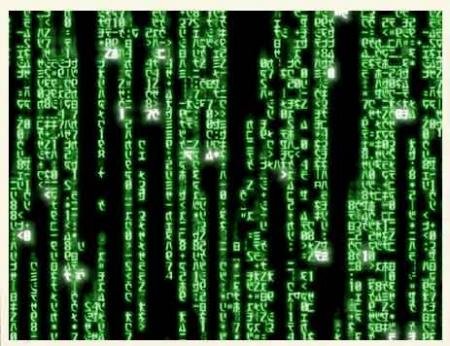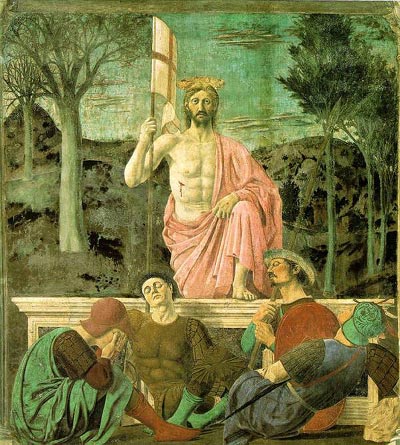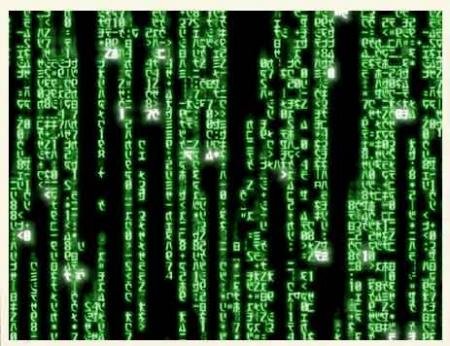
Si les hommes créent ou fantasment des machines intelligentes, c'est parce
qu'ils désespèrent secrètement de leur intelligence, ou qu'ils succombent sous
le poids d'une intelligence monstrueuse et inutile : ils l'exorcisent
alors dans des machines pour pouvoir en jouer et en rire. Confier cette
intelligence à des machines nous délivre en quelque sorte de toute prétention
au savoir exhaustif, comme de confier le pouvoir à des hommes politiques nous
permet de rire de toute prétention à gouverner les hommes. Si les hommes
rêvent, contre toute évidence, de machines originales et géniales, c'est qu'ils
désespèrent de leur originalité, ou qu'ils préfèrent s'en dessaisir et en jouir
par machines interposées. Car ce qu'offrent ces machines, c'est d'abord le
spectacle de la pensée, et les hommes, en les manipulant, s'adonnent au
spectacle de la pensée plus qu'à la pensée même.
Ce n'est pas en vain qu'on les nomme virtuelles : c'est qu'elles
maintiennent la pensée dans un suspense indéfini, lié à l'échéance d'un savoir
exhaustif. L'acte de pensée y est indéfiniment différé. La question de la
pensée ne peut même plus y être posée, pas plus que celle de la liberté des
générations futures : elles traverseront la vie comme un espace aérien,
attachées à leur siège. Ainsi les Hommes de l'Intelligence Artificielle
traverseront leur espace mental attachés à leur computer. L'Homme Virtuel,
immobile devant son ordinateur, fait l'amour par l'écran et ses cours par
téléconférence. Il devient un handicapé moteur, et sans doute aussi cérébral.
C'est à ce prix qu'il devient opérationnel. Comme on peut avancer que les
lunettes ou les lentilles de contact deviendront un jour la prothèse intégrée
d'une espèce d'où le regard aura disparu, ainsi peut-on craindre que
l'intelligence artificielle et ses supports techniques deviennent la prothèse
d'une espèce d'où la pensée aura disparu.
L'intelligence artificielle est sans intelligence, parce qu'elle est sans
artifice. Le véritable artifice, c'est celui du corps dans la passion, celui du
signe dans la séduction, de l'ambivalence dans les gestes, de l'ellipse dans le
langage, du masque dans le visage, du trait qui altère le sens, et que pour
cette raison on appelle trait d'esprit. Ces machines intelligentes, elles, ne
sont artificielles que dans le sens le plus pauvre, celui de décomposer les
opérations de langage, de sexe, de savoir, en leurs éléments les plus simples,
de les digitaliser pour les resynthétiser selon des modèles. Générer toutes les
possibilités d'un programme ou d'un objet en puissance. Or l'artifice n'a rien
à voir avec ce qui génère, mais avec ce qui altère la réalité. Il est la
puissance de l'illusion. Ces machines, elles, n'ont que la candeur du calcul et
de l'opérationnel, et les seuls jeux qu'elles proposent sont des jeux de
commutation et de combinaison. C'est en cela qu'elles peuvent être dites
vertueuses et non seulement virtuelles : c'est qu'elles ne succombent même
pas à leur propre objet, et ne sont même pas séduites par leur propre savoir.
Ce qui fait leur vertu, c'est leur transparence, leur fonctionnalité, leur
absence de passion et d'artifice. L'Intelligence Artificielle est une machine
célibataire.
Ce qui distinguera toujours le fonctionnement de l'homme et celui des
machines, même les plus intelligentes, c'est l'ivresse de fonctionner, le
plaisir. Inventer des machines qui aient du plaisir, voilà qui est heureusement
encore au delà des pouvoirs de l'homme. Toutes sortes de prothèses peuvent
aider à son plaisir, mais il ne peut en inventer qui jouiraient à sa place.
Alors qu'il en invente qui travaillent, "pensent" ou se déplacent mieux que lui
ou à sa place, il n'y a pas de prothèse, technique ou médiatique, du plaisir de
l'homme, du plaisir d'être homme. Il faudrait pour cela que les machines aient
une idée de l'homme, qu'elles puissent inventer l'homme, mais pour elles il est
déjà trop tard, c'est lui qui les a inventées. C'est pourquoi l'homme peut
excéder ce qu'il est, alors que les machines n'excèderont jamais ce qu'elles
sont. Les plus intelligentes ne sont exactement que ce qu'elles sont, sauf
peut-être dans l'accident et la défaillance, qu'on peut toujours leur imputer
comme un désir obscur. Elles n'ont pas ce surcroît ironique de fonctionnement,
cet excès de fonctionnement en quoi consistent le plaisir ou la souffrance, par
où les hommes s'éloignent de leur définition et se rapprochent de leur fin.
Hélas pour elle, jamais une machine n'excède sa propre opération, ce qui
peut-être explique la mélancolie profonde des computers… toutes les machines
sont célibataires. (pourtant la récente irruption des virus électroniques offre
une anomalie remarquable : on dirait qu'il y a un malin plaisir des
machines à amplifier, voire à produire des effets pervers, à excéder leur
finalité par leur propre opération. Il y a là une péripétie ironique et
passionnante. Il se peut que l'intelligence artificielle se parodie elle même
dans cette pathologie virale, inaugurant par là une sorte d'intelligence
véritable.)
Le célibat de la machine entraine celui de l'homme Télematique. Tout comme
il se donne devant son computer ou son wordprocessor le spectacle de son
cerveau et de son intelligence, l'Homme Télématique se donne devant son minitel
rose le spectacle de ses phantasmes et d'une jouissance virtuelle. Dans les
deux cas, jouissance ou intelligence, il les exorcise dans l'interface avec la
machine. L'AUTRE, l'interlocuteur sexuel ou cognitif, n'est jamais réellement
visé, dans une traversée de l'écran évocatrice de la traversée du miroir. Ce
qui est visé, c'est l'écran lui même comme lieu de l'interface. La machine
(l'écran interactif) transforme le processus de communication, de relation de
l'un à l'autre, en un processus de commutation, c'est à dire de réversibilité
du même au même. Le secret de l'interface, c'est que l'Autre y est
virtuellement le Même - l'altérité étant subrepticement confisquée par la
machine. Ainsi le cycle le plus vraisemblable de la communication est-il celui
des minitélistes roses qui passent de l'écran à l'échange téléphonique, puis au
face à face, et puis quoi faire ? Eh bien, "on se téléphone", et puis on
repasse au minitel, tellement plus érotique finalement, parce qu'ésotérique et
transparent à la fois, forme pure de la communication, puisque sans promiscuité
que celle de l'écran et d'un texte électronique en filigrane de la vie,
nouvelle caverne platonicienne où voir défiler les ombres du plaisir charnel.
Pourquoi se parler, quand il est si facile de communiquer ? (...)
Suis-je un homme suis-je une machine ? Dans le rapport du travailleur
aux machines traditionnelles, il n'y a aucune ambiguïté. Le travailleur est
toujours de quelque façon étranger à la machine, et donc aliéné par elle. Il
garde sa qualité précieuse d'homme aliéné. Tandis que les nouvelles
technologies, les nouvelles machines, les nouvelles images, les écrans
interactifs, ne m'aliènent pas du tout. Ils forment avec moi un circuit
intégré. Vidéo, télé, computer, minitel, ce sont, telles les lentilles de
contact, des prothèses transparentes qui sont comme intégrées au corps jusqu'à
en faire génétiquement partie, comme les stimulateurs cardiaques, ou ce fameux
"papoula" de K. Dick, petit implant publicitaire greffé dans le corps à la
naissance et qui sert de signal d'alarme biologique. Toutes nos relations,
volontaires ou non, avec les réseaux et les écrans quels qu'ils soient; la
forme même de la communication et de l'information est du même ordre :
celle d'une structure asservie, non pas aliénée, celle d'un circuit intégré. La
qualité d'homme ou de machine est indécidable. Le succès fantastique de l'IA ne
vient-il pas du fait qu'elle nous délivre de l'intelligence réelle, du fait
qu'en hypertrophiant le phénomène opérationnel de la pensée, elle nous délivre
de toute l'ambiguité et la singularité de la pensée, et de l'énigme insoluble
du rapport de la pensée avec le monde ? Le succès fantastique (encore que
forcé et sollicité) de toutes ces technologies interactives ne vient-il pas de
leur fonction d'exorcisme, et du fait que l'éternel problème de la liberté ne
peut même plus être posé ? Quel soulagement ! Avec les machines
virtuelles, plus de problème ! Vous n'êtes plus ni sujet, ni objet, ni
libre, ni aliéné, ni l'un, ni l'autre : vous êtes le même dans le
ravissement de ses commutations. On est passé de l'enfer des autres à l'extase
du même, du purgatoire de l'altérité aux paradis artificiels de l'identité.
Est-ce là le principe d'une liberté nouvelle ? D'aucuns diront d'une
nouvelle servitude, mais l'Homme Télématique n'ayant pas de volonté propre, ne
saurait être serf.
Ce qui reste c'est une immense incertitude. L'incertitude qui est à la
racine même de l'euphorie opérationnelle, et qui résulte de la sophistication
des réseaux d'information et de communication. Les sciences ont anticipé sur
cette situation panique d'incertitude en en faisant un principe :
l'approximation maximale du sujet et de l'objet dans l'interface expérimentale,
l'évanouissement de leur position respective, génère ce statut définitif
d'incertitude quant à la réalité de l'objet et à celle, objective, du savoir.
Peut-être est-ce un progrès de la science, mais ce n'est plus un progrès
objectif (comment pourrait-il être objectif quand ni l'objet ni les résultats
de la science ne le sont plus ?). C'est un progrès qui délivre la science de
l'objectivité, qui l'éloigne définitivement du monde réel et de ses propres
finalités. Voilà qui est passionnant, et qui est le noyau d'une situation qui
s'empare aujourd'hui de tous les registres humains : politique, social,
sexuel, économique. L'incertitude en matière d'économie, liée précisément à la
résurrection triomphale de cette "discipline'" est tout à fait réjouissante.
Mais aussi bien l'expansion soudaine et fabuleuse des techniques de
communication et d'information est liée à l'indécidabilité du savoir qui y
circule, l'indécidabilité de savoir si il y a du savoir là dedans, tout comme
dans la communication l'indécidabilité de savoir si il s'agit véritablement
d'une forme d'échange, d'une forme réelle de l'échange.
Je défie quiconque d'en décider, sauf à faire semblant de croire que toutes
ces techniques mènent finalement à un usage réel du monde, à des rencontres
réelles etc… - mais alors, si c'est pour rejoindre le réel, pourquoi fallait-il
le quitter, et pourquoi cet immense détour ? On ne comprend plus du tout
l'enjeu de ces techniques si c'est pour leur assigner un objectif aussi mince.
Non, l'enjeu crucial, actuel, c'est le jeu de l'incertitude. Nulle part nous ne
pouvons y échapper. Mais nous ne sommes pas près de l'accepter, et le pire est
que nous espérons réduire cette incertitude par plus d'information et de
communication encore, dans une sorte de fuite en avant homéopathique, aggravant
par là même la relation d'incertitude. Mais là encore, la chose est
passionnante : la course-poursuite des techniques et de leurs effets
pervers, de l'homme et de ses clones virtuels sur la piste réversible de
l'anneau de Moebius est commencée.
Jean Baudrillard, « Le Xerox et l'infini », Traverses, 44-45,
septembre 1987, p. 18-22
... même si je ne suis pas totalement d'accord, les bonnes questions sont
posées.
::: cet article dans sa totalité, et d'autres
::: le billet de David
Calvo me plaît
::: Le Monde propose un dossier très complet
::: Télérama reprend en entretien
datant de janvier 2006