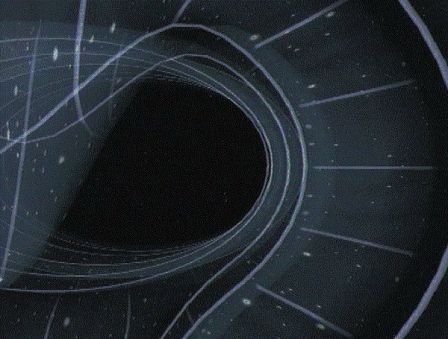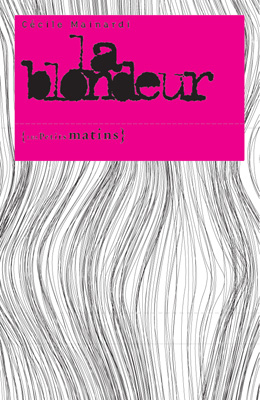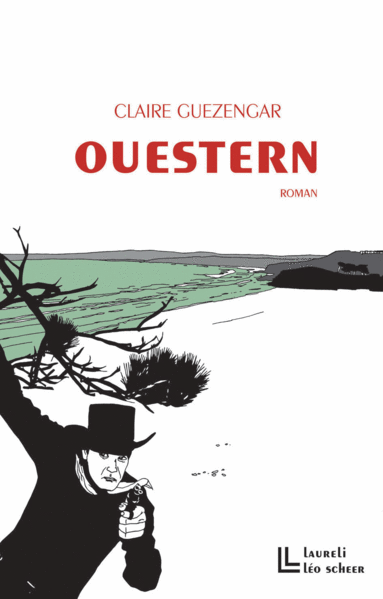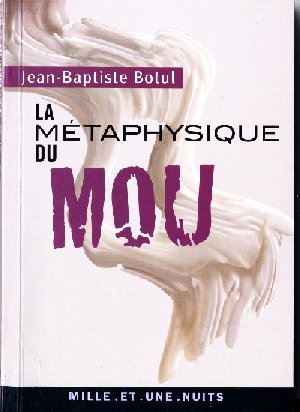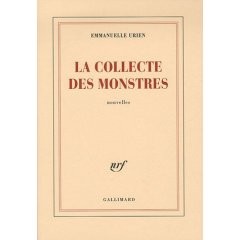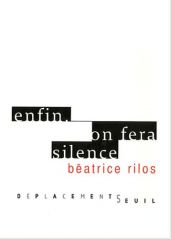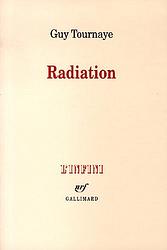Encore trois extraits, et une photo de Mauna Kea pour le plaisir.
Dans le domaine des idées, affirme-t-il, on ose moins en groupe. Grothendieck, toujours dans Récoltes et semailles, parlait de l’importance d’être seul pour celui qui cherche. Il l’a mis en pratique en vivant reclus. J’aurais également tendance à contredire Einstein, pour affirmer qu’il faut et qu’il faudra toujours des gardiens de phares. Bien sûr, il existe de moins en moins de phares, d’endroits physiques ou mentaux d’où l’on puisse se poster face à l’horizon infini. Le progrès implique que le regard bute vite sur un terrain connu ou construit . Et pourtant, que ce soit aujourd’hui ou même dans mille ans, les avancées majeures, les ruptures qualitatives ne viendront ni d’une foule ni d’un consensus, ni même d’un travail en réseau. Alors je dois être à l’aise avec cette solitude, je dois l’embrasser comme jamais. (p. 100-101)
Itzhak, de passage à Paris, et déçu de ne pas m'y trouver, s'est étonné par mail que je sois parti aussi longtemps, plus en tout cas que les quelques jours usuels de séminaire. Il ne comprenait pas ce que j'étais venu chercher ici. Je ne suis pas le seul, un chercheur anglais, avec qui il a signé un papier, est récemment parti travailler sur l'île grec de Corfou, avec Internet pour seul cordon. Itzhak parle de manie. Ayant cherché lui-même la réponse (il n'a pas changé, toujours aussi analytique), il m'a envoyé en pdf un texte de Deleuze que je ne connaissais pas, une dizaine de pages sur l'idée d'île. J'ai aussitôt lu. Et quelque chose m'a touché dans ces lignes. Deleuze remarque que les îles sont de deux sortes : dérivées, c'est-à-dire séparées d'un continent, par érosion ou fracture ; ou originaires, essentielles, bouts de terre surgissant de sous les eaux. Hawaï, elle, est de la deuxième essence : une île originaire et éruptive. Rien ne la rattache au reste du monde, en fait, il n'y a pas plus séparée qu'elle. « Les îles sont d'avant l'homme, ou pour après », elles sont faites pour être désertes. Et quand bien même un homme voudrait y vivre, Deleuze rappelle à l'ordre : « Ce n’est plus l'île qui est séparée du continent, c'est l’homme qui se trouve séparé du monde en étant sur l'île. Ce n'est plus l'île qui se crée du fond de la terre à travers les eaux, c'est l’homme qui recrée le monde à partir de l'île et sur les eaux ». Difficile de phraser plus justement ce que je ressens ici. Je me sens séparé, mais par là, je me sens également créateur, plus accessible à l'imaginaire et à l'idée. (p. 155-156)
Quand on a trouvé l'essentiel, difficile de s'accommoder du reste. Difficile de jouer le jeu du quotidien. Admettons que je me dise : regarder le ciel, y planter mes yeux comme s'il s'agissait d'un événement chaque seconde renouvelé, voilà la seule chose qui compte vraiment. Comment alors composer en société ? Bavarder, médire, flatter, ou même critiquer. C'est l'équation maudite, ceux qui ont saisi l'essentiel le paient tôt ou tard du prix de leur vie. Le centre de leur obsession s'épanouit, ou ronge, au détriment de tout le reste. Sans aller trop loin, le prix d'une vie, j'entends au moins par là vie sociale. Mon instinct de survie ne me protège plus guère. Je sais qu'observer le ciel, l'observer vraiment, s'accompagne d'un monde de renoncements. Renoncer n'est certes pas le mot juste - on ne renonce pas au normal pour l'absolu, on y cède corps et âme. Je me sens donc plutôt sur le point de céder. (p. 166-167)
Tarek Issaoui, Bleu univers (Scali, 2007)