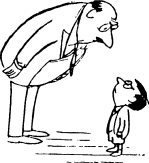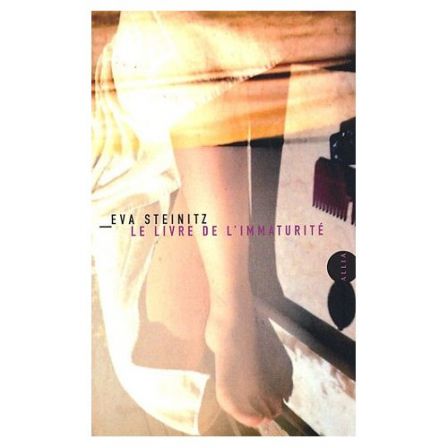
J'ai l'impression de commencer ce que je n'finirai pas. Entreprendrai-je ? Il faut choisir. Je fais un pas. Personne ne finit la nature, elle se prolonge elle-même. Puisque rien ne se fait. Tout me trouble. Comment font ces adultes pour savoir ce qu'ils font ? Je poursuis ma perte. Sans autant de doutes, et seule, je m'oblige à composer avec ce que je suis devenue et avec ce que les autres arriveront à recevoir sans peine. Certains me diraient qu'ils m'aiment bien. On m'a trouvée bien préparée. Quelqu'un s'avança : « Si je devais être une fille, je voudrais être comme toi, habillée, sourire, avoir peur et regarder pareil. » je n'comprends pas c'qui n'est pas clair. Que veulent me faire entendre mes dires ? Ce que les autres voient.
J'ai le sentiment d'être un peu mieux qu'avant. J'ai des nouveaux défauts depuis ceux de mon adolescence. J'ai été vilaine si longtemps. En pleine déformation, mon trop gros nez avait une bosse qui le penchait à droite. C'était seulement du profil gauche qu'il tenait. Mes sourcils encore trop épais se coiffaient et se recoiff'ront. J'évite la chute qui renforcerait la nullité de mon regard. Mes yeux s'apitoieront sur des paupières aplaties par des cernes géants. Des impuretés hyper présentes me donneront l'air fatigante. Ma tête depuis, je l'ai reconnue. Mon corps change tout l'temps. Mes jambes sont toujours trop courtes pour leurs épaisseurs. Elles impliquent que quand je porte des pantalons, je nettoie tous les sols, en marchant. C'est du ventre que je n'sais pas. Le plus souvent, assez large et plutôt plat, une sorte de protubérance s'y pointe et au centre un nombril. Je suis tout sauf maigrichonne. Ma couleur au naturel change aussi, entre l'olive et le blanc dirty. En général, j'n'les aime pas trop. Sous tous ces défauts, je cache les pires de mes horreurs, qui, si je me plaisais à les recenser, m'auraient éloignée du sujet que j'offre au tout, mon désir.
Peut-être que depuis mon portrait, le monde se racont'ra. Alors, je projette l'avenir, en décollant du moi. Sans faute d'orthographe, je, partira. Avec l'outil du clair esprit, la force activa autrement le fou en moi. J'ai menti, triché, j'ai utilisé des lois. Je me suis améliorée. En me croyant sauvée, j'ai rebu la tasse des fois. Je préviens qui m'intéresse. Dans le futur, ce qui vient de s'commencer, s'organise. Plus loin, quelqu'un est mort. C'est mon égocentrisme. Désormais, la voie est ouverte à des articulations diverses. Ma destinée laissera le tout-faire s'exprimer, et avec attention, des surprises vont en surgir.
Produit d'une génération et produit du temps, sans regret, assumer l'ensemble, le détail est charmant. Tous les espaces corrigent le départ pour une origine anatomique. J'aimerais m'évader... jusqu'ici, après le computer, s'ouvrent les frontières. je déménage sans cesse. (p. 10-11)Je n'ai pas fait d'introduction. Ce récit n'a pas d'portée. Il me manque des transitions. Je n'ai aucun langage. Je n'sais toujours pas comment me présenter. Il y a bien quelque chose. Je m'explique sur le tard. Les raisons de l'histoire sont la colère face à moi. Paresseuse utile. Face aux intellectualisations contemporaines, je n'suis ni costaude ni très forte pour donner des conseils. Je crois en haut et en bas. Le discours m'assassine. En pêcheuse de ligne, je guette l'inspiration. Le poisson croque mon fil. D'autres fois, il va donner sa peau. La rage me pousse à l'élan. Je sursaute pour le public. Crédulité captive. Tous les jours, je veille, et une fois pour de belle. Je maintiens, je n'ai pas de vérité à dire.
Prête pour les journalistes, mes lacunes et mes prouesses, sans problème, je signerais ce qu'il en reste. J'accepterais critiques et publicités. Je n'ai que le but de devenir moi-même.
Je vais me bio-dégrader. Sans aucune actualité, je continue mes suites comme une élève modèle et rebellée. Pas besoin d'choisir une voix pour du style ou du nougat, je suis tout à la fois : menteuse et naturelle. Littéraire imbibée. C'est ma naissance qui a trahi ma vérité. Comme les autres grands esprits, je ne peux pas oublier. Après ce premier cri, sur mes eaux claires et propres, le mensonge m'a portée. Les anges connaissent mes secrets. À figure morbide, je fus façonnée en morte. Je serai bien normale. Sans être hypocrite, je n'veux pas être un modèle. Mon masque est pt'être poétique, j'incarne la violence même. (p. 44-45)
Eva Steinitz, Le livre de l’immaturité (Allia, 2007)
Ces « Carnets » spamés à Lisbonne - en osant (hardiment) revendiquer l’héritage de Pessoa - sont une bonne surprise de lecture, comme beaucoup des jolis livres des éditions Allia.
Le Livre de l’immaturité est le premier livre d’Eva Steinitz, née en 1982 à Paris.
Une critique à lire en ligne : Alain Nicolas, « Oser la littérature », L’Humanité, 3 mai 2007