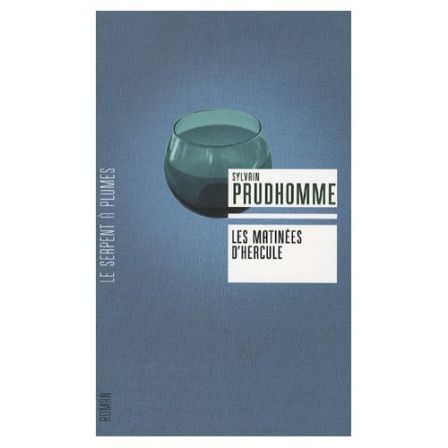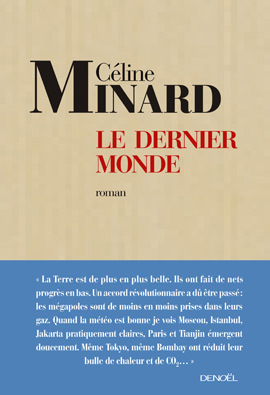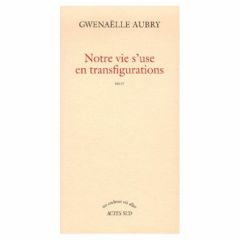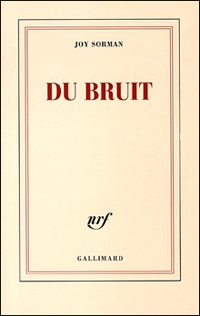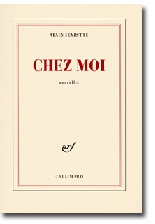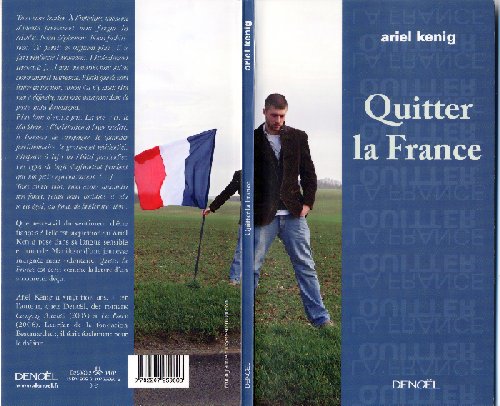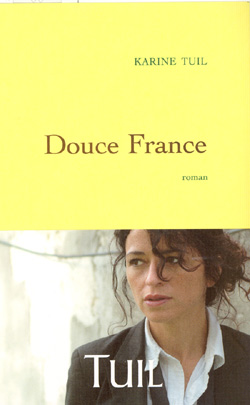Il est aussi cloué au lit que le petit enfant devant son potage qu'il ne veut pas avaler, mais les raisons qui le clouent au lit ne sont pas du tout les mêmes que celles qui clouent le bec au petit enfant qui refuse d'avaler son potage, pas du tout les mêmes c'est évident. Est-ce que le petit enfant pense à la mort à l'instant où il avale son potage. Est-ce qu'à chaque cuillerée de potage qu'il avale il a l'impression que c'est un peu de mort qu'on le force à avaler. Est-ce que quand le petit enfant serre les dents pour ne pas avaler son potage c'est parce qu'il trouve que ce n'est pas possible, le monde est trop hostile. Est-ce qu'à chaque cuillerée qu'on le force à avaler le petit enfant a l'impression que c'est l'hostilité du monde tout entier qu'on l'oblige à laisser entrer dans sa bouche. (p. 75)

Jules fait-il partie des gens qui ne prendront jamais le train, il ne sait
pas, il se demande. Il y a des gens qui ne peuvent pas monter dans un train,
c'est plus fort qu'eux, leurs pieds ne veulent pas, plusieurs fois ils ont
essayé mais chaque fois ç'a été pareil, ils n'ont pas pu franchir le
marchepied, au moment de monter la dernière marche leurs pieds n'ont pas voulu
et ils ont fait demi-tour, et le train est parti avec Pépée dedans, et tout ce
qu'ils ont pu faire ç'a été d'agiter un mouchoir et de faire de grands au
revoir avec la main, et ensuite quand le train a été parti de pleurer beaucoup,
parce que ne pas pouvoir monter dans les trains ça ne veut pas dire ne pas être
malade de chagrin chaque fois. Il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est
épidermique, ils ne peuvent pas monter dans les trains, et il y a d'autres gens
qui ne vivent que par le train, s'ils ne sont pas toujours dans un train c'est
bien simple ils ne vivent plus, la vie à leurs yeux ne vaut plus d'être vécue.
Il y a des gens mordus de train, et il y a des gens dont le bonheur au
contraire est de toujours rester à quai, de se ramasser sur eux-mêmes et de
faire boule, de ramasser toutes les parties d'eux-mêmes et de les tenir
ensemble de toutes leurs forces, de faire une boule compacte et de transporter
cette boule par le monde entier à dos de chameau.
Il y a l'ordre du train et il y a l'ordre du chameau. N'est-ce pas fou.
N'est-ce pas beau. La vie n'est-elle pas une belle chose. (…)
Il a quelle bosse lui. Est-ce qu'il sait. Est-ce qu'il se l'est déjà demandé.
Est-ce qu'on peut n'avoir aucune bosse.
Il a quelques certitudes sur sa bosse. Ça n'est pas une bosse du train bien
énorme. Il a trop la bosse du chameau pour être vraiment mordu de train. Un
train de temps en temps c'est déjà bien assez avec la bosse du train qu'il a,
qui n'est pas une bosse du train bien énorme.
Mais a-t-il une bosse du chameau assez costaude pour pouvoir se passer tout à
fait de train, voilà la question. Est-ce possible, qu'il ne soit ni vraiment
train ni vraiment chameau, ni tout à fait une bosse ni tout à fait l'autre.
Qu'il soit le trou entre les deux bosses.
Peut-on vivre heureux en étant un trou. Il l'espère. Il va tout faire pour être
heureux, il va mettre toutes les chances de son côté, mais il faut qu'il sache
une chose : il est un entre-deux. Entre-deux-bosses. Entre-deux-mers. (p.
107-110)
Sylvain Prudhomme, Les matinées d’Hercule (Le Serpent à plumes, 2007)