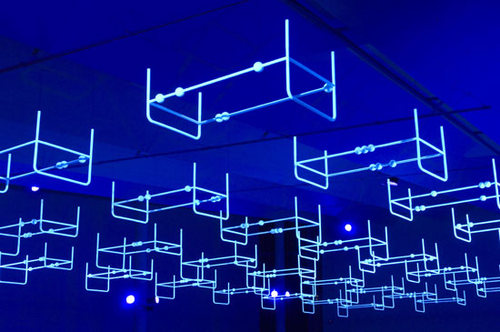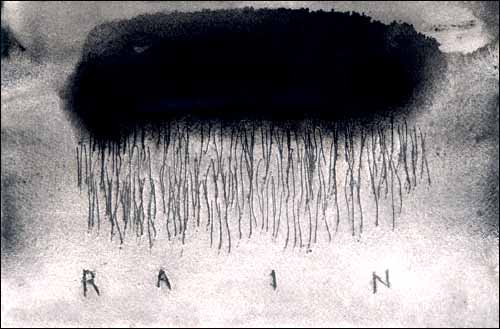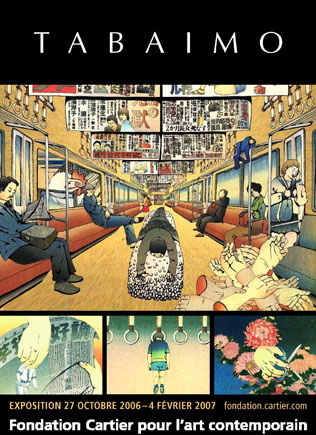Je ne résiste pas à citer également la suite du propos de Deleuze, qui
concerne le cinéma de Stanley Kubrick :
La formule d'Antonioni ne vaut que pour lui, c'est lui qui l'invente. Les
corps ne sont pas destinés à l'usure, pas plus que le cerveau à la nouveauté.
Mais, ce qui compte, c'est la possibilité d'un cinéma du cerveau qui regroupe
toutes les puissances, autant que le cinéma du corps les groupait aussi :
c'est alors deux styles différents, et dont la différence elle-même ne cesse de
varier, cinéma du corps chez Godard et cinéma du cerveau chez Resnais, cinéma
du corps chez Cassavetes et cinéma du cerveau chez Kubrick. Il n'y a pas moins
de pensée dans le corps que de choc et de violence dans le cerveau. Il n'y a
pas moins de sentiment dans l'un et dans l'autre. Le cerveau commande au corps
qui n'en est qu'une excroissance, mais aussi le corps commande au cerveau qui
n'en est qu'une partie : dans les deux cas, ce ne seront pas les mêmes
attitudes corporelles ni le même gestus cérébral. D'où la spécificité d'un
cinéma du cerveau, par rapport à celle du cinéma des corps. Si l'on considère
l'œuvre de Kubrick, on voit à quel point c'est le cerveau qui est mis en scène.
Les attitudes de corps atteignent à un maximum de violence, mais elles
dépendent du cerveau. C'est que, chez Kubrick, le monde lui-même est un
cerveau, il y a identité du cerveau et du monde, tels la grande table
circulaire et lumineuse de « Docteur Folamour », l'ordinateur
géant de « 2001 l'odyssée de l'espace », l'hôtel Overlook de
« Shining ». La pierre noire de « 2001 »
préside aussi bien aux états cosmiques qu'aux stades cérébraux : elle est
l'âme des trois corps, terre, soleil et lune, mais aussi le germe des trois
cerveaux, animal, humain, machinique. Si Kubrick renouvelle le thème du voyage
initiatique, c'est parce que tout voyage dans le monde est une exploration du
cerveau. Le monde-cerveau, c'est « L'orange mécanique », ou
encore un jeu d'échecs sphérique où le général peut calculer ses chances de
promotion d'après le rapport des soldats tués et des positions conquises
(« Les sentiers de la gloire »). Mais si le calcul rate, si
l'ordinateur se détraque, c'est parce que le cerveau n'est pas plus un système
raisonnable que le monde un système rationnel. L'identité du monde et du
cerveau, l'automate, ne forme pas un tout, mais plutôt une limite, une membrane
qui met en contact un dehors et un dedans, les rend présents l'un à l'autre,
les confronte ou les affronte. Le dedans, c'est la psychologie, le passé,
l'involution, toute une psychologie des profondeurs qui mine le cerveau. Le
dehors, c'est la cosmologie des galaxies, le futur, l'évolution, tout un
surnaturel qui fait exploser le monde. Les deux forces sont des forces de mort
qui s'étreignent, s'échangent, et deviennent indiscernables à la limite. La
folle violence d'Alex, dans « Orange mécanique », est la force du
dehors avant de passer au service d'un ordre intérieur dément. Dans
« L'odyssée de l'espace », l'automate se détraque du dedans,
avant d'être lobotomisé par l'astronaute qui pénètre du dehors. Et, dans «
Shining », comment décider de ce qui vient du dedans et de ce qui
vient du dehors, perceptions extrasensorielles ou projections
hallucinatoires ? Le monde-cerveau est strictement inséparable des forces
de mort qui percent la membrane dans les deux sens. À moins qu'une
réconciliation ne s'opère dans une autre dimension, une régénérescence de la
membrane qui pacifierait le dehors et le dedans, et recréerait un monde-cerveau
comme un tout dans l'harmonie des sphères. À la fin de « L'odyssée de
l'espace », c'est suivant une quatrième dimension que la sphère du fœtus
et la sphère de la terre ont une chance d'entrer dans un nouveau rapport
incommensurable, inconnu, qui convertirait la mort en une nouvelle vie.
Gilles Deleuze, L’Image-temps. Cinéma 2 (Minuit, 1985, p. 267-268)