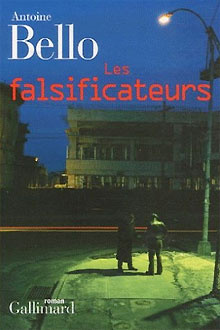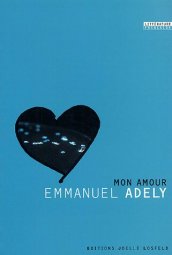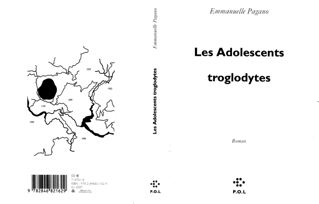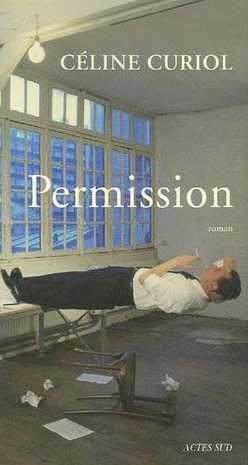Pourquoi sommes-nous là ? Mon père ne me répond pas. Seule cette question le désarme. Pourquoi, pourquoi m'as-tu amenée là ? Si l'un de mes parents me sollicite, je retorque par cette question. Fais la vaisselle. Non, pourquoi je suis là ? Fais la cuisine. Non, pourquoi je suis là ? Aide ta sœur, ne te conduis pas comme ça, ne lis pas, travaille, travaille dans la maison. Pourquoi vous m'avez amenée là ? J'ai toujours été en dehors.
À douze ans on me demande de rentrer. Rentre, tu es musulmane. À douze ans alors que je ne peux tenir chez moi, on me dit, Rentre. Rentre. Fais le ramadan. je quitte la maison, sac au dos et Black Boy de Richard Wright en poche pour toute compagnie. Me prenant pour un hobo en quête d'un lieu meilleur. Je ne sais combien de temps je disparais. Quatre, huit jours ? Je ne sais plus. Partout où je me présente on me dit que j'ai des parents. Partout on me dit qu'il faut que je rentre. On me le demande de tous cotés. On prévient ma mère. Je fais dire qu'au moindre reproche, je pars pour de bon. Je reviens. Je gagne la partie. Pas de ramadan et le droit de vivre autant que je le veux dans ma pièce du grenier. Il m'est toutefois interdit de me mettre à table avec les purs. Les pratiquants que sont ma mère, mon père et ma saur. Mes frères n'ont pas d'obligation religieuse. Je fais à cette occasion mon jeûne. Je refuse de manger le soir, même seule. Ma sœur, que mon entêtement scandalise, s'indigne et se dresse contre moi. Prenant à partie ma mère, lui reprochant notre accord, elle cogne à la porte de tous mes refuges. Elle cogne fort pour me dégager. Je ne crois pas en Dieu. Je ne peux pas, lui dis-je. Fais comme moi. Je ne veux pas de leur vie. Fais comme moi. N'obéis pas. Elle cogne toujours. Je ferme les veux. J'attends. Je ne la supporte plus. Prise de rage, de colère après elle, ses assauts permanents, la vulgarité de son comportement, son goût pour la querelle, ses excès orientaux, je l'empoigne pour la frapper, lui disant mon dégoût d'elle et de sa bêtise, elle se sauve, hurlant que je suis folle, qu'il faut m'interner, me lâchant des insultes que je refuse et que seule sa bouche sait prononcer. Arbi ak mweche affouwathim, Que Dieu bouffe ton foie. Ak mi ghnek, Qu’Il t'étrangle. Ak mi weth sou kavach, Qu’Il te frappe avec une hache. Thakzent. Pourriture. Je suis ébranlée. Ébranlée par ces mots qui m'arrivent des ténèbres. Ces scènes me plongent dans des coins de fadeurs tristes où seule ma mère me rejoint dans le silence. D'où viennent ces mots ? Qui les lui a appris ? Ma mère se tait. Je vois ma sœur comme un démon. Je honnis ce Dieu qui lui donne une telle licence. Je la hais, je la fuis. Je n'ai aucune indulgence. Je ne peux comprendre sa violence, je ne sais rien de ses années terribles en Algérie et de son enfance massacrée. Ce n'est que bien plus tard que je l'apprendrai. L'horreur de ce qu'elle a vécu je ne peux l'envisager enfant. Refoulant les fantômes qui nous assaillent par un combat sans merci, nous rivaliserons de luttes aveugles pour gagner en lucidité sur leurs méfaits. À ce moment je veux que la maison soit l'affaire de tous et non des seules femmes et filles. Je veux les mêmes droits que mes frères. Je ne ferai rien qui les soulage. Je le dis et je leur dis. Ce genre d'attitude ne souffre aucun compromis. J'ignore donc comment on fait le couscous et toutes ces bonnes choses que régulièrement mes sœurs font pour moi aujourd'hui.Zahia Rahmani, France, récit d'une enfance (Sabine Wespieser, 2006, p. 91-93)
Zahia
Rahmani est née le 25 septembre 1962 en Algérie.
Elle à publié :
- Moze (Sabine Wespieser, 2003)
- « Musulman » roman (Sabine Wespieser, 2005)
- France, récit d'une enfance (Sabine Wespieser, 2006)
On peut lire en ligne :
- une notice sur
le site DzLit : littérature algérienne.
- un entretien avec Doreen Bodin pour Zone
littéraire.