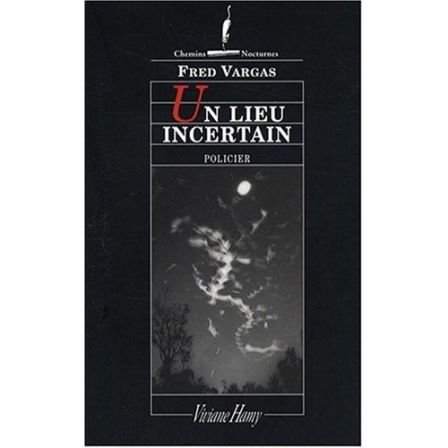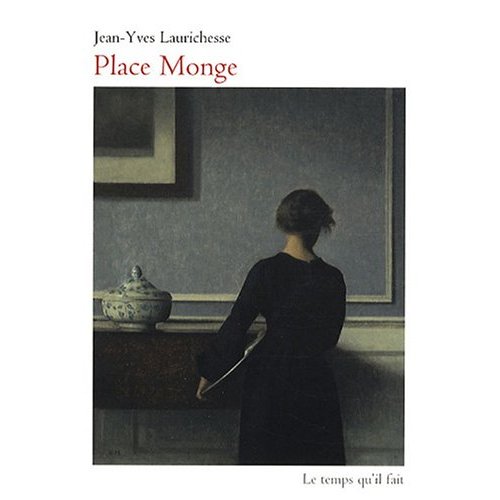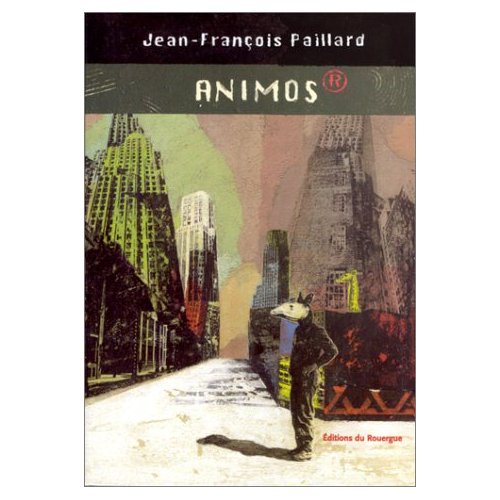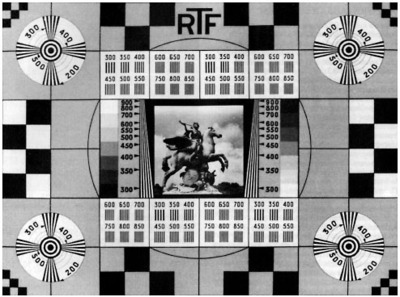Le commissaire Adamsberg savait repasser les chemises, sa mère lui avait
appris à aplatir l'empiècement d'épaule et à lisser le tissu autour des
boutons. Il débrancha le fer, rangea les vêtements dans la valise. Rasé,
coiffé, il partait pour Londres, il n'y avait pas moyen de s'y
soustraire.
Il déplaça sa chaise pour l'installer dans le carré de soleil de la cuisine. La
pièce ouvrait sur trois côtés, il passait donc son temps à décaler son siège
autour de la table ronde, suivant la lumière comme le lézard fait le tour du
rocher. Adamsberg posa son bol de café côté est et s'assit dos à la
chaleur.
Il était d'accord pour aller voir Londres, sentir si la Tamise avait la même
odeur de linge moisi que la Seine, écouter comment piaillaient les mouettes. Il
était possible que les mouettes piaillent différemment en anglais qu'en
français. Mais ils ne lui en laisseraient pas le temps. Trois jours de
colloque, dix conférences par session, six débats, une réception au ministère
de l'intérieur. Il y aurait plus d'une centaine de flics haut de gamme tassés
dans ce grand hall, des flics et rien d'autre venus de vingt-trois pays pour
optimiser la grande Europe policière et plus précisément pour « harmoniser
la gestion des flux migratoires ». C'était le thème du colloque.
Directeur de la Brigade criminelle parisienne, Adamsberg devrait faire acte de
présence mais il ne se faisait pas de souci. Sa participation serait légère,
quasi aérienne, d'une part en raison de son hostilité à la « gestion des
flux », d'autre part parce qu'il n'avait jamais pu mémoriser un seul mot
d'anglais. Il termina son café paisiblement, lisant le message que lui envoyait
le commandant Danglard. Rdv dans 1h20 à l'enregistrement. Foutu tunnel. Ai
pris veste convenable pour vous, avec crav.
Adamsberg passa le pouce sur l'écran de son téléphone, effaçant ainsi l'anxiété
de son adjoint comme on ôte la poussière d'un meuble. Danglard était mal adapté
à la marche, à la course, pire encore aux voyages. Franchir la Manche par le
tunnel le tourmentait autant que passer par-dessus en avion. Il n'aurait
cependant laissé sa place à personne. Depuis trente ans, le commandant était
rivé à l'élégance du vêtement britannique, sur laquelle il misait pour
compenser son manque naturel d'allure. À partir de cette option vitale, il
avait étendu sa gratitude au reste du Royaume-Uni, faisant de lui le type même
du Français anglophile, adepte de la grâce des manières, de la délicatesse, de
l'humour discret. Sauf quand il laissait choir toute retenue, ce qui fait la
différence entre le Français anglophile et l'Anglais véritable. De sorte, la
perspective de séjourner à Londres le réjouissait, flux migratoire ou pas.
Restait à franchir l'obstacle de ce foutu tunnel qu'il empruntait pour
la première fois. (p. 7-8)
Je passe beaucoup de temps à réduire ce traumatisme, son fusible saute sans
cesse.
- Il a un fusible ?
- Tout le monde en a, et même plusieurs. Chez lui, c'est le F3 qui saute. Par
mesure de sécurité, comme sur un réseau électrique. Tout cela n'est que
science, commissaire. Structure, agencements, réseaux, circuits, connexions.
Os, organes, éléments connecteurs, le corps tourne, vous comprenez.
- Non.
- Prenez cette chaudière, dit Josselin en désignant l'appareil au mur. Une
chaudière n'est pas une addition d'éléments disjoints, caisse, arrivée d'eau,
circulateur, joints, brûleur, clapet de sécurité. Non, c'est un ensemble
synergique. Que le circulateur s'encrasse, alors le clapet saute, alors le
brûleur s'éteint. Vous saisissez ? Tout se tient, le mouvement de chaque
élément dépend de celui de l'autre. Si vous vous tordez le pied, l'autre jambe
se fausse, le dos bascule, le cou réagit, la tête a mal, l'estomac se rétracte,
l'appétit s'en va, l'action s'alentit, l'anxiété s'installe, les fusibles
sautent. Je vous simplifie la chose.
- Pourquoi le fusible de Francisco saute-t-il ?
- Zone figée, dit le médecin en pointant un doigt sur l'arrière de son crâne.
Là où est son père. La case est fermée, le basi-occipital ne bouge plus (p.
164-165)
À chacun de ses pas, ses idées montaient et descendaient en vrac, comme il
en avait l’habitude, poissons plongeant dans l’eau, remontant en surface, qu’il
n’essayait pas d’attraper. Il avait toujours fait ainsi avec les poissons qui
flottaient dans son crâne, il les avait toujours laissés libres de nager à leur
guise, d’effectuer leur danse rythmée par le choc de ses pas. (p. 305)
Adamsberg n'était pas un homme émotif, effleurant les sentiments avec
prudence, comme les martinets touchent les fenêtres ouvertes d'une caresse de
l'aile, évitant de s'y engouffrer, tant le chemin pour sortir est ensuite
difficile. Il avait souvent trouvé des oiseaux morts dans les maisons du
village, imprudents et curieux visiteurs incapables de retrouver l'ouverture
par laquelle ils étaient entrés. Adamsberg estimait que, en matière d'amour,
l'homme n'est pas plus futé qu'un oiseau. Et qu'en toute autre matière, les
oiseaux l'étaient beaucoup plus. (p. 316)
Fred Vargas,
Un lieu
incertain (Viviane Hamy, 2008)