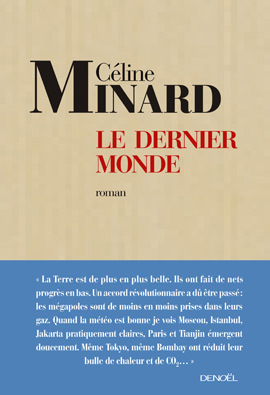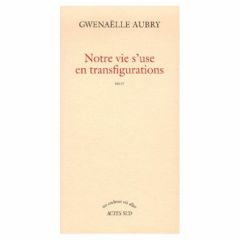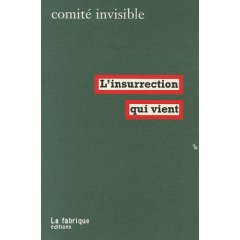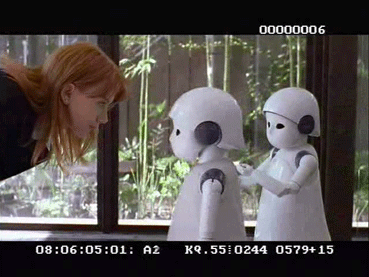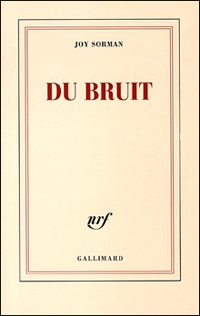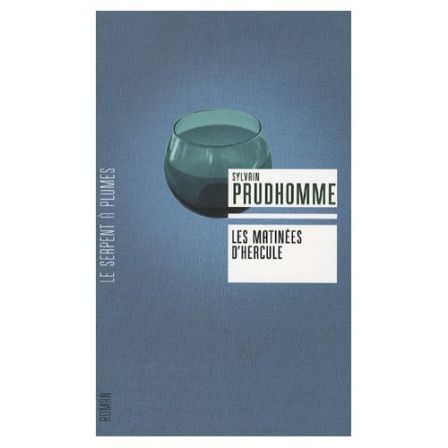
Un livre à acheter d'urgence avant qu'il ne soit censuré au motif d'incitation à se lever tard, tant il encourage de manière indécente la pratique immodérée de la grasse matinée : Sylvain Prudhomme y narre avec beaucoup d'humour les aventures toutes intérieures d'Hercule, occupé à traîner au lit.
Et puis qu'est-ce que cela veut dire important. Est-ce que la vie, est-ce que le bonheur sont faits de choses importantes. Il lui semble qu'au contraire la vie est faite avant tout de choses très banales. Il ne passe pas son temps, dieu merci, à se demander si chaque chose qu'il fait est une chose importante. Il fait des choses banales, oh oui, il ne fait même que cela, des choses banales, et il les fait banalement, sans du tout regretter que ce ne soient pas des choses importantes. À bien y réfléchir cela lui plaît, il en est fier : à d'autres les choses importantes. Aux messieurs importants. Lui est un homme du banal, un homme des petites choses banales faites banalement. (p. 15-16)
Mais ne faut-il pas se méfier de la flemme. N'est-ce pas par la flemme que tout commence. Un matin par flemme on reste au lit, et de la journée on ne se lève plus. Le lendemain on recommence, et puis le surlendemain, et puis le jour d'après. Et une semaine plus tard on est toujours au lit. On ne s'est plus levé, on ne se lève plus, pourquoi se lèverait-on puisqu'on ne s'est pas levé les jours précédents, est-on mort de ne pas s'être levé les jours précédents, non, alors à quoi bon. (p. 19)
Oh qu'il est content. Il se sent l'âme d'un explorateur qui revient d'un grand voyage. C'est un peu cela qui vient de lui arriver, ce n'est pas exagéré de le dire. Il vient de faire un voyage. Le temps de quelques longues minutes il est parti, il a largué les amarres, il a laissé derrière lui ce qu'il avait de plus cher, à commencer par Pépée, Pépée qui est presque une partie de lui-même. Et il s'est précipité au-devant de l'inconnu, il s'est débattu, il a très sincèrement cru se perdre, tout cela pour finalement revenir au port. Quand il y repense ce dénouement lui paraît relever du miracle. Combien plus de chances avait-il de ne pas revenir en arrière, de s'éloigner irréversiblement de Pépée. Il est content. Les circumnavigations de Magellan et de Cook, à côté, lui semblent des aventurettes. Il ne peut s’empêcher de trouver qu’on s’exagère terriblement leur importance. (p. 25-26)
Sylvain Prudhomme, Les matinées d’Hercule (Le Serpent à plumes, 2007)