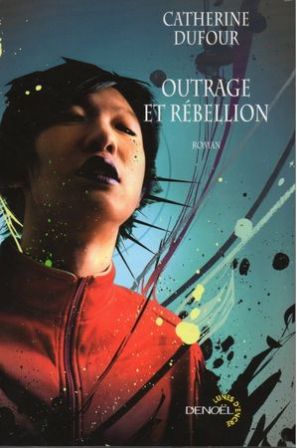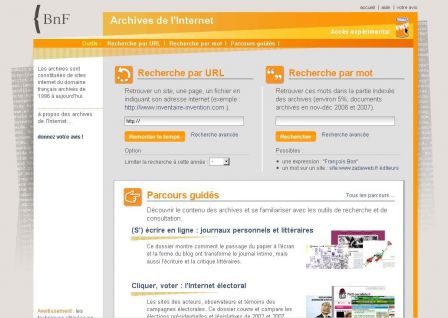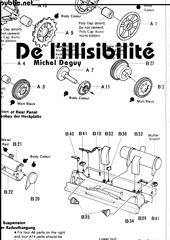IVE : « Au-dessus, les tours. Des dieux dans des boites !
Avec leurs serviteurs, et leurs parasites.
Au-dessous la suburb. Des démons dans des caissons. Les mêmes !
Deux tyrans superposés, roulés dans les mêmes vagues de corruption et
d’illusion.
Au milieu, les caves.
Les caves leur font peur. Les caves sont dangereuses. Les caves touchent le
sol ! L’atmosphère ! Germes et toxines ! Et le terrible
soleil.
Ils nous appellent « les Rats ».
Oui, je veux bien qu’on m’appelle : le Rat. »
C’est de moi. (p. 148)
TIOURÉE : J'ai vachement réfléchi à tout ça, à son succès - au public -
à moi en fait.
C'est certain que vivre dans la suburb était moins pénible pour moi que pour
ceux d'avant. On a tous un ancêtre qui est mort d'asphyxie ou de soif, ou dans
un éboulement, un coup de gaz - c'était plus facile pour moi, oui. Cette
facilité, ça faisait de moi, de nous tous en fait, des gens différents. Même
avant yongyuan ou les stations orbitales, on sentait les mentalités changer. Je
ne veux pas dire que nous nous sentions comme découpés en morceaux, mais que
nous nous sentions nés en morceaux et que nous avions besoin d'une
glue qui nous recolle. Tu vois, à force de tout dissocier - je veux dire,
baiser, c'est faire un enfant en prenant du plaisir au niveau du sexe, un autre
plaisir à travers la peau, et encore un autre grâce au lien social, et un autre
avec le lien affectif. Si on dissocie, ça donne gamètes rectifiés, grossesse
externe, orgasme par stimulation du thalamus ventral latéral postérieur droit,
haha ! Lien social via le Parallèle plus une dose d'ocytocine pour la
plénitude affective, c'est clair qu'on se sentait éparpillés et, surtout,
contrôlés. Pas contrôlés par l'extérieur comme dans les quartiers politiques,
mais par - par nous-mêmes, par le confort que donnaient cet éparpillement et ce
contrôle.
OCTOPUCE : En miettes. On se sentait en miettes, en granulés,
microbroyés. On se sentait comme ça. (...)
OCTOPUCE : La suburb, c'était le confort de la science plus la
rigueur morale. C'est ce que pensaient nos ancêtres. Ils étaient fiers de ça.
Mais nous, ce qu'on voyait, c'est qu'on était coincés entre une bande de
trafiquants métaboliques et une bande de tueurs politiques et qu'au milieu, on
n'était pas fiers. En miettes et pas fiers. Génial.
NOUNA : Les politiques, c'étaient seulement des assassins, mais les
scientifiques, hou ! ces scientifiques. Ils avaient une sorte de niveau
moral - un niveau plein de bulles. Ils avaient une telle idée de ce que le
monde aurait dû être ! Une idée de la justice qui ne correspondait à
rien ! Qui n'avait aucune, aucune réalité et qui n'en avait
sûrement jamais eu aucune. Ils parlaient d'Havant, quand l'air était
gratuit, des histoires de soleil pas terrible et d'eau comme ça - à
volonté ! Tombant du ciel, houhouhou ! Ils parlaient de ça comme si
ça aurait dû être normal ! Écoutez, je suis nulle en vieilles histoires,
mais je suis certaine d'une chose : les gens d'autrefois qui
vivaient au soleil au bord d'un cours d'eau, ils devaient être comme
aujourd'hui : cernés par des hordes de connards bien décidés à piquer leur
place et pisser dans leur rivière ! (p. 202-203)
Catherine Dufour, Outrage et rébellion
(Denoël, Lunes d’encre, 2009)
C’est à travers la juxtaposition chaotique d’une multitude de monologues en
miettes que Catherine
Dufour tente de restituer le « cimetière hurlant » d’un monde
d’après-demain dans lequel une partie de l’humanité est définitivement
transformée en « parc
humain ».
La forme très originale, et très différente de celle de
ses précédents livres, de ces « chants d’une viande en révolte »
(p. 164) dans un monde en ruines en rend d’abord la lecture difficile, puis,
après une phase d’accommodation de l’œil (dirait Marcel), totalement
envoûtante.