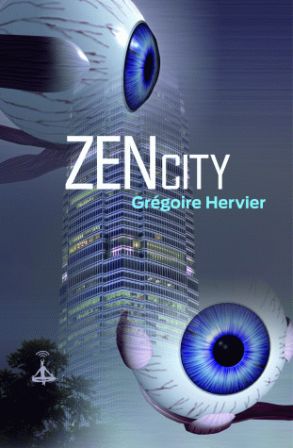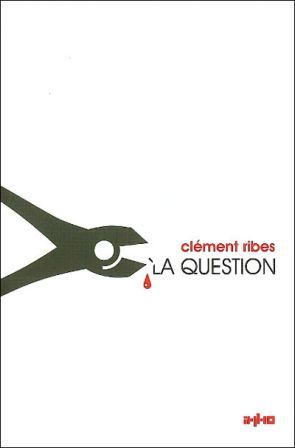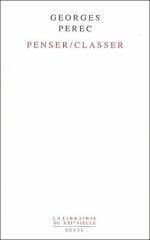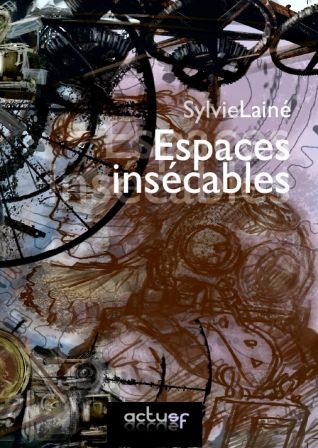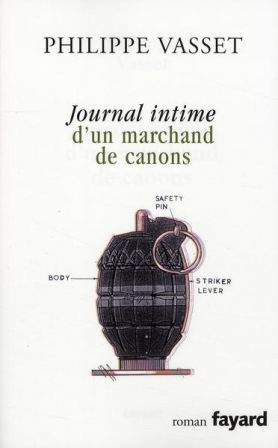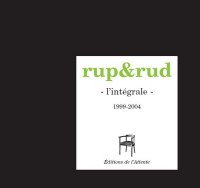
Nous sommes en janvier 1999. J’ai publié quelques rares textes en revue mais, pour la première fois, j’ai miraculeusement en main une série de poèmes dont je sais qu’elle peut constituer la seule chose qui m’intéresse vraiment : un livre. Elle fonctionne en système et, d’une certaine façon, elle en appelle d’autres. Je ne connais absolument rien à l’état de l’édition de poésie en France ; je ne me pose d’ailleurs pas la question de savoir si ce texte plairait à quelqu’un ou non. Je ne marche même pas sciemment dans les pas d’Emmanuel Hocquard ou d’autres auteurs qui, avant moi, auraient fait des livres « sur le métier ». Je suis juste un jeune auteur légitimement pressé qui veut, de son texte, un objet-livre.
Pas d’imprimerie à la cave ? Qu’à cela ne tienne : je mets en page sous Quark X-Press (format 13x13 ; police Gill Sans, à l’époque), et je fonce acheter Canson noir, Canson blanc, massicot, plioir, agrafes, colle et cartouches d’encre. Je fais tourner l’imprimante reliée à mon ordinateur et, hardi petit, en quelques jours, je réalise avec le plus grand soin 25 exemplaires de Simon aime Anna.
Paradoxalement, 25 exemplaires, c’est déjà beaucoup. (Je devine ici des sourires). C’est beaucoup à fabriquer, quand il faut imprimer, découper, plier et agrafer chaque feuille à la main ; mais c’est surtout beaucoup à offrir. Choisir 25 destinataires pour ce qui est mon premier livre m’est même incroyablement difficile. Je ne suis pas tellement gêné de faire un cadeau, non. Je cherche simplement qui pourrait bien le recevoir, ou pourrait le bien recevoir. Je suis embarrassé du choix, à ma façon.
Mais en retour, même si je ne devine pas encore que c’est ce dont il s’agit, je vais demander qu’on me fasse, à moi, d’autres cadeaux.
J’ai réalisé Simon aime Anna en auteur candide et je vais poursuivre exactement dans la même veine. J’ai tellement besoin de faire des livres que je vais simplement en chercher les textes ailleurs, auprès de poètes dont j’aime beaucoup le travail, et qui fonctionnent un peu, à leur insu et au mien, comme d’autres parties de moi. (Vous voyez qu’il n’y a vraiment rien de glorieux dans l’aventure).
Sébastien Smirou, « Ce livre n’est pas un cadeau », préface de rup&rud – l’intégrale – 1999-2004 (L’Attente, 2009, p. 9-11)
Ce généreux petit livre rassemble sept livres de Pierre Alferi, Caroline Dubois, Peter Gizzi, Eric Houser, Anne Parian, Anne Portugal, et Sébastien Smirou, publiés une première fois entre 1999 et 2004 dans le cadre d’une aventure de « micro-édition » initiée par Sébastien Smirou : rup&rud, « perspective littérale inversée » de pur et dur.
Sébastien
Smirou est né en 1972, il est aussi psychanalyste et a publié aussi :
- Simon aime Anna (rup & rud, 1999)
- Mon
Laurent (POL, 2003)
- Ma girafe (Contrat maint, 2006)
- Beau voir.
Bestiaire (POL, 2008)
- Je voudrais entrer dans la légende (contrat maint, 2008)
La totalité de la préface est reprise par Sébatien Smirou dans deux billets de son blog Si tu vois ce que je veux dire : « Ce livre n’est pas un cadeau » (part 1) et (part 2).