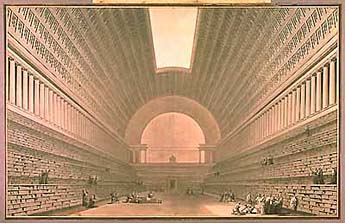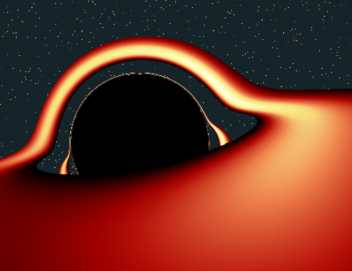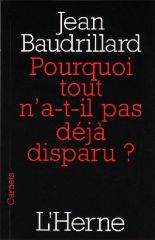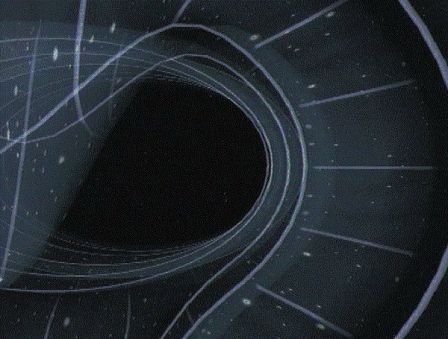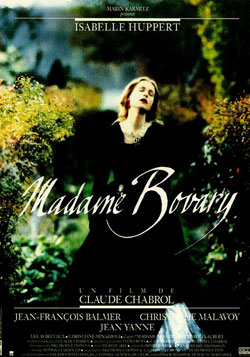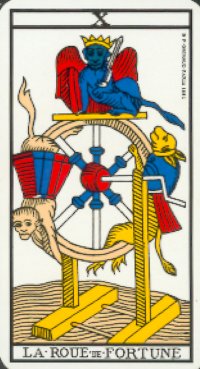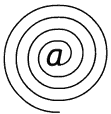Allez, encore un petit passage de Flaubert, sur les lectures d'Emma, avec
une autre métaphore étrange, celle des messieurs « qui pleurent comme des
urnes » :
Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s'évanouissant
dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux
qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments,
sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les
bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux
comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes.
Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains à cette
poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle
s'éprit de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrels.
Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au
long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude
sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la
campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Elle eut
dans ce temps-là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à
l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès
Sorel, la belle Ferronnière et Clémence Isaure, pour elle, se détachaient comme
des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où saillissaient encore
çà et là, mais plus perdus dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux, saint
Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de
Saint-Barthélemy, le panache du Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes
peintes où Louis XIV était vanté. À la classe de musique, dans les romances
qu'elle chantait, il n'était question que de petits anges aux ailes d'or, de
madones, de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient
entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note,
l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Quelques-unes de ses
camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en
étrennes. Il les fallait cacher, c'était une affaire; on les lisait au dortoir.
Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards
éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent,
comtes ou vicomtes, au bas de leurs pièces.
Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures,
qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était,
derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait
dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une aumônière à sa
ceinture; ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles
blondes, qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs
grands yeux clairs. On en voyait d'étalées dans des voitures, glissant au
milieu des parcs, où un lévrier sautait devant l'attelage que conduisaient au
trot deux petits postillons en culotte blanche. D'autres, rêvant sur des sofas
près d'un billet décacheté, contemplaient la lune, par la fenêtre entrouverte,
à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves, une larme sur la joue, becquetaient
une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou, souriant la
tête sur l'épaule, effeuillaient une marguerite de leurs doigts pointus,
retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultans à
longues pipes, pâmés sous des tonnelles, aux bras des bayadères, djiaours,
sabres turcs, bonnets grecs, et vous surtout, paysages blafards des contrées
dithyrambiques, qui souvent nous montrez à la fois des palmiers, des sapins,
des tigres à droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au
premier plan des ruines romaines, puis des chameaux accroupis; - le tout
encadré d'une forêt vierge bien nettoyée, et avec un grand rayon de soleil
perpendiculaire tremblotant dans l'eau, où se détachent en écorchures blanches,
sur un fond d'acier gris, de loin en loin, des cygnes qui nagent.
Et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête
d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde, qui passaient devant elle les uns
après les autres, dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelque
fiacre attardé qui roulait encore sur les boulevards.