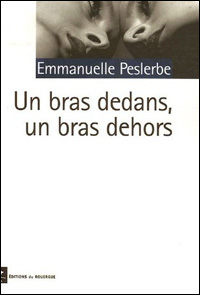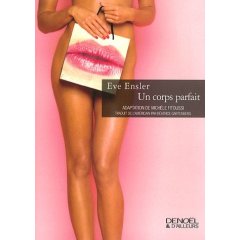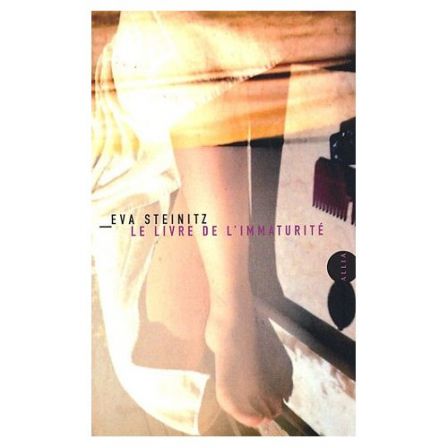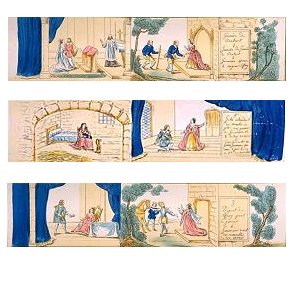De l'autre côté de la rue, trois pigeons sont longtemps restés, immobiles,
sur le rebord du toit. Au-dessus d'eux, vers la droite, une cheminée
fume ; des moineaux frileux se perchent sur le sommet des conduits. Il y a
du bruit en bas, dans la rue.
Lundi. Neuf heures du matin. Il y a déjà deux heures que j'écris ce texte
promis depuis trop longtemps.
La première question est sans doute celle-ci : pourquoi avoir attendu
le dernier moment ? La seconde : pourquoi ce titre, pourquoi ce
début ? La troisième : pourquoi commencer par poser ces
questions ?
Qu'y a-t-il de si difficile ? Pourquoi commencer par un jeu de mots
juste assez hermétique pour ne faire sourire qu'un petit nombre de mes
amis ? Pourquoi continuer par une description juste assez faussement
neutre pour que l'on comprenne bien que si je me suis levé tôt, c'est parce que
j'étais très en retard, et que je suis gêné d'être en retard, alors qu'il est
évident que je ne suis en retard que parce que précisément le propos même de
ces quelques pages qui vont suivre me gêne. Je suis gêné. La bonne question
est-elle : pourquoi suis-je gêné ? Pourquoi suis-je gêné d'être
gêné ? Vais-je devoir me justifier d'être gêné ? Ou est-ce d'avoir à
me justifier qui me gêne ?
Ça peut durer longtemps. C'est le propre de l'homme de lettres de disserter
sur son être, de s'engluer dans sa bouillie de contradictions : lucide et
désespéré, solitaire et solidaire, beau phraseur de sa mauvaise conscience,
etc. Cela fait pas mal d'années que ça dure et ça commence à bien faire. En fin
de compte, je n'ai jamais trouvé cela très intéressant. Ce n'est pas à moi
d'instruire le procès des intellectuels, je ne vais pas retomber dans le
méli-mélo de l'art pour l'art ou de l'engagement...
Mon problème serait plutôt d'arriver, je ne dis pas à la vérité (pourquoi la
connaîtrais-je mieux que quiconque et, par conséquent, de quel droit
prendrais-je la parole ?), je ne dis pas non plus à la validité (cela, c'est un
problème entre les mots et moi), mais plutôt à la sincérité. Ce n'est pas une
question de morale, mais une question de pratique. Ce n'est sans doute pas la
seule question que je me pose, mais c'est, me semble-t-il, la seule qui, d'une
façon quasi permanente, s'avère pour moi cruciale. Mais comment répondre
(sincèrement) alors que c'est justement la sincérité que je mets en
question ? Comment faire, une fois de plus, pour échapper à ces jeux de
miroir à l'intérieur desquels un « autoportrait » ne sera plus que le
nième reflet d'une conscience bien élaguée, d'un savoir bien poli, d'une
écriture soigneusement docile ? Portrait de l'artiste en singe
savant : puis-je dire « sincèrement » que je suis un
clown ? Puis-je arriver à la sincérité en dépit d'un attirail rhétorique
au sein duquel la succession de points d'interrogation qui jalonne les
paragraphes qui précèdent est une figure (dubitation) depuis longtemps
répertoriée ? Puis-je vraiment espérer m'en sortir avec quelques phrases
plus ou moins subtilement balancées ?
« Le moyen fait partie de la vérité aussi bien que le...
résultat... » Il y a longtemps que je traîne cette phrase derrière moi.
Mais il m'est devenu de plus en plus difficile de croire que je m'en sortirai à
coups de devises, de citations, de slogans ou d'aphorismes : j'en ai
consommé tout un stock : « Larvatus prodeo », « J'écris pour me
parcourir » , « Open the door and see all the people », etc., etc.
Certaines arrivent encore parfois à m'enchanter, à m'émouvoir, elles ont
toujours l'air d'être riches d'enseignements, mais on en fait ce que l'on veut,
on les abandonne, on les reprend, elles ont toute la docilité que l'on exige
d'elles.
Il n'empêche... Quelle est la bonne question, celle qui me permettra de
vraiment répondre, de vraiment me répondre ? Qui suis-je ? Que
suis-je ? Où en suis-je ?
Puis-je mesurer quelque chemin parcouru ? Ai-je rempli quelques-uns des
buts que je m'étais fixés, si vraiment je me suis un jour fixé des buts ?
Puis-je dire aujourd'hui que je suis ce que jadis j'ai voulu être ? Je ne
me demande pas si le monde dans lequel je vis répond à mes aspirations, car une
fois que j'aurai répondu non, je n'aurai pas l'impression d'avoir davantage
avancé. Mais la vie que j'y mène correspond-elle à ce que je voulais, à ce que
j'attendais ?
Au départ, tout semble simple : je voulais écrire, et j'ai écrit. À
force d'écrire, je suis devenu écrivain, pour moi seul, d'abord, longtemps,
pour les autres, aujourd'hui. En principe, je n'ai plus besoin de me justifier
(ni à mes yeux, ni aux yeux des autres) : je suis écrivain, c'est un fait
acquis, une donnée, une évidence, une définition ; je peux écrire ou ne
pas écrire, je peux rester plusieurs semaines ou plusieurs mois sans écrire, ou
écrire « bien » ou écrire « mal », cela ne change rien, cela ne
fait pas de mon activité d'écrivain une activité parallèle ou
complémentaire ; je ne fais rien d'autre qu'écrire (sinon gagner le temps
d'écrire), je ne sais rien faire d'autre, je n'ai pas voulu apprendre autre
chose... J'écris pour vivre et je vis pour écrire, et je n'ai pas été loin
d'imaginer que l'écriture et la vie pourraient entièrement se confondre :
j'aurais vécu dans la compagnie de dictionnaires, au fin fond d'une retraite
provinciale, le matin je me serais promené dans les bois, l'après-midi j'aurais
noirci quelques feuillets, le soir je me serais peut-être parfois délassé en
écoutant un peu de musique...
Il va de soi que lorsque l'on commence à avoir des idées pareilles (même si
ce ne sont que des caricatures), il devient urgent de se poser quelques
questions...
Je sais, en gros, comment je suis devenu écrivain. Je ne sais pas
précisément pourquoi. Avais-je vraiment besoin, pour exister, d'aligner des
mots et des phrases ? Me suffisait-il, pour être, d'être l'auteur de
quelques livres ?
J'attendais, pour être, que les autres me désignent, m'identifient, me
reconnaissent. Mais pourquoi par l'écriture ? J'ai longtemps voulu être
peintre, pour les mêmes raisons je suppose, mais je suis devenu écrivain.
Pourquoi précisément l'écriture ?
Avais-je donc quelque chose de tellement particulier à dire ?
Mais qu'ai-je dit ? Que s'agit-il de dire ? Dire que l'on est ?
Dire que l'on écrit ? Dire que l'on est écrivain ? Besoin de
communiquer quoi ? Besoin de communiquer que l'on a besoin de
communiquer ? Que l'on est en train de communiquer ? L'écriture dit
qu'elle est là, et rien d'autre, et nous revoilà dans ce palais de glaces où
les mots se renvoient les uns les autres, se répercutent à l'infini sans jamais
rencontrer autre chose que leur ombre.
Je ne sais pas ce que, il y a quinze ans, en commençant à écrire,
j'attendais de l'écriture. Mais il me semble que je commence à comprendre, en
même temps, la fascination que l'écriture exerçait - et continue d'exercer -
sur moi, et la faille que cette fascination dévoile et recèle.
L'écriture me protège. J'avance sous le rempart de mes mots, de mes phrases,
de mes paragraphes habilement enchaînés, de mes chapitres astucieusement
programmés. Je ne manque pas d'ingéniosité.
Ai-je encore besoin d'être protégé ? Et si le bouclier devient un
carcan ?
Il faudra bien, un jour, que je commence à me servir des mots pour démasquer
le réel, pour démasquer ma réalité.
C'est sans doute, aujourd'hui, ainsi que je peux dire ce qu'est mon projet.
Mais je sais qu'il ne pourra aboutir tout à fait que le jour où, une fois pour
toutes, nous aurons chassé le Poète de la cité : le jour où nous pourrons,
sans rire, sans avoir, une fois de plus, l'impression d'une dérision, d'un
simulacre ou d'une action d'éclat, prendre une pioche ou une pelle, un
marteau-piqueur ou une truelle, ce n'est pas tellement que nous aurons fait
quelques progrès (car ce n'est certainement plus à ce niveau que les choses se
mesureront), c'est que notre monde aura enfin commencé à se libérer.
Georges Perec, « Les gnocchis de l'automne ou Réponse à quelques
questions me concernant » publié dans Cause commune, 1, 1972, p.
19-20
Repris dans Je suis né (Seuil, Librairie du XXe siècle, 1990, p.
67-74)