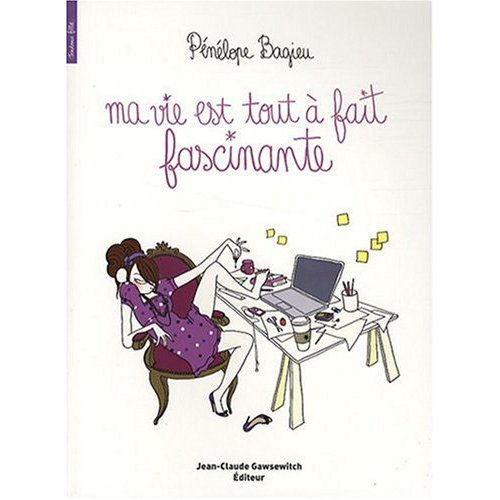
Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Jolicoeur, de son vrai nom Pénélope Bagieu : après le blog, le livre.
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
vendredi 4 janvier 2008
Par cgat le vendredi 4 janvier 2008, 01:28 - blogs et internet
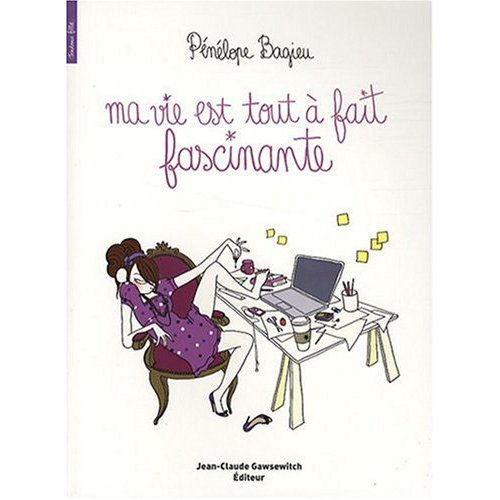
Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Jolicoeur, de son vrai nom Pénélope Bagieu : après le blog, le livre.
jeudi 3 janvier 2008
Par cgat le jeudi 3 janvier 2008, 00:59 - blogs et internet

Un souvenir perso : la mer face à ma fenêtre le 1er janvier 2008
(je suis rentrée à Paris depuis, hélas)
et un petit tour de blogs, ce soir, pour voir comment les autres se tirent de
la figure imposée des vœux : l’année 2008 sera, c'est dit
::: maritime
::: italienne
::: érudite
::: promotionnelle
::: personnalisée
::: hypothétique
::: goûteuse
::: bananée
::: sans politique (?)
::: harakirienne
::: malacologue
::: astrologiquement chinoise
::: graphiquement japonaise
::: pavesienne
::: pantagrueline
::: sollersienne
::: etc.
mercredi 2 janvier 2008
Par cgat le mercredi 2 janvier 2008, 01:16 - citations

Un calcul, même très approximatif, du nombre d'heures dont nous avons disposé au cours de notre vie pour la lecture, nous prouve que nous avons en réalité lu sensiblement moins de livres que nous ne le croyons. Nous n'avons pas eu le temps matériel de lire tous les livres que nous pensons avoir lus.
Mais les livres que nous avons lus sont bien loin d'être les seuls éléments de notre culture livresque. Comptent aussi, parfois presque autant, ceux dont nous avons entendu parler, d'une manière qui nous a fait dresser l'oreille (l'oreille interne), ceux dont un passage cité ailleurs isolément a éveillé en nous des échos précis, ou dont la mitoyenneté avec des ouvrages déjà connus de nous a permis au moins l'étiquetage. Ceux dont nous ne connaissons guère que le titre et le sens général, mais qui, dessinés en creux par les frontières des livres connexes, figurent pourtant, dans notre répertoire livresque, comme références utilisables.
Cette culture accrue par enjambements, par recoupements et par contamination, est peut-être la vraie culture livresque. Le livre est contagieux. La masse des livres déjà connus confère une demi-réalité maniable aux livres non lus encore qu'elle cerne et fait pressentir. Ainsi, à partir d'un certain acquis, la culture livresque, alors que la lecture ne suit qu'une progression arithmétique, peut se développer de manière presque exponentielle par une méthode qui n'est pas sans analogie avec la solution d'un puzzle, et que les polyglottes expérimentent tous pratiquement pour l'acquisition de nouvelles langues. Pour s'enrichir pleinement par la lecture, il ne suffit pas de lire, il faut savoir s'introduire dans la société des livres, qui nous font alors profiter de toutes leurs relations, et nous présentent à elles de proche en proche à l'infini. Une preuve a contrario en est fournie par l'autodidacte de La Nausée.Julien Gracq, Carnets du grand chemin (Corti, 1992, p. 262-264, Gallimard, Pléiade, 2, 1995, p. 1086)
mardi 1 janvier 2008
Par cgat le mardi 1 janvier 2008, 00:01 - vraie vie

... et si jamais vous envisagez de prendre de bonnes résolutions pour l'an neuf
(enfin l'an huit, mais qui est nouveau), faites les drôles grâce à ce générateur 5.0.
lundi 31 décembre 2007
Par cgat le lundi 31 décembre 2007, 00:11 - citations

Un ouvrage littéraire est bien souvent la mise bout à bout et le tricotage intime dans un tissu continu et bien lié - telles ces couvertures faites de bouts de laine multicolores - de passages appuyés à l'expérience réelle, et de passages appuyés seulement à la conformité au caprice de la langue, sans que le lecteur y trouve rien à redire, sans qu'il trouve même à s'apercevoir de ces changements continuels de références dans l'ordre de la « vérité ».
Julien Gracq, En lisant en écrivant (Corti, 1980, Gallimard, Pléiade, 2, 1995, p. 666)
dimanche 30 décembre 2007
Par cgat le dimanche 30 décembre 2007, 00:08 - citations

Écrivain : quelqu'un qui croit sentir que quelque chose, par moments, demande à acquérir par son entremise le genre d'existence que donne le langage. Genre d'existence dont le public est le vérificateur capricieux, intermittent, et peu sûr, et l'auteur le seul garant fiable. Le public est un réseau qu'on peut toujours court-circuiter sans que rien d'essentiel au phénomène littéraire s'annule : le voyant-témoin qui s'allume dans la cervelle de l'auteur est nécessaire et suffisant. Le courant qui passe au fil de la plume ne va vers personne ; il faudrait en finir une bonne fois avec l'image égarante des « chers lecteurs » levés à l'horizon de l'écritoire et de l'écrivain, ainsi qu'à celui d'un orateur public la foule dans laquelle il transvase la liqueur enivrante. La littérature va du moi confus et aphasique au moi informé par l'intermédiaire des mots, rien de plus : le public n'est admis à cet acte d'autosatisfaction qu'au titre de voyeur, et généralement contre espèces - et c'est, je le concède, dans cette affaire, le côté peu ragoûtant.
Julien Gracq, En lisant en écrivant (Corti, 1980, Gallimard, Pléiade, 2, 1995, p. 667)
samedi 29 décembre 2007
Par cgat le samedi 29 décembre 2007, 00:10 - citations

Combien il est difficile – et combien il serait intéressant – quand on étudie un écrivain, de déceler non pas les influences avouées, les grands intercesseurs dont il se réclame, ou qu’on réclamera plus tard pour lui, mais le tout-venant habituel de ses lectures de jeunesse, le tuf dont s’est nourrie au jour le jour, pêle-mêle et au petit bonheur, une adolescence littéraire affamée : premiers Paris des quotidiens, revues désuètes, auteurs ensevelis que faisait alors verdir un instant, comme une ondée, le goût-du-jour, pièces de boulevard, brûlots parisiens, livraisons du Magasin des familles, pamphlets depuis longtemps montés en graine. Le seul écrivain du passé qui nous dise là-dessus par grande exception quelque chose, c’est Stendhal (surtout, il est vrai, pour ses nourritures musicales). La boulimie de lecture caractéristique de l’adolescent, ou de l’étudiant qui va écrire, pareille à celle du ver à soie avant la chrysalide, est telle que la quantité obligatoirement l’emporte sur la qualité : plus impérieux son appétit, plus faible l’écart, pour son goût, entre les nourritures vraiment choisies et celles qui bientôt seront dédaignées lucidement. Qui est destiné à écrire, il y a un moment – moment décisif pour sa formation – où il lit tout, ou presque, et « tout » c’est d’abord ce qu’il a sous la main, ce dont « on parle », ce qui sent encore l’encre fraîche, qui lui fait le même effet qu’au guerrier la poudre. L’œil vorace qui se colle à la page fraîchement imprimée ne dégage nullement, à dix-huit ans, à vingt ans, un paysage littéraire perspectif avec ses premiers et seconds plans, et ses lointains fondus, mais un bariolage, un à-plat juxtaposé de couleurs heurtées et violentes, qui toutes accrochent une rétine encore toute neuve.
Ce tout-venant où il a barboté s’évaporera-t-il pour l’écrivain sans laisser de traces ? Ce n’est pas sûr, car c’est à ce moment de la crue des eaux printanières, des eaux mêlées, qu’il a aussi essayé, commencé peu ou prou d’écrire : les tics d’époque, dont il a subi la contagion naïvement et sans défense, laisseront une marque sur sa manière d’écrire, remodelés toujours, souvent ennoblis, et parfois, s’il a du génie, sauvés : Proust, dont on soupçonne qu’entre tous les écrivains peut-être il a lu très jeune considérablement plus de médiocre que de bon, est plein de ces rédemptions-là. De telles lectures, profondément incorporées dans les automatismes commençants de la plume, sont peut-être un peu pour la manière d’écrire ce que sont les impressions d’enfance pour la couleur, pour l’orient de la sensibilité : non choisies, souvent banales, toujours reprises et magnifiées par la maîtrise acquise des ressources de la langue, comme les lointains incohérents de l’enfance par la chimie savante du souvenir. Et il y a une énigme de la continuité, du fondu étrange de la littérature d’une période à l’autre, par-delà toutes les révolutions et toutes les ruptures, qui peut-être s'éclaire là partiellement : par le fait que l'écrivain en formation se nourrit toujours inséparablement, inextricablement, à la fois de la nouveauté pure, qui l'atteint par son extrême pointe, et de ce qui s'écrit et se publie autour de lui au goût du moment : c'est-à-dire de la continuité maintenue avec avant-hier.
Cette réflexion me vint, je me le rappelle, lorsqu'André Breton, dont on sait assez le peu de goût qu'il avait en principe pour les romans, me prêta un jour, en me les recommandant, des romans de Jean Lombard dont le nom m'était, je l'avoue, inconnu : sortes de Quo vadis, mais byzantins de goût comme d'époque, qui me firent tout à coup mesurer quelle place avait pu tenir dans ses premières lectures toute une queue exsangue du symbolisme, dépassée par lui depuis longtemps, mais non tout à fait éliminée. Tout de même, ces romans, il les avait gardés.
Julien Gracq, En lisant en écrivant (Corti, 1980, Gallimard, Pléiade, 2, 1995, p. 667-669)
vendredi 28 décembre 2007
Par cgat le vendredi 28 décembre 2007, 00:03 - citations

À partir du moment où il existe un public littéraire (c'est-à-dire depuis qu'il y a une littérature) le lecteur, placé en face d'une variété d'écrivains et d'œuvres, y réagit de deux manières: par un goût et par une opinion. Placé en tête-à-tête avec un texte, le même déclic intérieur qui joue en nous, sans règle et sans raisons, à la rencontre d'un être va se produire en lui: il « aime » ou il « n'aime pas », il est, ou il n'est pas, à son affaire, il éprouve, ou n'éprouve pas, au fil des pages ce sentiment de légèreté, de liberté délestée et pourtant happée à mesure, qu'on pourrait comparer à la sensation du stayer aspiré dans le remous de son entraîneur ; et en effet dans le cas d'une conjonction heureuse on peut dire que le lecteur colle à l'œuvre, vient combler de seconde en seconde la capacité exacte du moule d'air creusé par sa rapidité vorace, forme avec elle au vent égal des pages tournées ce bloc de vitesse huilée et sans défaillance dont le souvenir, lorsque la dernière page est venue brutalement « couper les gaz », nous laisse étourdis, un peu vacillants sur notre lancée, comme en proie à un début de nausée et à cette sensation si particulière des « jambes de coton ». Quiconque a lu un livre de cette manière y tient par un lien fort, une sorte d’adhérence, et quelque chose comme le vague sentiment d’avoir été miraculé : au cours d’une conversation chacun saura reconnaître chez l’autre, ne fût-ce qu’à une inflexion de voix particulière, ce sentiment lorsqu’il s’exprime, avec parfois les mêmes détours et la même pudeur que l’amour : si une certaine résonance se rencontre, on dirait que se touchent deux fils électrisés. C’est ce sentiment, et lui seul, qui transforme le lecteur en prosélyte fanatique, n’ayant de cesse (et c’est peut-être le sentiment le plus désintéressé qui soit) qu’il n’ait fait partager à la ronde son émoi singulier ; nous connaissons tous ces livres qui nous brûlent les mains et qu’on sème comme par enchantement – nous les avons rachetés une demi-douzaine de fois, toujours contents de ne point les voir revenir. Cinquante lecteurs de ce genre, sans cesse vibrionnant à la ronde, sont autant de porteurs de virus filtrants qui suffisent à contaminer un vaste public : il n’y faut que quelques dizaines d’années, parfois un peu plus, souvent beaucoup moins : la gloire de Mallarmé, comme on sait, n’a pas eu d’autre véhicule – cinquante lecteurs qui se seraient fait tuer pour lui.
Julien Gracq, La Littérature à l’estomac (Corti, 1950, p. 19-21, Gallimard, Pléiade, 1, 1989, p. 525-526
jeudi 27 décembre 2007
Par cgat le jeudi 27 décembre 2007, 00:10 - citations

Nous en sommes à peu près là. La demande harcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l'air de sortir d'une forcerie : il se dope, il se travaille, il se fouaille les côtes : il veut être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n'en veut pas démordre : coûte que coûte il découvrira, c'est sa mission - ce n'est pas une époque comme les autres - chaque semaine il lui faut quelque chose à jeter dans l'arène à son de trompe : un philosophe tahitien, un graffiti de bagnard - Rimbaud redivivus ; on dirait parfois, au milieu de la fiesta rituelle et colorée qu'est devenue notre « vie littéraire», un trompette affolé qui sonnerait tout par peur d'en passer : la sortie du taureau de course et celle du cheval de picador. Aussi voit-on trop souvent en effet la « sortie » d'un écrivain nouveau nous donner le spectacle pénible d'une rosse efflanquée essayant de soulever lugubrement sa croupe au milieu d'une pétarade théâtrale de fouets de cirque - rien à faire ; un tour de piste suffit, il sent l'écurie comme pas un, il court maintenant à sa mangeoire ; il n'est plus bon qu'à radioter, à fourrer dans un jury littéraire où à son tour il couvera l'an prochain quelque nouveau « poulain » aux jambes molles et aux dents longues. (Puisque j'en suis aux prix littéraires, et avec l'extrême méfiance que l'on doit mettre à solliciter son intervention dans les lieux publics, je me permets de signaler à la police, qui réprime en principe les attentats à la pudeur, qu'il est temps de mettre un terme au spectacle glaçant d' « écrivains » dressés de naissance sur leur train de derrière, et que des sadiques appâtent aujourd'hui au coin des rues avec n'importe quoi : une bouteille de vin, un camembert - comme ces bambins piaillants qu'on faisait jadis plonger dans le bassin de Saint-Nazaire en y jetant une pièce de vingt sous enveloppée dans un bout de papier journal).
Julien Gracq, La Littérature à l’estomac (Corti, 1950, p. 17-19, Gallimard, Pléiade, 1, 1989, p. 524-525)
mercredi 26 décembre 2007
Par cgat le mercredi 26 décembre 2007, 00:10 - écrivains
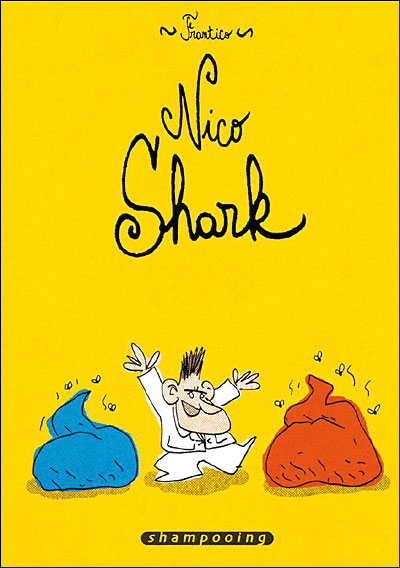
::: le prémonitoire Nico Shark de Frantico sort en format papier : si vous l’avez raté en ligne (avant qu'il disparaisse corps et bien pour ne laisser derrière lui que Nicoprout, le jeu) précipitez vous !
::: avant il y avait eu le Blog de Frantico (devenu un livre)
::: ensuite il y a eu le Blog du Faux Frantico qui se passait début 2008 (et qui est encore en ligne : il est encore temps de profiter de l'effet d'anticipation!)
::: de Lewis Trondheim, on peut aussi suivre en ligne les « Petits riens » (avec même des photos de vacances dedans !).
mardi 25 décembre 2007
Par cgat le mardi 25 décembre 2007, 00:01 - vraie vie
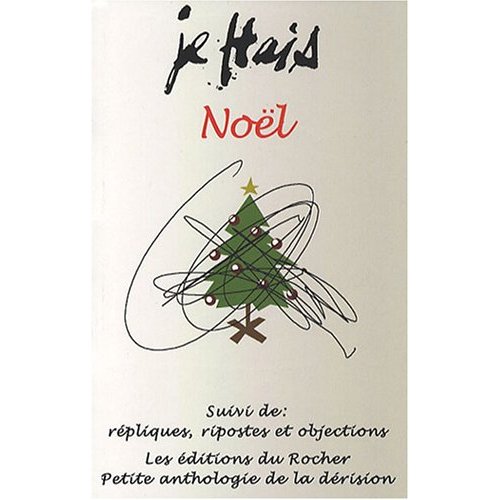
Les hostilités sont comme les huîtres, on les ouvre. « Les hostilités sont ouvertes. »
Il semble qu’il n’y a plus qu’à se mettre à table.
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues
L’idée de regrouper des citations grincheuses et/ou farfelues autour de noël et de ses incitations à consommer plus est salutaire... je conseille aussi cette vidéo musicale qui va bien avec.
lundi 24 décembre 2007
Par cgat le lundi 24 décembre 2007, 01:01 - citations
J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes, de l'arrière-automne, avec une prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la saison soudain singulièrement envahies par le silence. Elle vit à peine, cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe claire et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoxe va fuir et soudain découvrir comme les brisants marins de septembre ces grottes de brique et de béton, ces stalactites de rocaille, ces puériles et attirantes architectures, ces parterres trop secourus que le vent de mer va ravager comme des anémones à sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant tête-à-tête avec la mer, faute de frivolités trop rassurantes, va reprendre invinciblement son rang plus relevé de fantôme en plein jour. Sur le front de mer les terrasses vitrées, mortes, leurs ferronneries mangées de lèpres salines, angoissent comme des bijouteries mises au pillage, - le bleu usé, lessivé, des volets clos sur des fenêtres aveugles recule soudain incroyablement dans le temps le reflux de vie responsable de cette décrépitude. Pourtant, sous le soleil aigrelet d'une matinée d'octobre, des bruits naissent, se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un dormeur - la barrière blanche d'une clôture de bois craque, une sonnette se répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue avide. Je rêve. Qui s'annonce ici avec une telle solennité ? Il n'y a personne ici. Il n'y a plus personne.
Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre de la plage, je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante comme une rumeur d'émeute au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre, minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers, flamboient, se résorbent en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques fondamentales - une pigmentation subtile gagne çà et là, par flaques - le sel pâlit l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles, le vent de mer sable les planchers par les fentes des portes – une transgression soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un raz-de-marée à sec.
Il arrive que par certaines après-midi, grises, closes et sombrées sous un ciel désespérément immobile, - comme sous la maigre féerie des verrières d'un jardin d'hiver - dépouillées de l'épiderme changeant que leur fait le soleil et qui tant bien que mal les appareille à la vie, le sentiment de la toute-puissante réserve des choses monte en moi jusqu'à l'horreur. De même m'est-il arrivé de m'imaginer, la représentation finie, me glisser à minuit dans un théâtre vide, et surprendre de la salle obscure un décor pour la première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues une nuit vides, un théâtre qu'on rouvre, une plage pour une saison abandonnée à la mer tissent d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierre que cinq mille ans, et les secrets de l'Égypte, pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe ouverte. Mains distraites, porteuses de clés, manieuses de bagues, mains expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le chaton qui rend invisible, - je devins ce fantomatique voleur de momies lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante devenu soudain plus perceptible, le soleil enfin disparut derrière les brumes en cette après-midi du 8 octobre 19...
Julien Gracq, « Prologue », Un Beau ténébreux (Corti, 1945, p. 11-13)
Si en hommage à Julien Gracq j'ai envie de citer le prologue de Un beau ténébreux, c’est que ce texte demeure attaché pour moi à un souvenir précis : c’est en écoutant un commentaire virtuose qu’en faisait l’un de mes professeurs, Henri Bonnet, que j’ai compris - et ressenti, comme une émotion - l’intérêt de l’exercice de l’explication stylistique d’un texte
… et puis, comme Gracq, je goûte la mélancolie des plages désertées hors saison, et j'aime la plage de Morgat, qu’il évoque ailleurs à propos de ce texte :
Je rouvre quelquefois encore le prologue de Un beau Ténébreux, roman que je n'aime plus guère. Parce qu'il me semble y retrouver, assez fidèlement rendue, l'atmosphère à la fois limpide et triste, presque recueillie, qui est celle des plages de septembre (et que j'ai peut-être ressentie pour la première fois en visitant avec Queffélec et son frère, en 1931, la plage de Morgat et son grand hôtel vide où nous déjeunions tous les trois).
Carnets du grand chemin (Corti, 1992, p. 177)
dimanche 23 décembre 2007
Par cgat le dimanche 23 décembre 2007, 11:10 - écrivains

... Julien Gracq (27 juillet 1910 - 22 décembre 2007) est mort hier
Par cgat le dimanche 23 décembre 2007, 01:45 - écrivains
Lorsqu'on va aux puces, on va à la pêche à la trouvaille mais c'est elle qui vous saute aux yeux. Avec toute la puissance de propulsion des puces sauteuses qu'on fait gicler au ciel dans les cours d'école, ou d'un bouchon de bouteille de champ’ qui crève le ciel avec l'éjaculation de bain moussant après. La trouvaille, c'est pas tant l'objet en lui-même celui qu'on peut saisir entre nos mains, mais c'est le saisissement, le nôtre face à l'objet, par l'objet, qui nous fait « booh ! » comme un grand cousin sadique caché derrière les rideaux.
La trouvaille, c'est quelque chose de beau, c'est la beauté qui nous touche, une beauté poétique nous effleure timidement le bras, rien à voir avec une beauté marchande. Peu importe que ça soit un objet « de valeur » ou une acquisition à deux francs six sous, de toute façon, la trouvaille n'est pas considérée comme un objet précieux qu'on garderait dans une vitrine, qu'on mettrait sous clef, qu'on observerait à travers une vitrine et à travers le nuage de notre haleine sur la vitre.
La trouvaille n'est pas un simple objet trouvé (bien qu'un objet trouvé puisse être une véritable trouvaille), comme son nom l'indique, elle doit être dénichée, elle joue à cache-cache, il faut partir à la chasse au trésor comme un pirate. Mais c'est elle qui nous trouve et qui nous surprend. On la prend, elle nous surprend. On avait pu la rêver, mais non se la figurer nettement à l'avance. Elle nous inspire, nous aspire. Elle peuple la caverne de nos rêves, au royaume de la petite sirène. Ce sont des traces d'un monde qui ne nous est pas accessible, d'un monde perdu, passé... ce sont des objets qui ont traversé le temps et que l'on pourrait rapporter en souvenir d’un voyage si on s'embarquait à bord d'une machine à remonter le temps. La trouvaille émeut. Elle éveille la nostalgie de nous-même..
Les objets ont une vie propre, ils se font écho, se cassent, se démembrent. Ils forment un système de signes comme les mots se combinent et se recombinent dans un poème. La vie est un paradoxe, je chasse l'inattendu comme le pirate chasse le trésor. La vie... mise en danger. (p. 89-90)J’ai toujours adoré les débuts, ça a quelque chose de magique. Mais je déteste les fins, comment peut-on aimer la fin ? C'est toujours triste et beau comme de vieilles lettres calligraphiées qui essayent de rester immobiles sur l'écran brillant mais qui ne peuvent pas s'empêcher de trembloter, irrépressibles sanglots. Il était une fois... et j'étais jeune à l'époque... et je ne lisais jamais un livre jusqu'au bout. Je voletais d'un début à l'autre, abeille qui récolte du pollen et danse d'une fleur à l'autre comme on fait l'amour. J'étais la danse et je dansais et je riais et je tombais et je dansais encore et encore à tout jamais.
J'aime pas les fins même si on peut dire que c'est la clef de voûte de l'histoire, la clef du sens. Peut-être que j'aime pas les sens ni les significations et tous ces machins-là, la vie n'a pas de sens de toute façon, si ? Nan, elle en n'a pas. Elle en a pas j'vous dis ! Y a bien que les petites amoureuses qui continuent à chasser les signes, telles des lépidoptérophiles, ces vieillards à barbe qui chassent les papillons dans le sud de la France. Bien sûr que c'est normal quand on est amoureux de chercher un sens à tout ce sur quoi nos yeux mettent la main, c'est après qu'on s'en mord les doigts, et ça fait mal... aussi mal qu'une morsure de cygne. Quand t'es amoureux, tu traques les signes encore plus méticuleusement que le plus zélé des étudiants en littérature cramponné à son surligneur fluo, et tu les trouves et tu les ramasses encore plus vite que M. Mauve ramassait ses biftons le jour où il est sorti du taxi avec 20000 francs en petites coupures dans les mains et que le vent les a éparpillés comme des feuilles mortes. Et comme M. Mauve, tu t'en fous pas mal de comment les gens y t'regardent alors que tu te précipites pour les récupérer et que tu les froisses dans tes mains avec tes jointures blanches tellement tu les serres fort parce que tu voudrais pas en perdre un seul.
C'est à la fin qu'on donne le verdict. C'est quand on a toute l'histoire qu'on peut mesurer les changements. C'est la manière dont les gens changent qui est intéressante. Je pense que quoiqu'il nous arrive dans notre vie, les échantillons de ce qu'on a été à différents moments de notre vie sont conservés quelque part en nous, dans des petites fioles alignées sur les étagères d'un petit placard spécial, au cas où on aurait besoin de mesurer combien on a changé... ou juste pour se faire du mal... on sait jamais quand ça peut être utile. Ça peut toujours servir. (p. 119-120)Alizé Meurisse, Pâle sang bleu (Allia, 2007)
samedi 22 décembre 2007
Par cgat le samedi 22 décembre 2007, 02:16 - écrivains

Pour toute cervelle, une petite morille rose, enfermée à double tour dans ce précieux coffret que vous êtes. Vous pensez que vous êtes quelqu’un, quelque chose de stable, avec des limites bien définies, tracées proprement à la règle, quelque chose qu’on peut juger. (p. 10)
Tu n’incarnes rien, tu n’es qu’incarnat, rien qu’une entreprise de construction immobilière qui travaille en permanence pour rester égale à elle-même, combinant des éléments les uns avec les autres, métabolisant le monde pour en faire ton monde. Ton corps est une puissance qui doit être mise en danger pour se manifester, ton corps n’a pas de limites, tous les maillons de tes chaînes sont dans ta tête, ils sont aussi réels que ce dieu que tu as inventé pour que tout soit sous contrôle et pour pouvoir inculper ta chair. C’est elle la coupable, parce que la chair c’est la vie. T’es un mensonge, à chaque fois que tu dis « je »tu renies ton corps et sa multiplicité, son potentiel, sa force. Ta conscience tente de se rassurer mais là encore ce n’est qu’une ruse du corps pour s’intégrer à la société. (p. 11-12)
Un cercle vicieux c’est comme les tourniquets dans les parcs pour gamins : faut sauter avant de gerber ! Ça faisait un bon bout de temps que je restais assis là, sur le tourniquet, à me demander si mon cerveau avait pas attrapé la gangrène, et puis je me suis éclipsé. (p. 68)
Quand je m'affaisse un peu trop en moi, pareil à un vieux chien qui s'oublie derrière sa frange de chinoise, je suis assailli par une armée de tics qui me sursautent dessus. je ressasse. Je repense aux hontes, ça me brûle avec plus d'intensité que de l'huile bouillante qui pétille et explose dans une poêle, ça pénètre jusqu'au creux de la chair et ça fait chanter les os. Il faut que j'aille au bout de mes forces, que je me débarrasse de cette énergie qui se retourne contre moi à la nuit tombée. (p. 91)
If I ran the circus. Tout s'enchaîne à la ronde. Main dans la main, les ressemblances glissent les unes dans les autres avec un couinement de paupière astiquée contre la cornée. Toute chose en évoque une autre et les souvenirs se pêchent à la ligne. Le fil d'Ariane se rembobine pour former une balle dorée, un monde, une galaxie, qui tombe au fond du puits. La cotonnade du temps s'effiloche, le fil des années s'adoucit. (p. 109-110)
L'âme humaine est un invisible fluidique qui obombre le corps, l'intellect ne se plonge pas directement dans la matière mais l'enveloppe comme une ombre pour lui transmettre une faculté vitale, pour étendre le corps et accroître sa puissance. Les ombres ectoplasmiques qui viennent habiter parmi nous suturent la nature, animent le monde et font tourner les tables. Le poète est celui qui voit les ombres. Vivre c'est vivre au cœur du subtil. (p. 117)
Un avion gomme une bande blanche sur le bleu ciel uni. J'ai trois ans, je me cramponne au grillage en fer de la cour d'école. je regarde les voitures qui s'enfuient. Je suis crucifié par le gémissement de cet avion qui déchire le ciel de ma chair enfantine, et craquèle mon cœur en forme de boîte en porcelaine blanche. Si tu ouvres la boîte, tu la trouveras, la tristesse pure et vide, qui n'a pas de but et qui ne veut rien dire, la nostalgie utérine, le sanglot long des violons. Derrière moi, on entend les enfants qui bourdonnent et qui se battent. Mais la vie est trop courte. (p. 120)
Alizé Meurisse, Pâle sang bleu (Allia, 2007)
Pâle sang bleu est le premier roman d’Alizé Meurisse, née à
Fontenay-aux-Roses en 1986.
Au début son écriture surprend et agace presque, mais elle finit par emporter
et séduire : montée serrée, zappée, mixée, elle savoure les mots, le sens
y glisse sans cesse d'une métaphore à l'autre, le « je » sans cesse
s'y transporte sans crier gare d’un personnage à l'autre (et ils sont
multiples) ... jusqu’à habiter un écureuil bleu pas si stupide (p. 105).
Lire, en ligne, une critique de Laurence Bourgeon (Zone littéraire)
vendredi 21 décembre 2007
Par cgat le vendredi 21 décembre 2007, 01:46 - édition
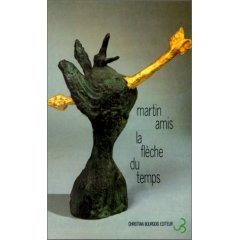
Pour Boris Vian et Fernando Pessoa, pour Antonio Tabucchi, Enrique Vila-Matas
ou Antonio Lobo Antunes, pour Jean-Christophe Bailly, Linda Lê, et tous les
autres … merci à Christian Bourgois, qui est mort hier.
Mais le show éditorial doit continuer, et la rentrée d’hiver s’annonce riche : 367 romans français dont 74 premiers romans, nous dit Livres Hebdo.
On leur souhaite à tous une longévité comme celle de L’élégance du hérisson, qui figure toujours, en 66e semaine (!) à la 2e place dans le classement Romans, entre le Renaudot et le Goncourt.
jeudi 20 décembre 2007
Par cgat le jeudi 20 décembre 2007, 00:43 - écrivains

Il est interdit de fumer - mais la famille de maman a bâti sa fortune sur le tabac. Des plantations de tabac à l'infini, jusqu'en Virginie, jusque dans le Maryland. Je suis la fille du juge, la petite-fille d'un sénateur et d'un gouverneur : je fume et je bois et je danse et je trafique avec qui je veux. Les jeunes pilotes de la base se seraient battus pour un signe de moi et lorsque enfin je leur accordais une danse je voyais leurs joues dorées s'étoiler de fossettes. Il y en avait deux qui rivalisaient de témérité pour m'avoir, ils détournaient leur avion tandem des couloirs aériens militaires et mettaient le cap sur Pleasant Avenue. Arrivés au-dessus de notre jardin, ils faisaient des figures dans le ciel, des loopings, des piqués, des tonneaux - et tout ça était si drôle, si terriblement excitant, si chevaleresque ; même Minnie était fière de l'hommage rendu à sa poupée blonde. Un jour de malchance ou de fatigue, le biplane est parti en vrille, et tous les jardins alentour ont retenu leur souffle jusqu'à ce que retentît plus loin, au-delà des faubourgs, le bref vacarme du crash. Une longue torchère s'éleva au-dessus des toits. Deux jeunes corps partaient en fumée dans une odeur noire de kérosène - deux jeunes corps qui la nuit d'avant dansaient sur leurs jambes immenses et souriaient de leurs joues étoilées, sentant si bon l'odeur des garçons bien, le cuir souple, le savon brut et, sous la fraîche eau de Cologne, tandis que l'effort de la danse noyait leur front de sueur et que l'odeur du corps reprenait le dessus, ce si troublant parfum de sauvagine où je baignais, serrée entre leurs bras, effrayée, ivre et heureuse.
Leur consomption dura deux minutes - un bûcher éclair, généreux, puissant et rapide à l'image de ces deux garçons qu'il dévorait. Il paraît que j'ai eu une crise alors, - la première -, et qu'on m'a donné de la morphine pour m'apaiser.
Depuis l'accident, une bonne partie de la ville professe que je suis le diable à tête blonde. Noir et or, oui.
Je suis une salamandre : je traverse les flammes sans jamais me brûler. C'est de là que me vient mon nom, parce que Minnie avait terriblement aimé une Zelda de papier, héroïne d'un roman oublié qui s'intitulait La Salamandre - et cette Zelda était une fière danseuse gypsie. (p. 32-33)L’explication de la vie n'explique rien.
Plus je me livre au jeune docteur du Highland Hospital, plus je mesure l'échec de l'intelligence à saisir son essence. J'en ai tant vu de ces docteurs. (« Au moins cent! » affirme Scott et j'entends qu'il fait l'addition des honoraires.)
Celui-ci est jeune, et doux, son regard bleu marine me regarde sans me disséquer ni me soupçonner.
Treize mois dans ma vie - cela semble peu mais c'est bien trop déjà -, j’ai dû me cacher pour écrire. J'avais trente et un ans. J'acceptais pourtant l'empire et l'emprise sur moi d'un époux jaloux, névrosé et perdu. Jusqu'au jour où c'est devenu invivable.
Et pour une fois, depuis dix ans, depuis vingt cliniques au moins sur les deux continents, cette fois enfin le jeune docteur m'a dit : « Je vous crois. » (p. 95)Car le monde nous abîme maintenant. ils disent que Scott vieillit trop vite, qu'il grossit, que l'alcool le défigure. Mais que croient-ils, les imbéciles ? Ses livres lui passent par le corps, ses romans trop rares et ses textes mercenaires tellement, tellement nombreux. Accessoirement, ses livres sont passés par mon corps aussi. Les gens, écrire, pour eux, c'est comme une longue conversation que l'on aurait avec soi-même, comme une confession devant le prêtre de la famille (je me rappelle le presbytère de Saint-Patrick, tout le laïus catho de ce curé irlandais qui sentait la friture et j'avais mal au cœur à cause des tubéreuses en vase sur le petit autel, les tubéreuses et l'huile rance, leur parfum capiteux mêlé au graillon, la tête me tournait, mauvais ménage, me disais-je, dangereux mariage, j'ai cru défaillir, tomber sur le pavé noir et blanc), et pour d'autres encore, écrire c'est comme se coucher devant un monsieur ou une demoiselle Freud.
Mais non : écrire c'est passer tout de suite aux choses sérieuses, l'enfer direct, le gril continu, avec parfois des joies sous les décharges de mille volts. (p. 96)Je sais ce qu'on dit de moi. Ce que vous ont dit Scott, ma mère, mes soeurs.
Ils mentent, ou disons : ils se trompent. Scott et moi nous avions besoin l'un de l'autre, et chacun a utilisé l'autre pour parvenir à ses fins. Sans lui, je me serais retrouvée mariée au garçon gris, le substitut du procureur d'Alabama, autant dire que j'aurais été me jeter dans le fleuve avec du plomb plein les poches. Sans moi, il n'aurait jamais connu le succès. Peut-être même pas publié. Ne croyez pas que je le déteste. Je fais semblant de le haïr. Je l'admire. J'ai lu ses manuscrits, je les ai corrigés. Gatsby le Magnifique, c'est moi qui ai trouvé le titre, tandis que Scott s'enlisait dans les hypothèses saugrenues. J'estime mon mari, professeur. Mais cette entreprise à deux, ce n'est pas l'amour. (p. 115)Gilles Leroy, Alabama song (Mercure de France, 2007)
Bien qu'il ait reçu le prix Goncourt, Alabama song est un bon roman, dont l'écriture rapide, rageuse, fragmentaire adopte sans hésitation le point de vue de Zelda sur Scott, et de Leroy sur Zelda, sans trop chercher à expliquer ce qui ne peut l'être.
mercredi 19 décembre 2007
Par cgat le mercredi 19 décembre 2007, 00:57 - écrivains
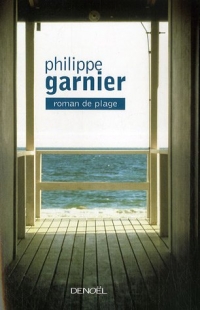
Il cherchait une petite porte pour passer de l'autre côté de la chaleur, mais il n'était plus très sûr de la trouver. Qui lui avait dit que le corps mettait trois jours à s'habituer ? Au bout d'une semaine, il avait toujours l'impression d'être enfermé du mauvais côté du mur. Cinq degrés de plus qu'à Caracas, et surtout cette humidité qui pesait sur chaque cellule de son corps. Il se leva pour faire quelques pas au soleil en examinant avec angoisse les deux iguanes apprivoisés du club qui s'exposaient à la lumière. La veille, il avait essayé un peu de Xanax, pour se détendre, mais le goût lui restait dans la bouche et il ne savait plus d'où lui venait cette amertume persistante, si c'était l'eau suspecte et irisée de la piscine, la bière Polar qu'il était seul à extraire du grand réfrigérateur du self ou cette odeur de plastique rance qui imprégnait tout, la plage, le kiosque et les chambres. Ses vieilles armes le lâchaient. Le Xanax l'avait plongé dans une légère sensation d'asphyxie. Il ressassait un certain nombre de conseils, comme de ne pas boire de rhum, sous peine de sentir son cerveau envahi par une bulle visqueuse, brouillant sa vision, rendant même hasardeuse sa progression vers le petit bassin où les enfants, eux, semblaient avoir trouvé la porte magique pour vivre heureux dans l’étuve. Le problème du touriste, se disait-il planqué dans la salle du ping-pong, la seule climatisée à cette heure mortelle, le problème du touriste c’est qu’il reste un enfant attardé à qui on continue de promettre une journée formidable et pleine de surprises. Et cette attente, qu’il sait illusoire, contamine le peu de liberté qu’il s’accorde. elle l’oblige même à faire semblant, par contrat, de croire en des instants de plus en plus factices. (p. 9-10)
(…) ils feraient gravement le bilan de la journée au club, avec la même pauvreté dans l'échange qu'au fil de l'année dans leurs communications téléphoniques Paris-Caracas, où il était question de carnet scolaire et de progrès en natation. Stéphane n'était pas dupe et ne comprenait pas que Pablo se prête à ce jeu, on aurait dit un répertoire de théâtre japonais avec des masques hiératiques dans une version bon enfant, je te parle, moi ton fils comme à mon père et s'il te plaît fais un effort. Dans un instant de lucidité, il se demanda pourquoi son fils ne se mettait pas soudain à hurler « tu n'es rien du tout, tu n'es pas un père, tu n'es rien, je prends n'importe qui sur cette terrasse de restaurant, n'importe qui fera l'affaire mieux que toi et en plus, tout cela t'arrange, tu vas pouvoir enfin disparaître ! ». Or, c'était bien à lui que son fils s'adressait tranquillement tout en mangeant des frites, c'était bien lui qui devait répondre. Ainsi avait-il imaginé la vie des dernières familles royales, occupant une place à laquelle personne ne croyait plus, mais tenus de faire semblant de parler, d'agir et de manger dans des dîners de poupée, faire semblant de vivre en couple et semblant d'exercer le pouvoir. (p. 24)
Philippe Garnier, Roman de plage (Denoël, 2007)
Un club de vacances délabré aux allures de pénitencier dans lequel tout le monde fait semblant est le cadre d'une histoire improbable, oppressante et presque kafkaïenne, mais néanmoins drôle et légère, et terriblement universelle.
Philippe Garnier est né en 1964.
Il a publié deux essais :
La tiédeur (Presses universitaires de France, 2000)
Une petite cure de flou (Presses Universitaires de France, 2002)
et un autre roman :
Mon père s'est perdu au fond du couloir (Melville, 2005)
deux critiques en ligne :
- Nathalie Crom (Télérama)
- Benjamin Berton (fluctuat.net)
mardi 18 décembre 2007
Par cgat le mardi 18 décembre 2007, 00:44 - blogs et internet
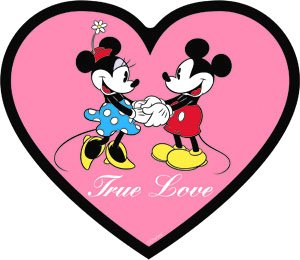
« Et alors ? Pourquoi ces airs surpris ? Quoi de plus banal pourtant qu’un manipulateur tenant un mannequin par le bras dans une parade de Mickey ? »
Éric Chevillard, L'autofictif
::: une raison de plus pour ne jamais mettre les pieds à DisneyLand :
nous avons passé l’âge qu’on nous raconte des histoires de mickeys et de minnies !
::: autre triste nouvelle : Alain Korkos annonce le dernier billet de la Boîte à images !
::: et Isabelle Aveline jette une bouteille à la mer
::: tandis que François Bon regrette que les nouveaux venus dans l'internet littéraire ne respectent pas les anciens ... voilà qui est un peu naïf : ils sont, comme super-mickey, « décomplexés », et l’ancienneté est aujourd'hui moins que jamais une qualité !
::: quant à moi, je ne m’explique absolument pas une hausse soudaine de la fréquentation de mes lignes de fuite ces derniers jours, alors que je me contentais de poster paresseusement quelques citations de Perros pendant un week-end consacré au devoir familial : m'aurait-on citée en un lieu de forte audience ? prêté une relation avec super-mickey ? si quelqu’un peut m’indiquer une piste possible, je l’en remercie chaleureusement (aucune récompense n’est prévue, afin de ne pas favoriser la délation, très à la mode ces temps-ci).
lundi 17 décembre 2007
Par cgat le lundi 17 décembre 2007, 00:26 - citations
J'ai l'esprit de fuite.
Georges Perros (Papiers collés, I, Gallimard, L'Imaginaire, 1960, p. 66)
« billets précédents - page 32 de 57 - billets suivants »