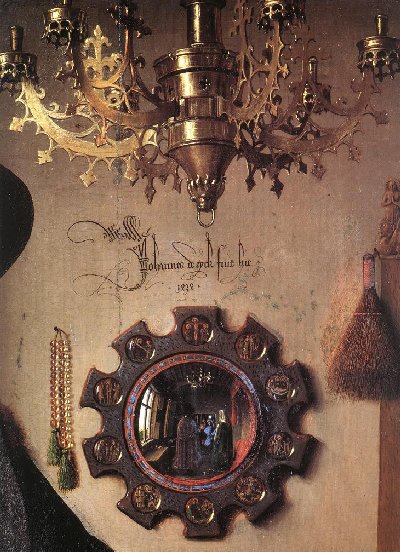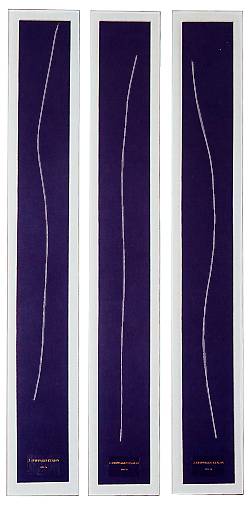J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes, de l'arrière-automne,
avec une prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le
déclin de la saison soudain singulièrement envahies par le silence. Elle vit à
peine, cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe
claire et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoxe va fuir et
soudain découvrir comme les brisants marins de septembre ces grottes
de brique et de béton, ces stalactites de rocaille, ces puériles et attirantes
architectures, ces parterres trop secourus que le vent de mer va ravager comme
des anémones à sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant
tête-à-tête avec la mer, faute de frivolités trop rassurantes, va reprendre
invinciblement son rang plus relevé de fantôme en plein jour. Sur le front de
mer les terrasses vitrées, mortes, leurs ferronneries mangées de lèpres
salines, angoissent comme des bijouteries mises au pillage, - le bleu usé,
lessivé, des volets clos sur des fenêtres aveugles recule soudain
incroyablement dans le temps le reflux de vie responsable de cette décrépitude.
Pourtant, sous le soleil aigrelet d'une matinée d'octobre, des bruits naissent,
se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un
dormeur - la barrière blanche d'une clôture de bois craque, une sonnette se
répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue avide. Je rêve. Qui
s'annonce ici avec une telle solennité ? Il n'y a personne ici. Il n'y a
plus personne.
Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre
de la plage, je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun
assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit
sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la
rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante comme une rumeur d'émeute
au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre,
minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers,
flamboient, se résorbent en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes
rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent
où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques
fondamentales - une pigmentation subtile gagne çà et là, par flaques - le sel
pâlit l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles, le
vent de mer sable les planchers par les fentes des portes – une transgression
soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le
corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un
raz-de-marée à sec.
Il arrive que par certaines après-midi, grises, closes et sombrées sous
un ciel désespérément immobile, - comme sous la maigre féerie des verrières
d'un jardin d'hiver - dépouillées de l'épiderme changeant que leur fait le
soleil et qui tant bien que mal les appareille à la vie, le sentiment de la
toute-puissante réserve des choses monte en moi jusqu'à l'horreur. De
même m'est-il arrivé de m'imaginer, la représentation finie, me glisser à
minuit dans un théâtre vide, et surprendre de la salle obscure un décor pour la
première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues une nuit vides,
un théâtre qu'on rouvre, une plage pour une saison abandonnée à la mer tissent
d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierre que cinq mille ans,
et les secrets de l'Égypte, pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe
ouverte. Mains distraites, porteuses de clés, manieuses de bagues, mains
expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le
chaton qui rend invisible, - je devins ce fantomatique voleur de momies
lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante
devenu soudain plus perceptible, le soleil enfin disparut derrière les brumes
en cette après-midi du 8 octobre 19...
Julien Gracq, « Prologue », Un Beau ténébreux (Corti, 1945, p.
11-13)
Si en hommage à Julien Gracq j'ai envie de citer le prologue de Un beau
ténébreux, c’est que ce texte demeure attaché pour moi à un souvenir
précis : c’est en écoutant un commentaire virtuose qu’en faisait l’un de
mes professeurs, Henri Bonnet, que j’ai compris - et ressenti, comme une
émotion - l’intérêt de l’exercice de l’explication stylistique d’un texte
… et puis, comme Gracq, je goûte la mélancolie des plages désertées hors
saison, et j'aime la plage de Morgat, qu’il évoque ailleurs à propos de ce
texte :
Je rouvre quelquefois encore le prologue de Un beau Ténébreux,
roman que je n'aime plus guère. Parce qu'il me semble y retrouver, assez
fidèlement rendue, l'atmosphère à la fois limpide et triste, presque
recueillie, qui est celle des plages de septembre (et que j'ai peut-être
ressentie pour la première fois en visitant avec Queffélec et son frère, en
1931, la plage de Morgat et son grand hôtel vide où nous déjeunions
tous les trois).
Carnets du grand chemin (Corti, 1992, p. 177)