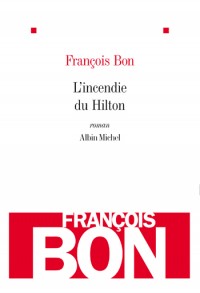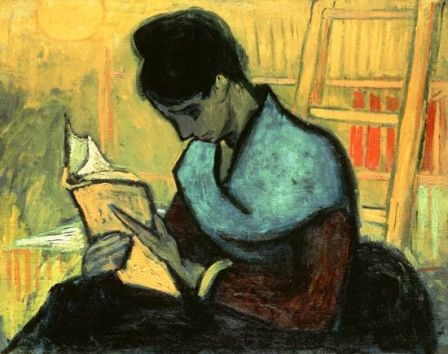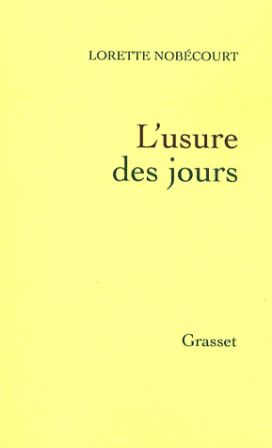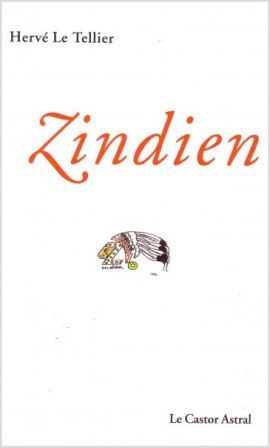Cet incendie du Hilton comme allégorie de la ville, et la ville comme
allégorie du monde : où étions-nous, quelle ville, quel monde, qui soudain
basculait dans son envers ? Il n'y avait plus de ville ni de temps :
ces galeries, et le bruit du monde, s'il nous parvenait, nous n'en étions plus
acteurs. Émigrants, plutôt, et jetés : à trois rues et une dizaine
d'étages d'où nous étions deux heures plus tôt, lors de la première alerte,
surplombant ce ventre souterrain dont nous devions être, trois jours durant,
les appendices. Garants de la continuité, d'un état stable du monde, et
voilà : entracte.
Quatre heures très précisément, juste un bloc de nuit. De 1 h 50 la première
sirène et l'appel, jusqu'à 5 h 50, et qu'on s'effondre, sans retrouver pourtant
le sommeil, avant journée blafarde à suivre. Et c'est maintenant, à dix
semaines de distance, que je rouvre ces heures. Un non-événement : le plus
parfait des non-événements. Des victimes, des blessés, des morts, dans
l'immense catastrophe ordinaire du monde : rien, aucun. Un bouleversement
de la ville, des ruines, un effondrement absolument pas. Juste cela, l'incendie
du Hilton, ce qu'on y cherche, ce basculement provisoire, et la ville cul
par-dessus tête.
Au moment de commencer, compteraient donc non pas des faits, mais le souvenir
de cette déambulation dans l'envers de la ville, soudain offerte : le
moderne montrait ses coutures. Alors cette attente, et l'incendie tout là-haut
sous les toits, un livre qui en serait non pas la restitution, encore moins
l'illusion, mais voudrait le redonner temps pour temps - quatre heures vécues,
quatre heures à lire. Construction de nuit, construction d'une ville ou de
l'envers d'une ville, construction d'un temps coupé de la grande loi du monde,
comme nous l'étions, et qui pourtant exhibait soudain à nu, très
provisoirement, toutes les lois cachées du monde. (p. 9-10)
J'ai toujours travaillé en double, avançant à la fois le livre et son
projet : dans les anciens carnets, en page de gauche des listes, des
bribes de plans et des éléments à se remémorer, des noms, des lieux. On note
des titres de livres, on découpe ou recopie des bribes d'articles, on stocke
des images, autrefois découpées, maintenant repiquées sur l'écran, on bricole
des plans, des schémas avec des flèches et des assemblages, puis ces bouts de
phrases, celles qui viennent dans la nuit, qu'on tient précautionneusement
devant soi au lever pour les déposer dans le cahier qui les garde, la date avec
le texte, ou juste comme ça, dans la rue. Et puis, autrefois page de droite des
carnets, le récit linéaire, ses ajouts, reprises, corrections. Je gardais tout
cela dans une vieille valise noire mais longtemps que l'ordinateur avait mangé
d'abord les versions en cours, puis les carnets eux-mêmes.
De même j'aimais ces stylos-plumes de marque Schaeffer, au lourd corps de métal
noir brossé, et leur capacité de tenir une écriture à la fois minuscule et
grasse. Je ne supporte pas, s'il s'agit de récit, ce qui porte atteinte à la
vitesse : le clavier aujourd'hui le permet, ils sont sur une plaque
souple, on s'habitue à les utiliser sans voir et c'est comme ça que j'entame ce
texte, première heure, juste au lever, avec un bol de café et le silence du
dehors, la nuit pas encore défaite, l'ordinateur tenu sur les genoux dans
quelque recoin qui ne soit pas la table de travail et ses tâches du jour :
listes dans mini-bloc-notes hors du traitement de texte principal, schémas et
noms, déroulé des heures - et c'est nouvelle grotte ou nouveau labyrinthe, ce
qu'on peut associer à l'incendie du Hilton. (p. 15-16)
Des Salons du livre en général, et de celui-ci en particulier, j'ai peu à
dire : ce qui nous occupe n'est pas un métier, en tout cas ça se passe
ailleurs que dans ces entassements clos. Et ceux qu'on y croise, quand le
hasard vous y ramène, sont comme la partie morte de ce petit monde : on
dirait qu'eux ça leur convient, qu'ils n'en louperaient pas un de toute la
France, y ont leurs habitudes presque comme d'un portemanteau réservé. Certains
de mes plus proches amis, on peut se voir une fois tous les deux ans, c'est
bien le roulement de temps qu'il nous faut pour avoir accumulé de quoi exprimer
ce qu'on a (si je prenais ses mots à lui) ou conquis, ou vaincu, ou déplacé -
ou bien, au contraire, là où on s'est résigné, et dont on laisse à d'autres le
soin d'investir le territoire aperçu, sombre, hostile. C'était un Salon comme
les autres, et sans cette table ronde sur le numérique je n'aurais pas, de
moi-même, eu le souhait d'y participer, ni même d'y traîner : le livre,
pour ses lecteurs, est un objet rare, personnel, et non pas ces accumulations
en masse qui en mêlent toutes les catégories, vous donnent le tournis, tout en
vous faisant respirer cette poussière des allées de ciment brut, ici aggravée
par les sous-sols. (p. 51-52)
Utiliser des noms de personnes, existantes, qu'elles aient réellement été à
ce Salon du livre de Montréal, ou bien que je les y convoque fictivement, au
nom de la logique même de mon récit : ne rien laisser qui permette de
trancher. Organiser même, en amont et rétrospectivement, les traces Internet
qui construisent l'ambiguïté, ça doit pouvoir se négocier. (p. 158-159)
Consciencieusement évacuer toute version intermédiaire : ça m'aura aidé
à avancer. Reste celles que j'envoie régulièrement, en cours de travail, à une
boîte aux lettres créée il y a déjà quatre ou cinq ans uniquement pour cela, et
dans laquelle je n'ai jamais fait le ménage, n'ayant jamais eu besoin de
l'ouvrir. Étrange de penser à ce genre de dépôt. (p. 180)
Titre de travail, tout au long de la rédaction : Typologie de
l’incendie du Hilton. Tenté aussi : Nouveau Monde. (p.
183)
François Bon, L'incendie du
Hilton (Albin Michel, 2009)