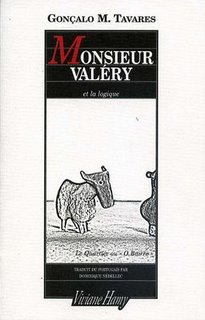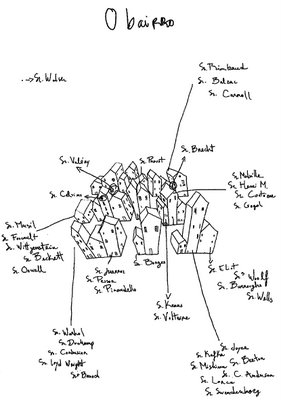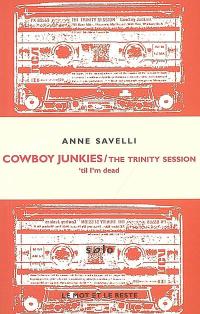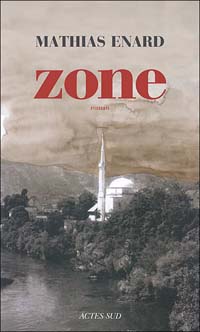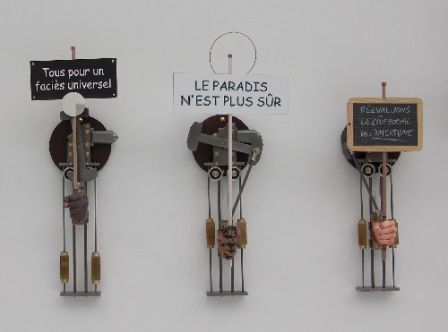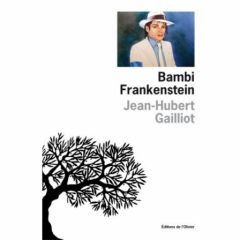
Wacko Jacko en offrait toujours plus ! Cela faisait longtemps qu'il donnait le spectacle d'une douloureuse entredévoration de l'image et du modèle, sans qu'il soit possible de déterminer ce qui chez lui était premier. Personne n'aurait su dire s'il s'incarnait plutôt dans l'original ou le reflet. Ou encore dans leur hypothétique entre-deux. Deux miroirs se renvoyant leur propre néant déformant ? Dans la surenchère au sublime et au grotesque qui, depuis la nuit des temps médiatiques, mettait aux prises les principes de Réalité et de Fiction au sein de chaque individu, mais jamais à un degré plus pathétiquement déchirant que dans le personnage de mutant hybride que s'était composé Michael Jackson (p. 15-16)
Le martyre d'un genre nouveau qu'endurait Michael Jackson, cet être mal défini, ni tout à fait toon ni tout à fait humain, ni vraiment noir ni vraiment blanc, ni enfant ni adulte - son martyre spécial ne tenait-il pas à sa faculté unique d'accueillir toutes les tares et contradictions de l'époque : l'amour de la nature, les phobies, le culte de la beauté, le métamorphisme, la jeunesse éternelle, la cryogénisation, la candeur de Bambi, le déchaînement de la violence, l'ubiquité, l'ennui, la chirurgie plastique, les films d'horreur et particulièrement ceux avec Boris Karloff et Vincent Price, la pudeur, le sexe extrême, la différence érigée en horizon moral indépassable, les clones, la réclusion, l'exhibitionnisme - non seulement de les accueillir, ces tares et contradictions, sans en rejeter aucune, mais de les incarner dans la chair étrangement composite qui était la sienne à leur degré maximum ? Son apparence, sa voix, son art, ses comportements, tour à tour outranciers ou doucereux, étaient-ils autre chose que la tentative de contenir, dans une même et frêle enveloppe corporelle, cette effrayante énergie disruptive ? Et si tel était le cas, cela n'en faisait-il pas un prophète de notre post-humanité ? voué à être adulé par les masses puis réprouvé par l'opinion - suscitant force extases glamour et pâmoisons collectives jusqu'en 1995 (cent trente-trois millions d'albums vendus, et combien de singles ? de tickets de concerts ?), le payant de la dérision populaire ensuite (les caricatures moquant l'homme-qui-avait-perdu-son-nez, les photos le montrant menottes aux poignets, les plaisantes perspectives de déconfiture financière, sanction logique de sa ruine morale et de sa décrépitude physique) - parce qu'il révélait dans la sphère publique ce que chacun de nous expérimentait déjà à petites touches dans la sphère privée, et vivrait demain au grand jour, comme lui, Michael « Bambi » Jackson, mais à doses de plus en plus élevées, exaspérantes, destructrices ?
Modèle ou créature, vous vivez dans l'imagination du public. La popularité est l'élément au sein duquel vous vous propagez. Mais plus votre popularité s'accroît et plus votre personnalité est diffractée, par le mental d'autrui, en une infinité de doubles, certains ressemblants, la plupart totalement aberrants. Pour tout personnage célèbre, tôt ou tard l'exigence de ressemblance cède le pas aux impératifs de la notoriété. « A-t-il jamais existé ? » en vient-on à se demander. On comprendrait qu'une créature comme Michael Jackson, si c'en est une, éprouve le besoin de rejoindre son modèle dans la réalité. (p. 23-25)PAR ANTICIPATION, ON POUVAIT LIRE SUR LA FIGURE ARTIFICIELLE DE BAMBI FRANKENSTEIN LE RÉCIT VRAI DE LA PURE FICTION QUE SERAIT BIENTÔT CHACUNE DE NOS VIES. (p. 34)
Jean-Hubert Gailliot, Bambi Frankenstein (L’Olivier, 2006)
Né en 1961, co-fondateur des Editions Tristram en 1987, Jean-Hubert Gailliot
a aussi publié :
- La Vie magnétique (L’Olivier, 1997)
- Les Contrebandiers (L’Olivier, 2000)
- L'Hacienda (L’Olivier, 2004)
- 30 minutes à Harlem (Petite Bibliothèque de l'Olivier, 2004)