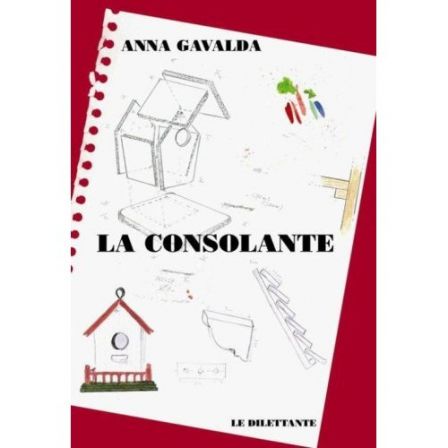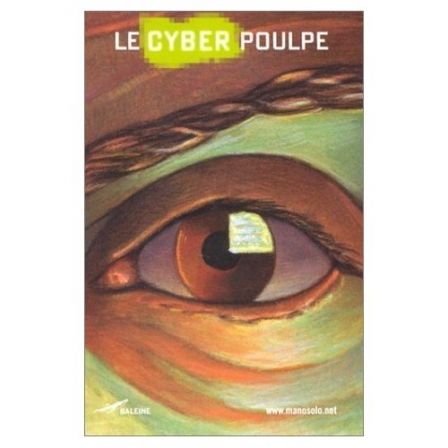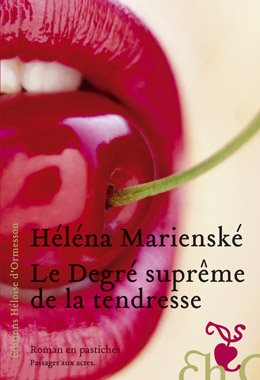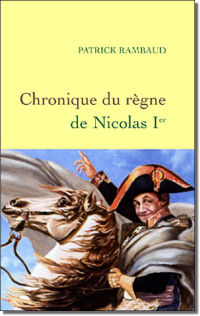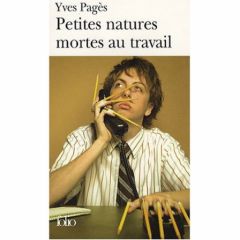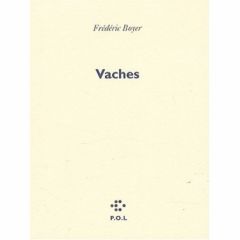J’avais onze ans moins des poussières et aucun goût pour m’enfermer à livre
ouvert, ni la patience après sept heures de tableau noir au collège. Même les
bulles des bandes dessinées, je préférais ne pas m’y attarder, m’en sortir
sans, et sauter les sous-titres aussi, en bas de l’écran, quand les films
parlaient en version très originale. Rien que les images c’était suffisant, ça
s’expliquait tout seul, contrairement à Marianne, qui cloîtrait ses heures
creuses dans sa chambre à part, droit d’aînesse oblige, prière de ne pas
déranger, silence on tourne les pages, pendant qu’elle se mettait en veilleuse
sous les draps pour dévorer en douce sa bibliothèque rose, puis verte, puis
dorée sur tranche jusqu’à mi-chemin d’insomnie.
Ce mardi 6 février 1973, vers 19 heures 15, pendant que ma sœur était censée
travailler ses gammes au Conservatoire, moi, j’étais tout bêtement sur mon lit,
plongé dans un bouquin de haute philosophie, studieux comme jamais. Si bizarre
que ça puisse paraître, je déchiffrais un grand classique d’un autre âge, sans
y piger grand-chose mais sans oser m’arrêter non plus, une ligne sur deux ou
trois, du bout des yeux, au kilomètre, juste pour avoir l’air innocent, le plus
absent possible, parce que j’avais peur de ce qui risquait d’arriver,
l’engueulade qui m’attendait à coup sûr dès que ma sœur serait rentrée. Je
voulais juste disparaître, en chien de fusil sur l’édredon, qu’on m’oublie
définitivement, mais comme, vers 19 heures 15, dans l’appartement, il n’y avait
personne pour confirmer que j’étais chez moi, en train de me cultiver, alors
personne n’a voulu croire à mon alibi et on m’a soupçonné d’avoir brouillé les
pistes exprès. Ensuite, c’est vite devenu impossible de démontrer le contraire,
parce que vingt minutes de solitude, à ce stade de l’enquête, c’était juste un
trou dans mon emploi du temps et, faute de témoin, à onze ans moins des
poussières, ma parole contre la leur, ça comptait pour presque rien. (p.
13-14)
À la première question, d'abord je n'ai rien dit, ça leur servait à quoi de
faire mine de pas savoir, alors que c'était écrit partout, sur l'étiquette
pendue à mon cartable, sur chaque protège-cahier, sur la carte de bibliothèque,
même cousu sur la doublure de mon anorak, et en grosses lettres sous une photo
du journal qui traînait sur la table, à côté de leur machine à écrire, mais
puisqu'ils insistaient, j'ai baissé la tête : Anselme. Et puis à la queue
leu leu Romain Yves Émile.
À la deuxième question, j'ai préféré jouer franc jeu Onze ans moins des
poussières, tout en devinant dans leur sourire en coin que ça sonnait un peu
faux. T'avais dix ans tout court, dix et demi à la limite, mais avec eux chaque
mot comptait double ou triple, comme au Scrabble, alors mes poussières en plus
ou en moins, ça ne tombait pas juste. J'avais intérêt à rester bien droit sur
ma chaise, sans me ronger jusqu'au sang, surtout les peaux mortes de l'index,
qui dépassaient du sparadrap, pour ne pas gâcher l'examen et que je me rachète
une bonne conduite. (p. 29)
Eux aussi, ça se voyait qu'ils avaient dû lire M. Kant et ses maximes
catégoriques. Alors ils cherchaient à me tirer les vers du nez et le nom de mon
complice, son âge, sa profession, parce que c'est lui, en me cachant, qui
s'était mis hors la loi, et ça, il n'aurait pas dû pouvoir le vouloir, parce
que nul n'est censé ignorer la nature fragile des enfants, c'est du bon sens
universel, et en plus qui ne dit mot consent, et d'ailleurs celui qui consent à
ne rien dire, c'est sa faute par omission, il n'avait qu'à pas garder le petit
menteur et son secret dans le même sac, le beurre et l'argent du beurre, sinon
c'est un cas très particulier d'enlèvement, un vrai péril en sa demeure, un
outrage pervers à la vérité sur autrui, une assistance personnelle au danger,
bref un délit de fuite dans les idées, et à la une de Détective ou de
France-Soir, ça se paie d'une tête mise à prix.
Voilà, il était prévenu, et maintenant que j'étais délivré de ma promesse,
j'avais intérêt à retourner dans le droit chemin, pour ne pas m'enfoncer plus
bas, et laisser tomber ce faux ami qui m'avait poussé à la faute et aussi fait
pousser des ailes en traître, dans le dos de mes proches parents et des
autorités en uniforme, c'était mon tour de briser son silence dans l'œuf. (p.
36-37)
Yves Pagès, Le
soi-disant (Verticales, 2008)
Yves Pagès aime explorer à travers les yeux de l’enfance les distorsions de
la réalité : dans Le
soi-disant, il emprunte les mots de Romain, « onze ans moins des
poussières », innocent et coupable à la fois au milieu des enquêtes policière,
judiciaire et psychiatrique, pour raconter un fait divers qui marqua les années
70, l'incendie du collège Edouard-Pailleron. Bien entendu, le « soi-disant
», c'est celui qui se dit, mais aussi le soit-disant réel, qui s'échappe sans
cesse tandis que se multiplient les glissements du langage, les hypothèses et
les fausses pistes, avec comme fil rouge la lecture, impossible, de la
Métaphysique des mœurs d’Emmanuel Kant.
Yves Pagès est né en 1963 et travaille aux éditions
Verticales. Il a publié :
un essai, Les Fictions du politique chez L.-F. Céline (Seuil,
1994)
Les Gauchers (Julliard, 1993, Points Seuil 2005)
Prières d’exhumer (Verticales,1997)
Petites natures mortes au travail (nouvelles, Verticales, 2000, Folio
2007)
Le Théoriste (Verticales, 2001, Points Seuil 2003, Prix
Wepler-Fondation La Poste 2001)
Portraits crachés (Verticales, «Minimales», 2003)
en ligne : un entretien
avec Rebecca Manzoni (éclectik)