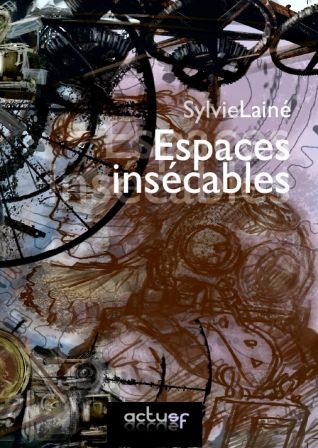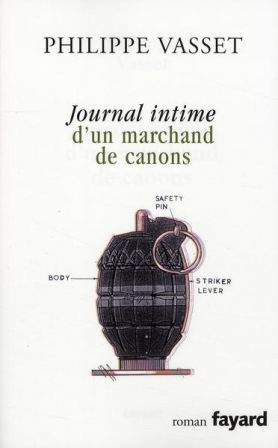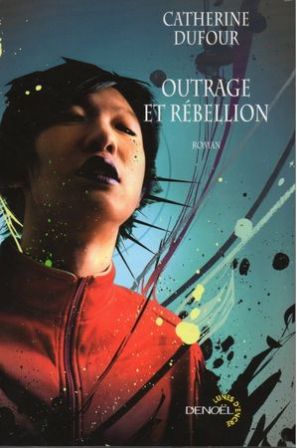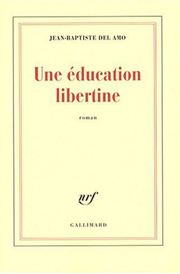AVERTISSEMENT
Journal intime d'un marchand de canons est le premier volume d'une
série qui se poursuivra avec Journal intime d'un affameur, Journal
intime d'un manipulateur, et d'autres titres encore.
À l'origine du projet, l'écart sans cesse grandissant entre les fictions dont
on nous abreuve ad nauseam et un réel presque invisible, comme relégué
à la périphérie du champ de vision. Faits de la même matière molle, douceâtre,
envahissante, les romans, les sitcoms et les blockbusters ne
suscitent plus qu'un désir réflexe, presque inconscient, semblable à celui de
la salivation activée par l'odeur des frites et du hamburger encore
chaud.
En arrière-plan de ces histoires prémâchées s'agite un réel globalisé dont on
ne sait rien ou presque : échanges confus, soubresauts incompréhensibles,
violence irraisonnée... La présente série voudrait se confronter à ce jeu de
flux et éprouver la fiction aux pointes les plus acérées du réel. Chaque
épisode se propose de décrire le fonctionnement d'un pan de l'économie
mondialisée habituellement soustrait aux regards. Rien n'y sera inventé :
les événements relatés dans chaque épisode auront effectivement eu lieu, les
noms seront les vrais, tout comme les dates.
Malgré ce parti pris de véracité, cette série n'est pas une enquête
journalistique : celui qui dit « je » dans les pages qui vont
suivre, s'il énonce des faits véridiques, n'existe pas. Ses agissements, sa
carrière et son emploi du temps, bien que parfaitement vraisemblables, ont été
inventés pour ménager un point de vue interne dans un système mondial
habituellement appréhendé de l'extérieur.
Philippe Vasset, octobre 2008. (p. 9-10)
Je me suis toujours beaucoup préoccupé du degré de romanesque de ma vie. La
plupart de mes homologues diront qu'ils se sont retrouvés à vendre des armes un
peu par hasard : pas moi. J'ai spécifiquement choisi ce métier dès ma
sortie d'école de commerce parce qu'il permet, voire encourage, l'inattendu, le
hors-norme, le spectaculaire. Faisant le pied de grue dans l'antichambre
surchargée d'une résidence moyen-orientale, un catalogue de missiles à la main,
je me félicitais secrètement de la coïncidence presque parfaite entre ma
situation et une scène des romans d'espionnage que je dévorais avec ferveur. Si
les portes richement ornées de la salle finissaient par s'ouvrir sur un salon
tapageur occupé par des militaires ombrageux et des cheikhs ventripotents, je
jubilais. Si elles ne découvraient en revanche qu'une salle de réunion occupée
par trois jeunes fonctionnaires en costume, j'avais du mal à cacher ma
déception et ne pouvais m'empêcher, tout en récitant avec conviction mon
argumentaire commercial, d'espérer que la conversation prendrait un tour moins
convenu (demande de pots-de-vin, complot, opérations illégales : les
possibilités ne manquent pas, tout de même!). (p. 11-12)
Dans n'importe quel film, ce genre d'information serait immédiatement suivi
du plan panoramique d'un avion en train d'atterrir sur fond de collines
verdoyantes, tandis que s'afficheraient en bas de l'écran la date, l'heure et
le lieu (« Pretoria, Afrique du Sud, 14h53. Température extérieure :
40° »). Dans ma réalité hélas dépourvue d'avance rapide et de fondus enchaînés,
cet atterrissage n'a pu avoir lieu qu'après des adieux circonstanciés à mon ami
le juge, la rédaction de rapports d'étapes à l'intention de ma direction, et un
long et inconfortable voyage en avion d'où j'ai émergé hagard et affublé d'une
valise qui n'était pas la mienne. (p. 76)
Je fais de mon mieux pour me concentrer sur la route, la signalisation, le
paysage, mais, régulièrement, l'image surgit : je vois ma voiture
renversée dans le fossé. Du coffre ouvert par le choc s'échappe des tourbillons
de papiers frappés du sigle « Confidentiel Défense » que, titubant,
les tempes ensanglantées, j'essaie de rattraper. Agrémentée d'une musique un
peu mélodramatique et filmée en surplomb, une telle scène serait idéale pour
clore un thriller. Mais j'espère encore échapper aux clichés. (p. 83)
Mes archives détruites, ma vie se résume à des lignes droites et
claires : les pleins et déliés ont disparu. Seuls mes carnets de notes
peuvent encore attester que mon existence fut autre chose qu'une carrière sans
éclat.
Pour conserver une trace des moments vécus, j'ai pris l'habitude de les
retranscrire. D'abord sous forme d'un journal intime, puis, la sentimentalité
inhérente à cette forme me convenant mal, dans de simples cahiers classés par
année. Le processus d'écriture est très codifié. Je commence par raconter
oralement les événements dont je veux me souvenir à des amis, des inconnus ou
des collègues, pour en fixer les contours et la forme. Quand le choix des mots
et la trame de l'histoire cessent d'évoluer d'un récit à l'autre, je les
consigne. Régulièrement, je reprends ces textes momifiés pour leur ajouter une
couche de bandelettes, des parures, des trophées, puis les recopier sous leur
nouvelle forme dans d'autres cahiers. Effort de toute une vie pour faire
coïncider le réel avec mon désir, ce lent travail d'embaumement ne connaît pas
de fin. (p. 127-128)
Les phrases qui pourraient décrire mon état ont tellement servi que leurs
motifs usés ne veulent plus rien dire : je « repasse le film des
événements dans ma tête », je « tourne en rond comme un lion en cage »,
etc. Pour me vider l'esprit, j'entreprends des tâches physiques
épuisantes : j'abats des arbres, je fauche l'herbe, je draine les
étangs... Mon jardinier me regarde faire, mi-amusé, mi-inquiet. Au bout d'une
semaine, sans doute lassé de me voir endommager les allées et défigurer la
forêt, il m'invite à chasser. Après toute une vie passée à vendre des systèmes
d'armes sophistiqués, j'erre parmi les fougères avec, sous le bras, une pétoire
vieille de vingt ans. Nous marchons toute la journée : je manque presque
tout ce que je tire. (p. 132)
Philippe Vasset,
Journal intime d'un marchand de canons (Fayard, 2009)