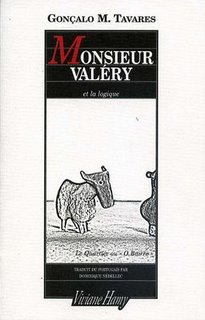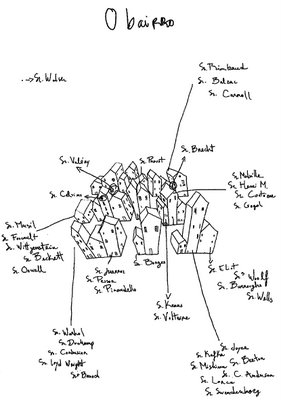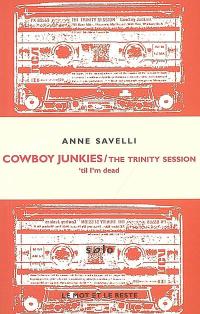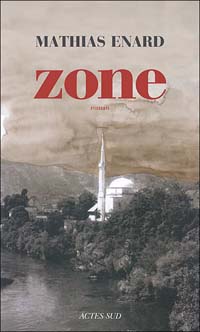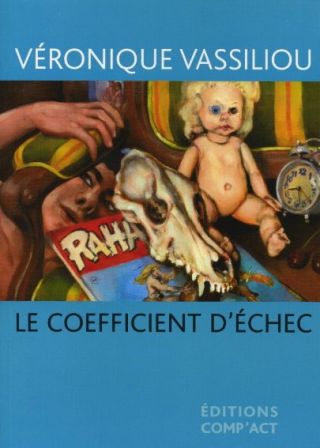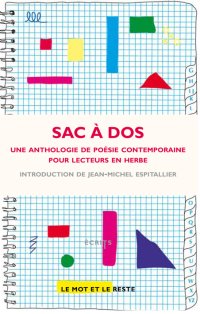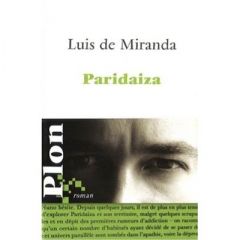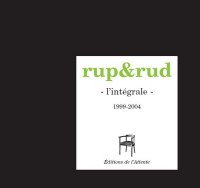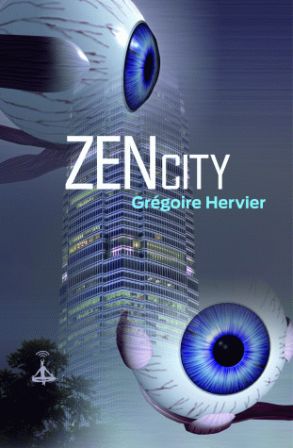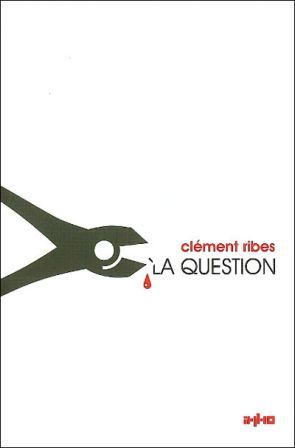le trajet est prévisible, malgré la pénombre il y aura Reggio d'Emilie puis
Modène Bologne Florence et ainsi de suite jusqu'à Rome, sa douceur de fruit
trop mûr, Rome, ville pourrissante flamboyante et cadavérique dont on comprend
trop bien la fascination qu'elle peut exercer sur certains, Rome et la valise
que je vais y remettre le temps que je vais y passer peut-être le choix est
fait le choix est fait depuis que la déesse chanta la colère d'Achille fils de
Pélée, son choix guerrier son honneur l'amour que Thétis sa mère lui portait et
Briséis son désir qu'Agamemnon détenait comme Pâris possédait Hélène, celle qui
m'attend à Rome dans ses plus beaux péplos, peut-être, comme le train ralentit
à présent à l'approche d'une gare, que l'ennui me prend, de l'autre côté du
couloir un homme d'une cinquantaine d'années fait des mots croisés avec sa
femme dans une revue intitulée La Settimana enigmistica, la semaine
énigmatique ou peu s'en faut, sa femme a l'air bien plus jeune que lui, à l'âge
d'homme tout est plus difficile, dans le néant de l'indécision qui est le monde
des voies et des aiguillages, elle m'attend, j'aime à croire que Sashka
m'attend, (p. 113)
tout est plus difficile à l'âge d'homme vivre enfermé en soi entrechoqué
miséreux empli de souvenirs je ne fais pas ce voyage pour rien, je ne me
recroqueville pas comme un chien dans ce fauteuil pour rien, je vais sauver
quelque chose je vais me sauver malgré le monde qui s'obstine à avancer
péniblement à la vitesse d'une draisine manœuvrée par un manchot, en aveugle un
train la nuit dans un tunnel le noir encore plus épais j'ai dû dormir un
moment, si seulement j'avais une montre, je n'ai qu'un téléphone, il est dans
ma veste à la patère, mais si je le prends je vais être tenté de vérifier que
je n'ai aucun message et d'en envoyer un, toujours la passion pour les
télégrammes, envoyer des signes dans l'éther comme des signaux de fumée des
gestes sans objet des bras des mains tendues vers le néant, à qui pourrais-je
envoyer un message, depuis ce téléphone à carte que j'ai pris soin de faire
acheter par un clochard moyennant un gros pourboire, par chance il avait une
pièce d'identité et n'était pas trop délabré, le vendeur n'a pas fait de
difficultés, j'ai quitté mon appartement laissé quelques affaires chez ma mère
vendu mes livres en vrac à un bouquiniste de la porte de Clignancourt pris
trois quatre trucs, (p. 139
- curieux cette passion pour la lecture, un reste de Venise, de Marianne
grande dévoreuse de livres, une façon de s'oublier de disparaître corps et
biens dans le papier, petit à petit j'ai remplacé les romans d'aventures par
les romans tout court, la faute à Conrad, à Nostromo et au Cœur
des ténèbres, un titre en appelle un autre, et peut-être sans bien
comprendre, qui sait, je me laisse porter, page après page, et bien que j'aie
passé déjà une grande partie de ma journée de fonctionnaire trouble à lire -
des notes, des rapports, des fiches, sur mon écran bien gardé - il n'y a rien
alors que je désire plus qu'un roman, où les personnes soient des personnages,
un jeu de masques et de désir, et petit à petit m'oublier moi-même, oublier mon
corps au repos dans ce fauteuil, oublier mon immeuble, Paris, et jusqu'à la vie
entière au gré des paragraphes ; des dialogues, des aventures, des mondes
insolites, c'est ce que je devrais faire maintenant, continuer le récit de
Rafaël Kahla, retrouver Intissar la Palestinienne et Marwan mort à un carrefour
de Beyrouth, voyage dans le voyage, pour écarter la fatigue, les pensées, le
train bringuebalant et les souvenirs – (p. 155)
comme des rails dans la nuit des traits des réseaux infinis de relais et
nous, le plus souvent silencieux, étrangers qui ne nous ouvrons pas plus l'un à
l'autre que nous ne le faisons à nous-mêmes, obscurs, obtus, perdus dans les
innombrables rails qui entourent la gare de Bologne nœud ferroviaire
inextricable, des aiguillages, des circuits, des voies de garage à n'en plus
finir, une gare divisée en deux parties égales où au contraire de Milan le
gigantisme du bâtiment est remplacé par la profusion des voies, la verticalité
des colonnes par le nombre des traverses, une gare qui n'a besoin d'aucune
démesure architecturale parce qu'elle est en soi démesurée, le dernier grand
carrefour de l'Europe avant le cul-de-sac italien, tout transite par ici, les
bouteilles de nero d'Avola venues des pentes de l'Etna que buvait Lowry à
Taormine, le marbre des carrières de Carrare, les Fiat et les Lancia y croisent
les légumes séchés, le sable, le ciment, l'huile, les peperoncini des Pouilles,
les touristes, les travailleurs, les émigrants, les Albanais débarqués à Bari y
foncent vers Milan, Turin ou Paris : tous sont passés par Bologne, ils ont
vu leur train glisser d'une voie à l'autre au gré des aiguillages, (p. 241)
tout est plus difficile à l'âge d'homme la sensation d'être un pauvre type
l'approche de la vieillesse l'accumulation des fautes le corps nous lâche
traces blanches sur les tempes veines plus marquées sexe qui rétrécit oreilles
qui s'allongent la maladie guette, la pelade les champignons de Lebihan ou le
cancer de mon père terrassé par Apollon sans que le couteau de Machaon y puisse
rien, la flèche était trop bien plantée, trop profonde, malgré plusieurs
opérations le mal revenait, s'étendait, mon père a commencé à fondre, à fondre
puis à sécher, il paraissait de plus en plus grand, étiré, son visage immense
et pâli se creusait de cavités osseuses, ses bras se décharnaient, l'homme si
sobre était presque complètement silencieux, ma mère parlait pour lui, elle
disait ton père ceci, ton père cela, en sa présence, c'était
sa pythie, elle interprétait ses signes, ton père est content de te
voir, disait-elle lors de mes visites, tu lui manques, et le
corps paternel dans son fauteuil se taisait, lorsque je m'approchais de lui
pour lui demander comment il allait ma mère répondait aujourd'hui il va
très bien, et petit à petit tout le monde perdait l'habitude de s'adresser
directement à lui, nous consultions son oracle, mon père restait de longues
heures assis à lire saint Augustin ou les Evangiles (p. 415)
Mathias Énard, Zone (Actes Sud, 2008)