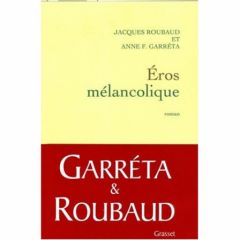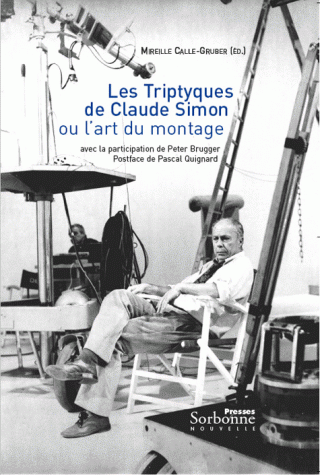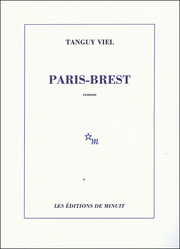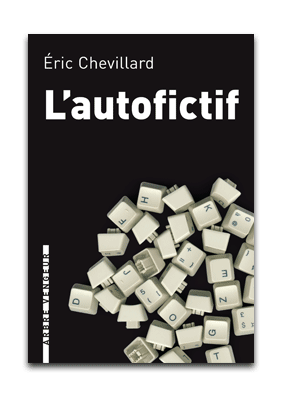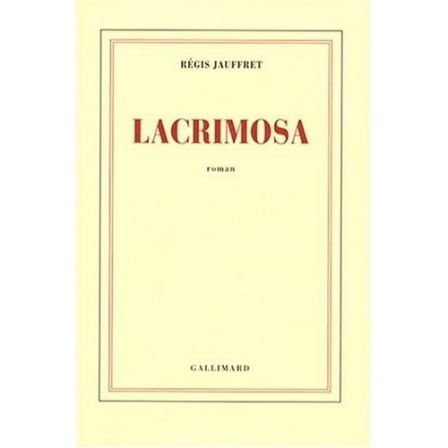Il y a du vent, beaucoup de vent. Le ciel s'est un peu épaissi. Je
m'approche, aucune fleur. Mais des plantes, des bambous, des pots cubiques en
verre. Du terreau, des petits galets. La stèle est combinée à une borne de
téléchargement. Toute l'œuvre de Clotilde, soit quarante-sept romans, treize
pièces de théâtre, deux cent vingt-deux textes et trente-neuf ans de blog, y est disponible en
format numérique. Il suffit d'en approcher sa liseuse pour en faire
l'acquisition.
C'est une amie de Clotilde qui a supervisé les images et les mots qui
dévisagent sa vie pour mieux la récrire au futur antérieur. Clotilde ne voulait
pas se plier au rituel. Depuis quelques années les morts avaient tous leur
montage, diaporama, voire court métrage, elle trouvait cela de mauvais goût. On
voyait le corps s'abîmer, gonfler et s'affaisser, ou parfois, au contraire, le
déni restait souverain, les images s'appliquaient à n'être que jeunesse,
sourires, vivacité.
La surenchère déjà illuminait les tombes, les survivants des uns
concurrençant les autres ; honneur, bonheur, fierté. De chaque famille, de
chaque vie achevée : une vraie publicité. Elle aurait préféré, Clotilde,
qu'il y ait de la musique, sa musique intérieure. Celle qui se jouait au-dedans
aux tout derniers instants, parce qu'elle la trouvait belle. Et juste, aussi,
si juste. Tellement qu'elle aurait pu en pleurer. Elle aurait bien aimé,
Clotilde, que cette musique-là se
glisse par Bluetooth dans les oreillettes de quiconque venu se recueillir.
Puisque la plénitude ne pouvait être partagée, elle aurait voulu, justement,
pouvoir en offrir quelques notes, ruisselantes, pâles et aiguës. Des mp3
étaient bien disponibles, mais il ne s'agissait que de ses pièces sonores.
Il y a du vent, beaucoup de vent. Qui empoisse mes cheveux et affole mon
carnet. Je regarde Théophile, lui signifie : c'est trop. Le soleil se
raidit, les bourrasques s'éteignent. Théophile me sourit et me dit : à
présent, s'il vous plaît, regardez. Alors je fixe l'écran, mais ne saisis pas
tout.
Ce ne sont pas tant les traits, la silhouette de Clotilde qui se modifient
au fil des ans, à travers ces quatorze minutes. C'est plutôt le décor des
prises qui évolue. Je vois des librairies et des brasseries connues, des
maisons d'édition identifiables, aussi. Et puis au second tiers, maintenant, je
ne sais plus trop. Les lieux, méconnaissables.
Beaucoup de choses se passent devant des ordinateurs. Design épuré,
dématérialisation confondante. Clotilde est une femme mûre, lecture sur sa
liseuse dans une pièce blanche, peut-être une galerie d'art où tout serait
décroché. Il y a des bornes et des écrans, le public fait la queue devant des
exemplaires fraîchement imprimés par une machine à livres.
Je regarde Théophile, mes pupilles lui renvoient mon interrogation. Il
s'éclaircit la gorge et se meut en voix off. Il dit : les rayons des
hypers ont terrassé les librairies. Il ajoute : pour pallier au
surendettement, nombreuses sont celles qui ont limité leur fonds aux classiques
et aux seuls contemporains bancables. Un livre de littérature contemporaine
reste en rayon trois mois. Les stocks explosent, des millions de livres sont
passés au pilon. Les grands groupes réduisent le budget de leur secteur
recherche et multiplient les coups commerciaux. Les maisons indépendantes sont
parallèlement accusées de surproduction. Faillites et dépôts de bilan. Sur
internet, les wannabe s'impatientent, dénonçant la consanguinité de la
République Bananière des Lettres. Les auteurs surexploités en sont rendus à
avoir recours à des agents. C'est dans ce marasme que les premières maisons
d'édition numérique voient le jour. Les textes circulent au creux des écrans.
Les grands groupes numérisent à leur tour leur catalogue. Peu à peu les livres
ne sont plus qu'imprimés à la demande via des structures adaptées. La mise en
place n'existe plus, l'éditeur se focalise sur son rapport au texte ; le
libraire redevient le conseiller privilégié du lecteur, sans s'encombrer de
gestion de stocks. La mutation du secteur, loin de nuire à la littérature, lui
permet d'échapper à la métonymie qui lui a collé à la peau au cours du XXe
siècle. Le mot livre n'est plus littérature, la machine folle liée à la
production d'objets s'effondre. Plutôt que d'être lus par cent vingt-deux
personnes, les auteurs de littérature non commerciale et les écrivains
expérimentaux se font massivement publier sur support numérique. À l'instar des
iPod, dont les playlistes comportent au moins 10 % de bizarreries, les
bibliothèques nomades hébergent un quota d'étrangetés. De là à avancer que
chaque texte a sa chance, indépendamment de son label, je ne sais pas, s'arrête
soudainement Théophile. Le lecteur est un consommateur qui fait confiance à des
marques (les maisons d'édition), des prescripteurs (les libraires) et des
leaders d'opinion (les blogs littéraires et leur communauté, certains critiques
littéraires). Là, vous voyez Clotilde Mélisse en train de déclarer : le
livre est mort, vive la littérature. Elle a fait suivre cette phrase d'un point
d'exclamation.
Théophile fait une pause, allume une cigarette. La bibliophilie
contemporaine se développera parallèlement, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont
le goût du papier y gagneront, soyez-en sûre. Il y aura des livres-objets, des
formes plus inventives, qui se trouveront en librairie. C'est un renouveau, pas
une chute. Il m'agite son index vers un gros plan de Clotilde. Me
sous-titre : voyez-vous, elle sera la première à avoir tout quitté, un
exil très concret, un territoire en friche, l'abandon du Château et de ses
dépendances. Ses textes sont accessibles partout. À un clic du client, à
égalité avec les auteurs formatés, ceux sur qui les maisons investissent. Dans
n'importe quelle librairie, elle est téléchargeable. Clotilde a fini libre,
totalement autonome. Théophile s'enthousiasme : c'est un sujet de
roman.
Je ne comprends pas très bien le CQFD de l'histoire. D'autant que Clotilde
Mélisse, à la base, c'est moi qui l'ai inventée. Dans d'autres livres, le
lecteur la croise, écrivaine militante, un creuset à fantasmes, un transfert
très grossier. La voilà qui m'échappe, et à pleins paragraphes. Je ne l'avais
en rien destinée à cela, je l'avais laissée en suspens, quelque part, à sa
trentaine, entre la vie et l'éboulement. Je ne saisis pas le sens de ce tour de
passe-passe, au fond de moi, je crois, en fait, j'ai un peu peur.
Chloé Delaume, Dans
ma maison sous terre (Seuil, Fiction & Cie, 2009, p. 25-29)