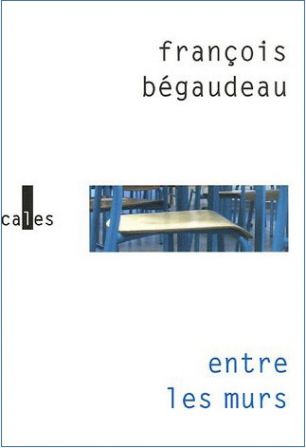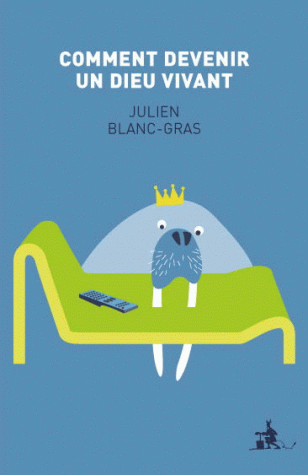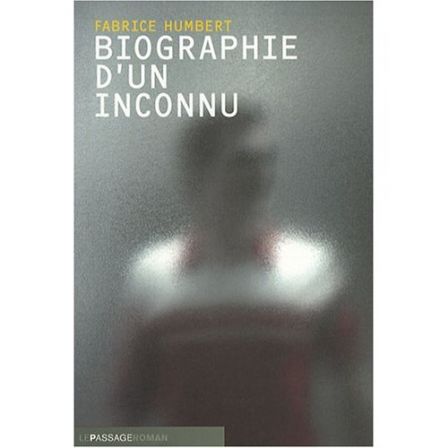Pour faire avancer un âne, il n'est pas de moyen plus éprouvé que l'usage
proverbial de la carotte et du bâton. C'est du moins ce que conte la légende.
Avant moi-même connu un certain nombre de meneurs d'ânes, je n'en ai jamais vu
aucun avoir recours à ce procédé. Mais qu'importe le caractère avéré de la
chose, il s'agit là d'une métaphore qui, comme beaucoup d'expressions imagées
forgées par le génie populaire, recèle et condense des phénomènes bien plus
complexes qu'il n'y paraît au prime abord. Notons tout d'abord qu'il est bien
question de la carotte et du bâton, et non pas de l'une ou de l'autre. Il ne
s'agit pas d'une alternative, mais d'un rapport dialectique entre les deux
termes. Pas de carotte sans bâton et vice versa. Le bâton seul, la contrainte
physique, ne suffit pas à provoquer une avancée continue et décidée de
l'animal. L'âne battu s'ébroue, il fait bien quelques mètres à contrecœur, mais
cesse de marcher à la première occasion. Pour parler la langue des
managers : l'effet des coups de bâton n'est pas performant. En
fait, leur véritable effectivité est indirecte, comme menace permanente
susceptible d'être mise à exécution au moindre relâchement de l'effort. Il
suffit que l'âne sache qu'il peut éventuellement être bastonné, soit qu'il en
ait lui-même le souvenir cuisant, soit qu'il en ait l'exemple autour de lui. Il
se mettra alors en mouvement, non pas pour parvenir à un but, mais dans un
souci tactique d'évitement de la douleur. Les spécialistes parlent à ce propos
d'une « motivation secondaire négative ». Dans l'hypothèse optimale, il ne
sera jamais même nécessaire de battre l'animal, celui-ci avant parfaitement
intériorisé la menace. Son « bâton intérieur », il l'éprouvera même comme
un progrès de la condition asine, il se dira : « Nous n'avons pas à
nous plaindre, autrefois nos semblables étaient cruellement battus,
aujourd'hui, la vie est plus douce pour nous ». Le philosophe Norbert Elias
nommait cette disposition mentale le processus de civilisation des
mœurs. Et cependant, tout pédagogue le sait bien, la crainte du châtiment
doit être couplée à l'espoir d'une récompense. La contrainte sans la séduction,
ça ne fonctionne pas longtemps. On n'agit jamais vraiment dans le seul but
d'éviter quelque chose, mais pour obtenir une gratification.
C'est ici qu'intervient la carotte, que l'on agite, accrochée à une perche,
devant les naseaux de l'animal. Si les phénomènes psychologiques entrant en jeu
sur le versant « bâton » du dispositif sont relativement grossiers,
ceux qui interviennent du côté « carotte » sont beaucoup plus
complexes. Pour commencer, non seulement l'âne doit voir la carotte, mais il ne
doit voir qu'elle ; il faut donc faire en sorte que tout autre objet de
convoitise disparaisse de sa vue. C'est à cet effet que sont utilisés, depuis
des temps immémoriaux, ces judicieux accessoires que l'on nomme les
œillères. Il existe, selon le degré de développement de la bourrique,
différentes sortes d'œillères. Ce peut être par exemple un éclairage spécial,
laissant dans l'ombre tout ce qui pourrait la distraire du but assigné. Ou bien
une idéologie assimilant au mal absolu, ou encore à une utopie irréaliste, tout
ce qui n'est pas la carotte. Cependant pour efficace qu'elle soit, cette
méthode est encore coercitive. Il peut advenir que l'âne se rebiffe contre la
restriction autoritaire de son champ visuel. Et rappelons-nous que l'usage de
la carotte a précisément pour but de promouvoir une démarche libre et
volontaire. Il est aisé de comprendre que le meilleur moyen de focaliser la
volonté sur un objet singulier est encore de faire le vide alentour, que rien
ne subsiste dans l'environnement de l'animal qui puisse distraire sa
convoitise. Dans le désert, nul besoin d'œillères. Il faut donc faire le
désert.
Une fois l'attention du baudet captée, tout reste à faire. Car nous sommes
encore en présence de deux volontés distinctes. L'âne veut manger la carotte,
l'ânier veut faire avancer l'âne. Comment faire coïncider les deux ?
L'animal doit substituer à son motif intrinsèque (la faim, la convoitise) le
motif extrinsèque qui lui est représenté (la carotte et le mouvement pour
l'atteindre). Cette phase se nomme l'identification. Ensuite, une fois
accroché de la sorte, il doit modifier son comportement et faire l'effort
approprié à la satisfaction de son attente. La chose aura d'autant plus de
chances de réussir que le sujet sera convaincu d'agir volontairement et libre
de toute influence extérieure. C'est la phase dite de l'adaptation.
Celle-ci est facilitée chez des mammifères d'un naturel plus grégaire que les
ânes, mettons des collègues. Car ici entre en jeu un phénomène décisif. Chaque
collègue particulier pense qu'il doit faire un pas. Pourquoi ? Parce qu'il
est persuadé que tous les autres collègues feront ce pas. C'est ce que l'on
nomme l'émulation, ou la libre concurrence. Chacun croit qu'il ne peut
faire autrement que de croire, pour la seule raison que tous les autres
croient, « tous les autres » étant la somme de ces chacuns qui
croient, etc. C'est ainsi qu'une croyance s'objective en une « réalité
incontournable. »
La phase suivante du processus pourrait se nommer : l'échec bien
sublimé. Car bien évidemment, il n'est pas question que le but puisse être
atteint, sinon l'âne s'arrêterait sur-le-champ pour jouir du fruit de son
effort et toute l'entreprise aurait été vaine. Mais il faut aussi empêcher que
l'animal abandonne tout espoir de parvenir à ses fins, ce qui compromettrait
tout autant sa marche en avant. La satisfaction doit apparaître comme toujours
différée, mais jamais compromise. L'effort infructueux doit être compensé,
c'est-à-dire remis en jeu dans un effort accru. Ce moment est le plus délicat.
C'est ici qu'interviennent des consultants en pensée positive qui abreuvent les
ânes de maximes comme celle-ci, attribuée à Churchill : « La
réussite, c'est la capacité de voler d'un échec à l'autre sans perdre son
enthousiasme. »
Une fois ce stade atteint, le plus dur est passé. Car on va pouvoir
désormais compter sur un autre facteur éprouvé qui se nomme la routine.
L'animal va continuer sur sa lancée, par vitesse acquise, pour ainsi dire, sans
plus se poser la question du pourquoi. Plus exactement, cette question va
s'inverser pour lui. Il se demandera : quelle raison aurais-je donc de
m'arrêter ? Ce qui importe maintenant, ce n'est plus la pertinence du
motif qui l'avait mis en branle, mais l'absence de motifs alternatifs
suffisamment puissants pour lui faire remettre en cause la démarche adoptée.
Aussi, tant que ne se présentera pas une raison impérieuse de modifier son
comportement, il poursuivra son effort.
Avouons-le, le fait que les ânes se fassent systématiquement berner par des
procédés aussi élémentaires ne plaide pas vraiment en faveur de leur
discernement. Il faut tout de même rappeler, à leur décharge, que jamais l'on
ne vit de syndicat de bourriques manifester en revendiquant « plus de
carottes et moins de bâton ! » Et, c'est un fait avéré, il est advenu
qu'au bout du chemin, les baudets les plus méritants aient réellement pu mordre
la carotte juteuse. C'était naguère. Car le contexte global ne permet plus ce
genre de largesse. Soumis à une âpre concurrence, les propriétaires des ânes ne
sont plus disposés a gaspiller de coûteuses carottes à l'exercice. Afin de
baisser les coûts du travail, ils substituent à celles-ci des images coloriées,
ou alors ils engagent des communicateurs chargés de persuader leurs employés
que la perche à laquelle rien n'est accroché est en elle-même un mets
succulent. Ou bien que le bâton se transformera en carotte le jour où il aura
été suffisamment asséné sur leurs dos. On admire leurs efforts.
Ce que je viens d'esquisser à grands traits n'est autre que la théorie de la
motivation telle qu'elle est distillée dans d'austères traités de psychologie
et mise en pratique dans de coûteux séminaires. Qu'est-ce qu'un motif ?
C'est, au sens premier, ce qui nous pousse au mouvement ; par
extension : une raison d'agir. La motivation est donc la fabrication et la
propagation de motifs destinés à faire bouger les gens dans la direction jugée
utile, ou pour parler la langue de ce temps : à les rendre toujours plus
flexibles et mobiles.
Dans tous les secteurs de la société actuelle, la bataille pour la
motivation fait rage. Les chômeurs n'obtiennent un droit à l'existence qu'en
fournissant les preuves d'un engagement sans relâche dans la recherche
d'emplois inexistants. Lors de l'entretien d'embauche, ce ne sont pas tant les
compétences qui comptent que l'exhibition enthousiaste d'une soumission sans
faille. Ceux qui ont encore une place ne peuvent espérer la conserver qu'en
s'identifiant corps et âme à l'entreprise, en se laissant mener où celle-ci
l'exige, en épousant sa « cause » pour le meilleur - et, le plus
souvent, pour le pire. Et le devoir de motivation ne s'arrête pas à la sortie
des bureaux. Il s'impose tout autant au consommateur, sommé d'être attentif aux
nouvelles gammes de produits et de confirmer sa fidélité aux marques qui ont su
l'accrocher. À l'adolescent qui doit se former - peut-être devrait-on dire se
formater - selon les exigences du marché, aussi bien qu'au vieux qui
doit s'acquitter de sa dette envers un monde qui a eu la bonté de le maintenir
en vie. Et quel que soit son âge, au téléspectateur, qui doit faire don de
quantités toujours plus importantes de cerveau disponible pour recevoir le flux
ininterrompu des informations censées constituer son rapport à la réalité. Une
fois la télé éteinte, restent encore tous ces artistes qui veulent le faire
bouger, ces militants qui veulent le mobiliser, le temps et les
relations qu'il lui faut gérer, sa propre image qu'il est sommé de
dynamiser, bref pas un moment qui ne soit placé sous le signe de
l'utile, sous l'impératif catégorique du mouvement. Que de carottes, pour de si
malheureux ânes !
La motivation est une question centrale de l'époque et elle est appelée à le
devenir toujours plus. C'est d'abord que la marchandisation intégrale l'exige.
Aujourd'hui il n'est pas un désir, pas une aspiration, pas une pulsion même qui
ne soit un objet de commerce. Les produits phares qui dominent le marché, ce ne
sont pas de quelconques objets censés répondre à tel ou tel usage, mais des
tranches de mode de vie préfabriquées. Encore faut-il que le client s'identifie
à elles, qu'il fasse siens les motifs dont on lui fait la retape. Chacun porte
en lui une part de ce que l'on nommait jadis les « passions de l'âme », et
aussi l'héritage des traditions antérieures (du moins ce qu'il en reste). Tout
ce stock doit être mobilisé. remodelé, empaqueté, étiqueté, rendu échangeable
contre un produit de valeur équivalente. Tant en amont, dans ce qu'on nomme
encore le travail, qu'en aval, dans ce qu'il est convenu d'appeler la
consommation (mais les deux moments peuvent de moins en moins être distingués),
il s'agit de faire en sorte que l'esprit des gens soit entièrement
occupé par cette tâche infinie.
La deuxième raison pour laquelle la motivation est plus que jamais cruciale,
c'est que les motifs intrinsèques aux individus, auxquels les institutions
sociales prétendaient répondre naguère (citons entre autres le besoin de
stabilité, la soif de reconnaissance, le plaisir de la réciprocité, l'espoir de
vivre mieux) ont été systématiquement anéantis par la colonisation marchande.
Les idéaux et les promesses qui, bon an, mal an, avaient fait passer bien des
compromis et des renoncements, sont désormais combattus comme autant
d'archaïsmes dont il convient de se défaire au plus vite. S'il faut sans cesse
motiver les gens, c'est qu'ils sont toujours plus démotivés. Dans la sphère de
l'emploi, tous les indicateurs (au sens statistique, comme au sens policier)
témoignent d'une baisse de « l'investissement » des salariés dans
leur emploi. Ceci non seulement chez les travailleurs précaires et mal payés,
mais aussi bien chez les cadres et les hauts fonctionnaires. Dans la sphère de
la consommation, la grande distribution s'inquiète maintenant de la
désaffection croissante des clients, laquelle serait due d'avantage à un effet
de saturation, à une baisse du désir d'achat plutôt qu'à la fameuse
« baisse du pouvoir d'achat. » Dans la sphère médiatique,
l'uniformisation des informations (tant dans la forme que dans le message)
semble provoquer une perte de crédibilité tout aussi globale. (…)
En somme, plus la motivation des gens est nécessaire aux marchés, plus elle
fait défaut.