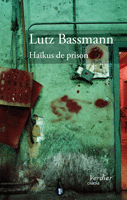Je reste toujours ébahi quand j'achève quelque chose. Ébahi et navré. Mon
instinct de perfection devrait m'interdire d'achever ; il devrait même
m'interdire de commencer. Mais voilà : je pèche par distraction, et
j'agis. Et ce que j'obtiens est le résultat, en moi, non pas d'un acte de ma
volonté, mais bien d'une défaillance de sa part. Je commence parce que je n'ai
pas la force de penser ; je termine parce que je n'ai pas le courage de
m'interrompre. Ce livre est celui de ma lâcheté.
La raison qui fait que j'interromps si souvent une pensée par un morceau de
paysage, qui vient s'intégrer de quelque façon dans le schéma, réel ou supposé,
de mes impressions, c'est que ce paysage est une porte par où je m'échappe et
fuis la conscience de mon impuissance créatrice. J'éprouve le besoin soudain,
au milieu de ces entretiens avec moi-même qui forment la trame de ce livre, de
parler avec quelqu'un d'autre, et je m'adresse à la lumière flottant, comme en
ce moment, sur les toits de la ville, mouillés sous cette clarté oblique ;
à la douce agitation des arbres qui, haut perchés sur les pentes citadines,
semblent tout proches cependant, et menacés de quelque muet écroulement ;
aux affiches superposées que font les maisons escarpées, avec pour lettres les
fenêtres où le soleil déjà mort pose une colle humide et dorée.
Pourquoi donc écrire, si je n'écris pas mieux ? Mais que deviendrais-je si
je n'écrivais pas le peu que je réussis à écrire, même si, ce faisant, je
demeure très inférieur à moi-même ? Je suis un plébéien de l'idéal,
puisque je tente de réaliser ; je n'ose pas le silence, tel un homme qui
aurait peur d'une pièce obscure. Je suis comme ceux qui apprécient davantage la
médaille que l'effort, et qui se parent des plumes du paon.
Pour moi, écrire c'est m'abaisser ; mais je ne puis m'en empêcher. Écrire,
c'est comme la drogue qui me répugne et que je prends quand même, le vice que
je méprise et dans lequel je vis. Il est des poisons nécessaires, et il en est
de fort subtils, composés des ingrédients de l'âme, herbes cueillies dans les
ruines cachées de nos rêves, coquelicots noirs trouvés sur les tombeaux de nos
projets, longues feuilles d'arbres obscènes, agitant leurs branches sur les
rives sonores des eaux infernales de l'âme.
Écrire, oui, c'est me perdre, mais tout le monde se perd, car vivre c'est se
perdre. Et pourtant je me perds sans joie, non pas comme le fleuve qui se perd
à son embouchure - son seul but, depuis sa source anonyme -, mais comme la
flaque laissée dans le sable par la marée haute, et dont l'eau lentement
absorbée ne retournera jamais à la mer.
Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité, 152 (trad. Françoise
Laye, Christian Bourgois, 1999, p. 174-175)