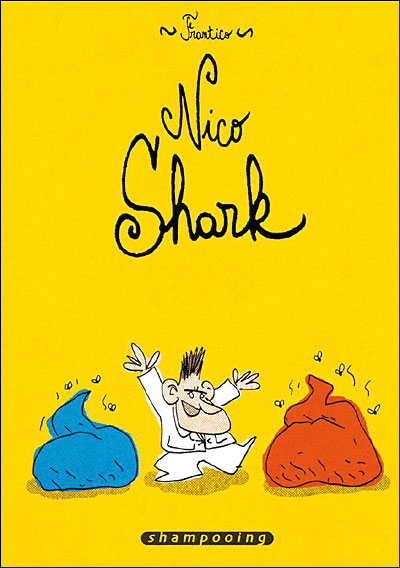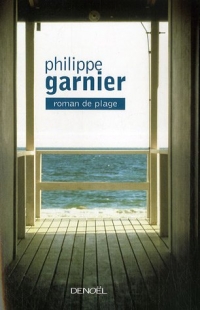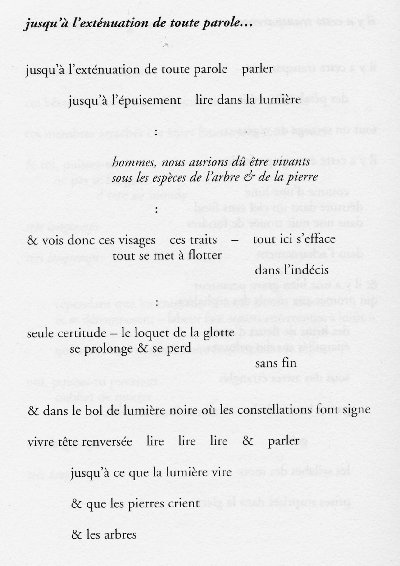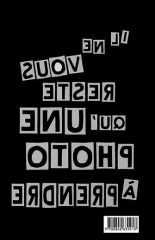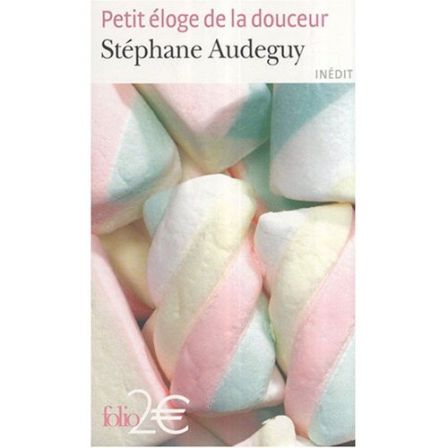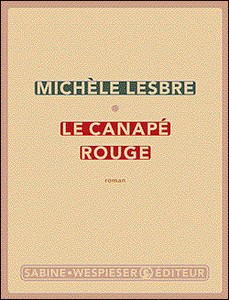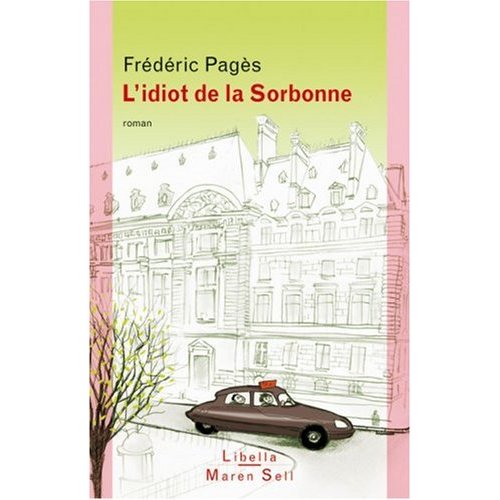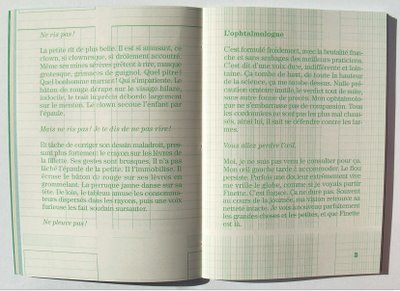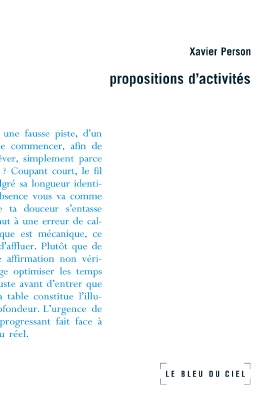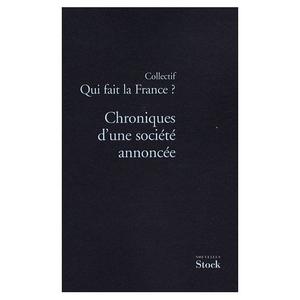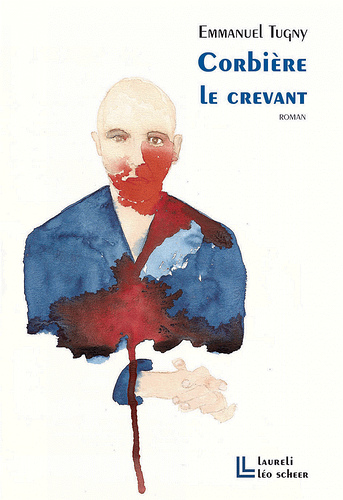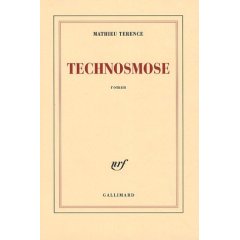Il est interdit de fumer - mais la famille de maman a bâti sa fortune sur le
tabac. Des plantations de tabac à l'infini, jusqu'en Virginie, jusque dans le
Maryland. Je suis la fille du juge, la petite-fille d'un sénateur et d'un
gouverneur : je fume et je bois et je danse et je trafique avec qui je
veux. Les jeunes pilotes de la base se seraient battus pour un signe de moi et
lorsque enfin je leur accordais une danse je voyais leurs joues dorées
s'étoiler de fossettes. Il y en avait deux qui rivalisaient de témérité pour
m'avoir, ils détournaient leur avion tandem des couloirs aériens militaires et
mettaient le cap sur Pleasant Avenue. Arrivés au-dessus de notre jardin, ils
faisaient des figures dans le ciel, des loopings, des piqués, des tonneaux - et
tout ça était si drôle, si terriblement excitant, si chevaleresque ; même
Minnie était fière de l'hommage rendu à sa poupée blonde. Un jour de malchance
ou de fatigue, le biplane est parti en vrille, et tous les jardins alentour ont
retenu leur souffle jusqu'à ce que retentît plus loin, au-delà des faubourgs,
le bref vacarme du crash. Une longue torchère s'éleva au-dessus des toits. Deux
jeunes corps partaient en fumée dans une odeur noire de kérosène - deux jeunes
corps qui la nuit d'avant dansaient sur leurs jambes immenses et souriaient de
leurs joues étoilées, sentant si bon l'odeur des garçons bien, le cuir souple,
le savon brut et, sous la fraîche eau de Cologne, tandis que l'effort de la
danse noyait leur front de sueur et que l'odeur du corps reprenait le dessus,
ce si troublant parfum de sauvagine où je baignais, serrée entre leurs bras,
effrayée, ivre et heureuse.
Leur consomption dura deux minutes - un bûcher éclair, généreux, puissant et
rapide à l'image de ces deux garçons qu'il dévorait. Il paraît que j'ai eu une
crise alors, - la première -, et qu'on m'a donné de la morphine pour
m'apaiser.
Depuis l'accident, une bonne partie de la ville professe que je suis le diable
à tête blonde. Noir et or, oui.
Je suis une salamandre : je traverse les flammes sans jamais me brûler.
C'est de là que me vient mon nom, parce que Minnie avait terriblement aimé une
Zelda de papier, héroïne d'un roman oublié qui s'intitulait La
Salamandre - et cette Zelda était une fière danseuse gypsie. (p.
32-33)
L’explication de la vie n'explique rien.
Plus je me livre au jeune docteur du Highland Hospital, plus je mesure l'échec
de l'intelligence à saisir son essence. J'en ai tant vu de ces docteurs.
(« Au moins cent! » affirme Scott et j'entends qu'il fait l'addition
des honoraires.)
Celui-ci est jeune, et doux, son regard bleu marine me regarde sans me
disséquer ni me soupçonner.
Treize mois dans ma vie - cela semble peu mais c'est bien trop déjà -, j’ai
dû me cacher pour écrire. J'avais trente et un ans. J'acceptais pourtant
l'empire et l'emprise sur moi d'un époux jaloux, névrosé et perdu. Jusqu'au
jour où c'est devenu invivable.
Et pour une fois, depuis dix ans, depuis vingt cliniques au moins sur les deux
continents, cette fois enfin le jeune docteur m'a dit : « Je vous
crois. » (p. 95)
Car le monde nous abîme maintenant. ils disent que Scott vieillit trop vite,
qu'il grossit, que l'alcool le défigure. Mais que croient-ils, les
imbéciles ? Ses livres lui passent par le corps, ses romans trop rares et
ses textes mercenaires tellement, tellement nombreux. Accessoirement, ses
livres sont passés par mon corps aussi. Les gens, écrire, pour eux, c'est comme
une longue conversation que l'on aurait avec soi-même, comme une confession
devant le prêtre de la famille (je me rappelle le presbytère de Saint-Patrick,
tout le laïus catho de ce curé irlandais qui sentait la friture et j'avais mal
au cœur à cause des tubéreuses en vase sur le petit autel, les tubéreuses et
l'huile rance, leur parfum capiteux mêlé au graillon, la tête me tournait,
mauvais ménage, me disais-je, dangereux mariage, j'ai cru défaillir, tomber sur
le pavé noir et blanc), et pour d'autres encore, écrire c'est comme se coucher
devant un monsieur ou une demoiselle Freud.
Mais non : écrire c'est passer tout de suite aux choses sérieuses, l'enfer
direct, le gril continu, avec parfois des joies sous les décharges de mille
volts. (p. 96)
Je sais ce qu'on dit de moi. Ce que vous ont dit Scott, ma mère, mes
soeurs.
Ils mentent, ou disons : ils se trompent. Scott et moi nous avions besoin
l'un de l'autre, et chacun a utilisé l'autre pour parvenir à ses fins. Sans
lui, je me serais retrouvée mariée au garçon gris, le substitut du procureur
d'Alabama, autant dire que j'aurais été me jeter dans le fleuve avec du plomb
plein les poches. Sans moi, il n'aurait jamais connu le succès. Peut-être même
pas publié. Ne croyez pas que je le déteste. Je fais semblant de le haïr. Je
l'admire. J'ai lu ses manuscrits, je les ai corrigés. Gatsby le
Magnifique, c'est moi qui ai trouvé le titre, tandis que Scott s'enlisait
dans les hypothèses saugrenues. J'estime mon mari, professeur. Mais cette
entreprise à deux, ce n'est pas l'amour. (p. 115)
Gilles
Leroy, Alabama song (Mercure de France, 2007)