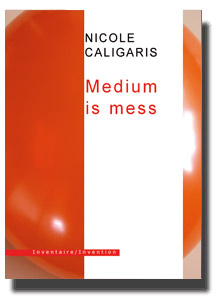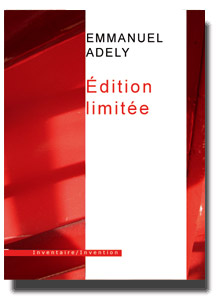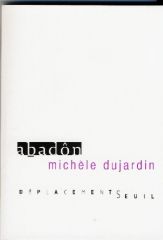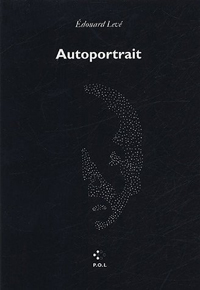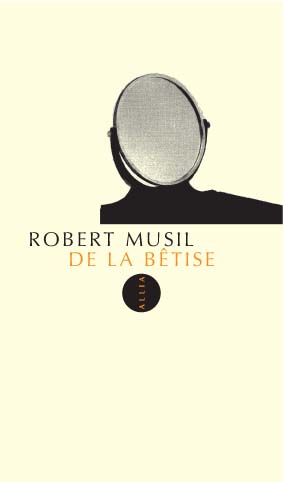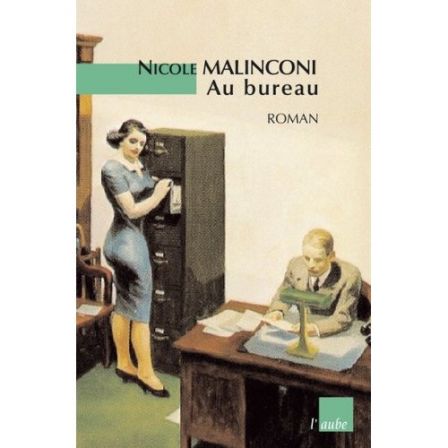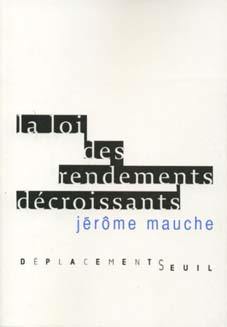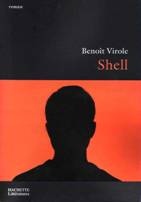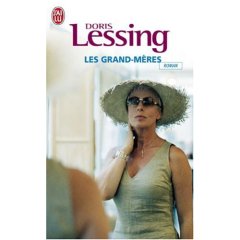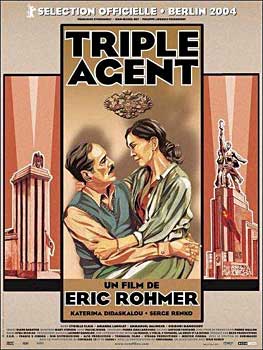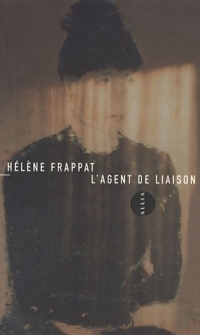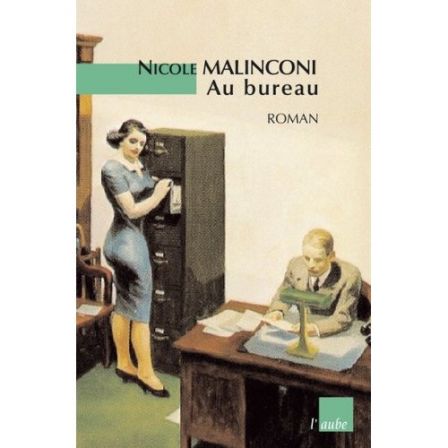
Grande famille, écrit Jean, ils ont beau dire grande famille, on ne se connaît
même pas entre nous ; même pas tous ceux du bloc B. Ils peuvent bien nous
rassembler une fois par an pour les vœux du président, ce jour-là on reste
groupés par service ; au-delà des services on ne fait que
s'observer.
Jean est au bloc B depuis des années ; il dit que les années il ne les
compte plus. Enfin, maintenant, si, depuis qu'ils ont annoncé la nouvelle à
l'assemblée extraordinaire du personnel, disant que des temps difficiles
s'annonçaient pour la grande famille, et qu'ils ont parlé de départs
volontaires. Ils ont dit départs volontaires pour les plus anciens. Alors, Jean
s'est mis à compter ses années au bloc B depuis le début et il a compris qu'il
était arrivé parmi les plus anciens, que subitement il pouvait en rester à ces
années-là, ne pas finir les cinq on six qui lui restent, comme c'était prévu
jusqu'ici, quand l'âge décidait pour vous et que à ce moment-là ça allait de
soi de finir. Tout d'un coup, on pouvait cesser de s'en remettre à l'âge ou, en
quelque sorte, au sort ; on vous laissait choisir votre fin, une qui ne va
pas de soi.
Jean en était resté cloué à sa place, comme si le temps des cinq ou six années
s'était effacé et que lui aussi, volontairement, s'effaçait déjà de la salle
des conférences où ils étaient tous rassemblés, et même des bureaux, des
ascenseurs, de la cafétéria, des couloirs du bloc B.
À eux, quel effet cela leur fait d'annoncer ce qu'ils annoncent, s'était
demandé Joël à la fin de l'assemblée, pendant qu'eux, déjà, remerciaient les
membres de la grande famille, se mettaient debout tous ensemble, dans le bruit
de leurs chaises reculées sur l'estrade, et quittaient l'espèce de longue
tribune où ils s'étaient attablés avec chacun son micro et son nom inscrit sur
un carton posé devant, bien lisible, comme si tout le monde ne les connaissait
pas, depuis le temps.
Maintenant, Jean est bien obligé de se faire à l'idée que désormais il fait
partie des têtes qui vont tomber un jour ou l'autre, comme ils se le disent
tout le temps entre eux. Mais une chose est de sortir ça comme ça, Des têtes
vont tomber, en faisant tourner sa cuiller dans son café pour dire de dire, une
autre est de se voir dans le lot, c'est-à-dire de voir les, disons, cinq ou six
années réduites peut-être à une seule, peut-être à moins encore, et soi-même,
du coup, dans l'obligation d'être prêt sur-le-champ ou quasi à ne plus venir
dans les bureaux, ni les couloirs, ni les ascenseurs, ni la cafétéria, ni nulle
part, à ne plus faire ce qu'on a fait des années durant parce qu'il fallait
bien, on disait, mais qu'on a pourtant fait, malgré que pendant toutes ces
années-là on volait du temps pour rêver à quand on ne devrait plus, pour déjà
essayer le rêve, imaginer sa vie d'après, et même quelquefois la
redouter.
La vie d'après, Jean ne peut plus se donner le temps de la rêver, maintenant,
ni de la laisser au hasard de l'âge, puisqu'elle est là, déjà presque tombée
dans le présent : et tout à coup il voit qu'il ne la connaît pas. Il se
dit qu'au fond on connaît juste ce qui arrive, que parfois ce qui arrive vous
surprend au point d'éclairer toute la vie d'avant, comme si elle non plus on ne
l'avait pas vraiment connue, qu'on était resté en dehors ; comme s'il
fallait se trouver parmi les têtes qui vont tomber pour se demander ce qu'on
est devenu, après tant d'années au bloc B.
Tant d'années sans les voir passer, s'était dit Jean, sans rien voir passer de
spécial, en fin de compte. Alors, pour tâcher de ne plus rien perdre de ce qui
arrive, Jean avait décidé de l'écrire ; il n'était peut-être pas trop
tard. Finalement, mieux vaut tard que jamais. Il avait acheté un cahier.
Nicole Malinconi, Au bureau (L’Aube, 2007, p. 10-13)
Nicole Malinconi est née le 20 mars 1946 et vit en Belgique.
En ligne : une critique de ce roman par Jeannine Paque (Le Carnet et les
Instants, 148)