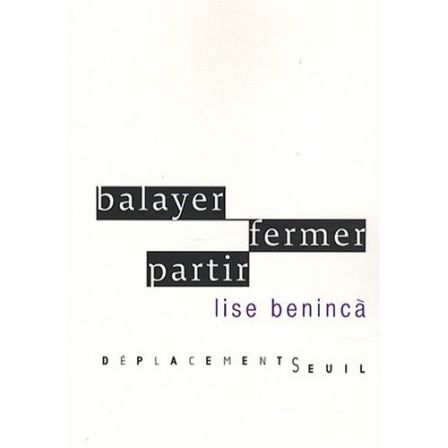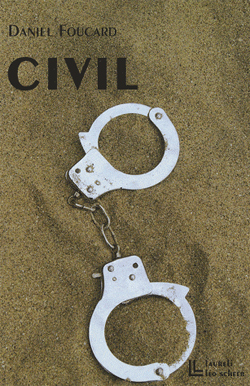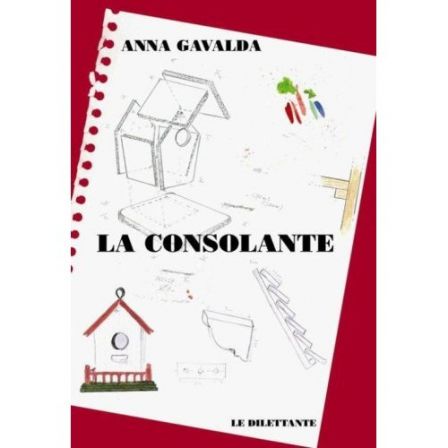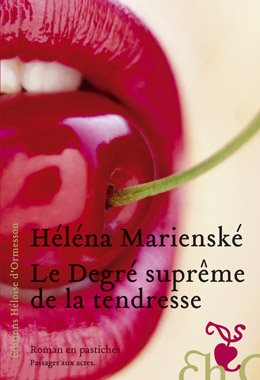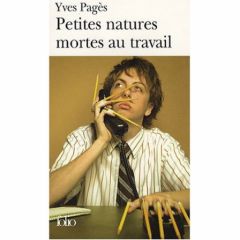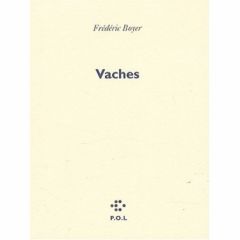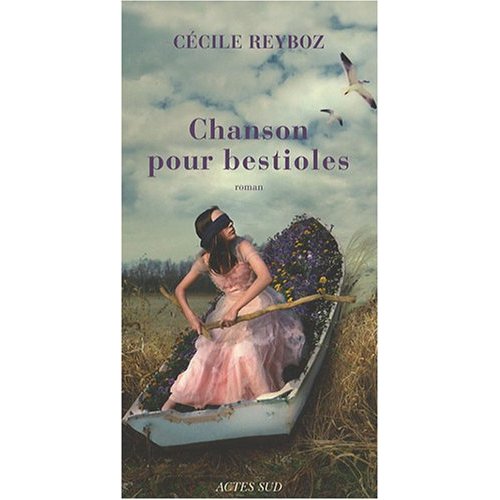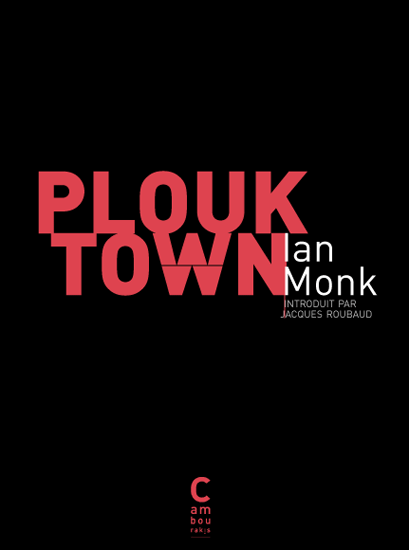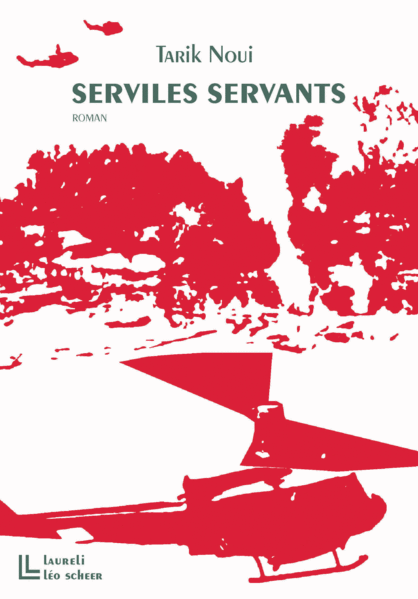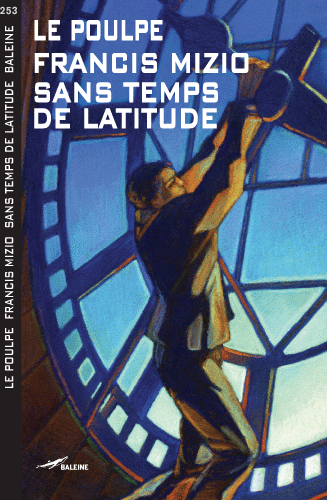Je prends un livre au hasard sur la pile à côté de mon corps et l'ouvre non sans peine. Les pages en sont si lisses que mes doigts croient caresser, une dernière fois, sa peau.
Au début, les lignes restent empilées les unes au-dessus des autres, puis des rigoles apparaissent, des fêlures blanches qui redonnent peu à peu un semblant de vie au rectangle noir. Enfin secs, mes yeux reconnaissent l'aberrante géographie de l'alphabet et il m'est donné de lire une phrase, une seule : « Nous étions à l'étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. »
C'est l'entrée en matière de Madame Bovary, le seul roman de Flaubert que j'ai lu et relu plus de dix fois, pour diverses raisons, à diverses époques. Toutes oubliées. Estée, me dis-je, Estée n'y sera pas. Je vais lire le livre d'une traite, train épris de rails, et quand le dernier tunnel me recrachera à l'air libre je serai guéri.Madame Bovary : je te connais par cœur. Tu seras ma salvatrice musique d'ascenseur, mon passeport « easy listening » pour le monde des vivants, ou des zombis, peu importe, je corserai l'eau bénite s'il le faut, mais je survivrai au passage. Lire est évident, comme le mouvement de bascule du tabouret quand la corde se tend. (p. 14-15)
Le château, de construction moderne, à l'italienne, of course et cetera ! Coup d'éclat ! et tant pis pour ses deux ailes et trois perrons, ce soir je casse la baraque. (Quand j'étais petit, l'expression « sauter les descriptions » m'insupportait déjà, me croyait-on voué à un parcours hippique, attentions aux haies, plus haut, plus haut, ici une barre, blanche et rouge comme un dégueulis dentifrice figé horizontalement à un mètre vingt du sol, allez, élan, élan, on saute ! Alors que justement les descriptions, qu'elles fussent de corridors ne menant qu'à la désorientation de soi ou d'étangs grouillant d'une faune abjecte, permettaient cette dissolution qu'interdisait la bruyante partie de flipper des dialogues. J'aimais la façon sournoise qu'avait la description de s'exfolier sur la page, cette gangrène qu'elle promenait comme si de rien n'était, comme si le corps soi-disant sain du récit pouvait se passer de digressions infectieuses. Le décor n'était pas planté comme un radis, mais pierre après pierre, et dans chaque pierre il était possible d'entendre roucouler des siècles et des siècles d'érosion, de stupeur. L'œil pouvait se perdre dans les plis d'une robe et n'en jamais resurgir ( ( la nuit ( ( ( souvent) ) ) venait tout enterrer ) ) ; les paysages se taillaient la part du lion, et le lecteur-lion que j'étais les bouffait tranquillement, os par os, détachant les nerfs et les tendons avec la même application d'un amant dénombrant les taches de rousseur sur le dos ou les cuisses d'Estée qui ne reviendra pas, maintenant les descriptions je les fais sauter – et cetera !) Ce soir c’est la masse critique. (p. 65-66)
comme les taupes que je voyais aux branches qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevé, enfin.
8
que je voyais aux branches qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevé, enfin.
9
qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevé, enfin.
10
grouillant dans le ventre, crevé, enfin.
11
crevé, enfin.
12
Enfin je sens, dans les plis de cette brève convulsion, battre le pouls de Celui qui l'a dégorgée à coups de giclée d'encre après avoir trempé sa plume dans son encrier en forme de crapaud.
Flaubert est là tout près, comme s'il se savait lu.
Profitant d'une soudaine capillarité, ou plutôt conductivité du papier, je me laisse aspirer, sliourp ! hors du tracé des mots pas encore secs et remonte tel un homme-obus le fût tendu de la plume. Parvenu à la jonction des doigts - ses doigts, bon sang ! les doigts de Flaubert ! -, je m'immisce sous les ongles ras, m'enivre de leur brutalité chantante, puis m'enfuis dans les veines minuscules que recèlent les boisseaux des nerfs - névrose, vous dis-je ! névrose… -, et en quelques instants j'ai atteint le coude qu'en pliant il - lui ! le grand homme ! - m'aide à contourner afin de mieux me propulser jusque dans le gras de l'avant-bras où après une ou deux hésitations musculaires je suis irrémédiablement hissé par la tension de l'épaule dont le brutal haussement me descelle et m'envoie forer, bien en deçà, sous l'éponge pulmonaire, jusqu'au cœur, gros comme celui d'un bœuf, tout persillé d'humeurs tonitruantes.
Les contractions de cette pompe affolée me cognent, c'est la raclée, j'essaie de me protéger mais en vain, je l'ai bien cherché, je l'ai mérité, et Faubert de moi ne fera, je le suppose, l'espère, qu'une - beurk - bouchée.
13
Au fin fond de Flaubert - ridiculus sum ! - il fait nuit. (p. 130-132)
Claro, Madman Bovary (Verticales, 2007)
Décidé à soigner une rupture par l’immersion dans la relecture de Flaubert, le narrateur plonge dans Madame Bovary comme Alice dans le miroir, ou « Madman Bovary » dans une mission de super-héros. L’hommage est parfait car ludique et irrespectueux, oscillant entre déclaration d’amour et saccage : le texte de Claro s’élabore à même les plis de quelques citations préférées, dans un rapport très physique à la langue de Flaubert ( « gustave goûté » est le titre d’un chapitre ) et rend compte de manière jubilatoire des variations dans le rythme de la lecture, de fulgurances en lassitudes, d'hystérie en admiration stylistique.
(Christophe) Claro est né en 1962.
Il a publié :
- Ezzelina (Arléa, 1986)
- Insula Batavorum (Arléa, 1989)
- Le Massacre de Pantin (Fleuve noir, 1994)
- Éloge de la vache folle (Fleure noir, 1996)
- Livre XIX (Verticales, 1997)
- Enfilades (Verticales, 1998)
- Tout son sang brûlant (La Pionnière, 2000)
- Chair électrique (Verticales, 2003)
- Bunker anatomie (Verticales, Minimales, 2004)
- Black Box Beatles (Naïve, Sessions, 2007)
Claro a aussi traduit et fait découvrir en France de grands écrivains de langue
anglaise (Pynchon, Rushdie, Danielewski, Kathy Acker, Dennis Cooper, James
Flint, etc. etc.), et il est co-directeur avec Arnaud Hofmarcher de la
collection Lot 49 aux éditions du Cherche midi.
en ligne :
Le clavier cannibale,
son blog
Fric Frac
Club
un entretien avec Delphine Heitz (Tick’art, 18 janvier
2008)
et des billets chez Babel
XXV, Tabula rasa, Dernière marge et rougelarsenrose.