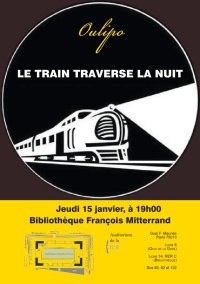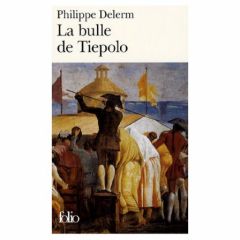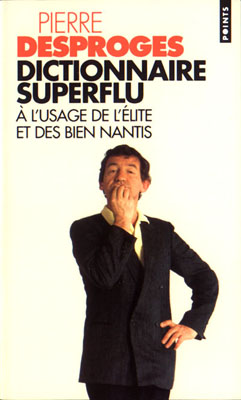Éric Chevillard m'ayant signalé une coquille dans son texte, que j'ai corrigée, je suis allée demander à Gustave ce qu'il avait écrit à Charles exactement (même pas besoin de faire tourner les tables ... merci internet) : plus de « lécitasses », mais des « délicatesses » :
À CHARLES BAUDELAIRE.
Croisset, 13 juillet 1857.
MON CHER AMI,
J'ai d'abord dévoré votre volume d'un bout à l'autre, comme une cuisinière fait d'un feuilleton, et maintenant, depuis huit jours, je le relis, vers à vers, mot à mot et, franchement, cela me plaît et m'enchante.
Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme. Vous ne ressemblez à personne (ce qui est la première de toutes les qualités).
L'originalité du style découle de la conception. La phrase est toute bourrée par l'idée, à en craquer.
J'aime votre âpreté, avec ses délicatesses de langage, qui la font valoir comme des damasquinures sur une lame fine.
Voici les pièces qui m'ont le plus frappé : le sonnet XVIII : La Beauté ; c'est pour moi une oeuvre de la plus haute valeur ; – et puis les pièces suivantes : L'idéal, La Géante (que je connaissais déjà), la pièce XXV :Avec ses vêtements ondoyants et nacrés.
Une charogne, le Chat (p 79), Le beau navire, À une dame créole, Le Spleen (p 140), qui m'a navré, tant c'est juste de couleur ! Ah ! vous comprenez l'embêtement de l'existence, vous ! Vous pouvez vous vanter de cela, sans orgueil. Je m'arrête dans mon énumération, car j'aurais l'air de copier la table de votre volume. Il faut que je vous dise pourtant que je raffole de la pièce LXXV, Tristesses de la lune : ...
Qui d'une main distraite et légère caresse
Avant de s'endormir, le contour de ses seins...et j'admire profondément le Voyage à Cythère, etc. , etc.
Quant aux critiques, je ne vous en fais aucune, parce que je ne suis pas sûr de les penser moi-même, dans un quart d'heure. J'ai, en un mot, peur de dire des inepties, dont j'aurais un remords immédiat. Quand je vous reverrai cet hiver, à Paris, je vous poserai seulement, sous forme dubitative et modeste, quelques questions.
En résumé, ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est que l'Art y prédomine. Et puis vous chantez la chair sans l'aimer, d'une façon triste et détachée qui m'est sympathique. Vous êtes résistant comme le marbre et pénétrant comme un brouillard d'Angleterre.
Encore une fois, mille remerciements du cadeau ; je vous serre la main très fort.
À vous.
GUSTAVE FLAUBERT