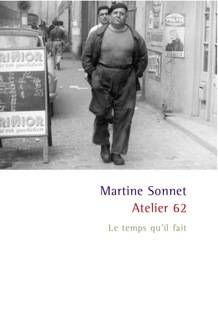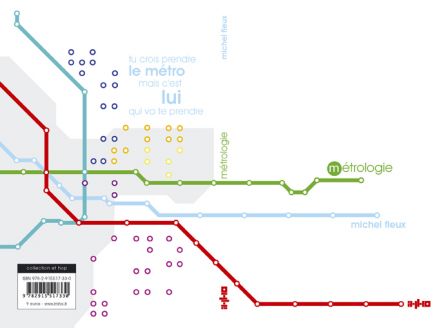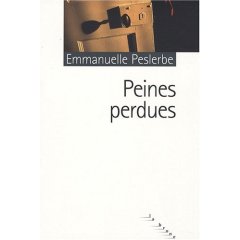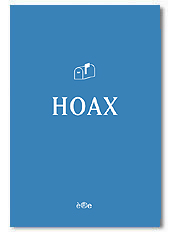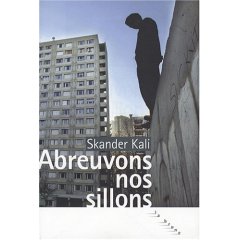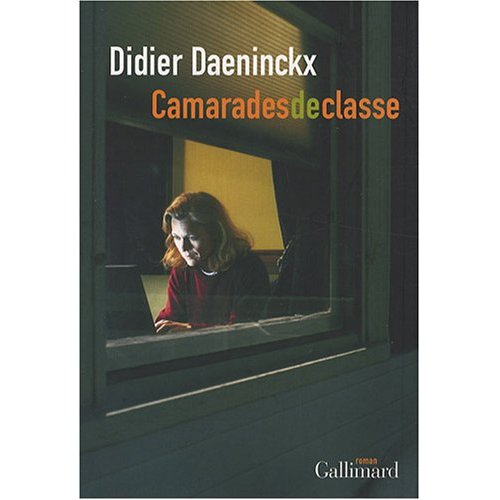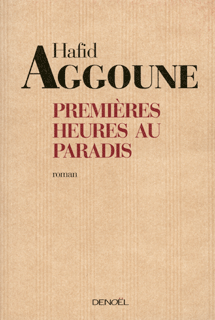Pénétrant dans le réseau métropolitain, l’usager se voit allouer la même
capacité démultipliée par le nombre d'intersections, de retours et de
changements possibles, explosion combinatoire qui met à sa disposition selon sa
gouverne propre des millions de parcours aux milliers de sorties. Possibilité
infinie d'un objet à capacité limitée. Cela dans le cas extrême d'un voyageur
insouciant au parcours irrégulier ; l'exemple est rare (s'est-il jamais vu
?). De façon générale, négligeant ces virtualités, nous nous limitons à
quelques trajets précis reliant deux ou trois sorties. (p. 27)
Ce faisant, nous rejetons les cheminements incertains, les trajets
inattendus, les rencontres hasardeuses ; la rue en tant que lieu où tout
naît, passe, circule, s’échange, se transforme et meurt dans la rencontre,
l'indéterminé et l'aléatoire, ou tout peut advenir, lieu de l'imprévu et de
l'invention, il faut dire l'histoire, il faut dire le temps. Que le métro
refoule, n'en conservant que la répétition : à l’état pur. (p. 37)
Tenons-nous devant le portillon et observons les impétrants.
Une femme arrive de la surface et caresse l’excroissance brillante du gardien
métallique. La main est rigide, sans douceur. Ça ressemble à une passe
automatique, triste, dans l’indifférence énervée de celle qui caresse,
attendant juste le râle du monstre, qu’il jouisse, vite ! Ça y est, il
jouit, un orgasme silencieux suivi du relâchement des muscles, la grille
s’ouvre, par où elle s’introduit rapidement, avant qu’il se ressaisisse. Les
grilles se referment. C’est ça, l’accès, cette caresse froide et machinale
?
Et cet homme pressé, qui frotte tout bonnement son sac, son sac !, sur
la vitre opaque, allez, gicle !, et cette ménagère au pas las posant simplement
son cabas sur l’excroissance, qu’il jouisse, vite, qu’il jouisse, la journée
n’est pas finie, encore mieux, ce lycéen qui se contente d'exhiber son cartable
face à la machine comme un trophée, jouis, vite, grouille !, et tous ces
humains qui quémandent le passage en montrant seulement d'un regard courroucé
leur sac dans le même geste arrogant, comme une preuve certaine, que font-ils
donc ? Approche-toi encore, colle tes oreilles aux lèvres des élus ?
Ils disent à la bête :
Je suis là.
OK, c'est fini, je ne me cache plus, je suis ici, ça y est, je me rends. OK. Je
clique. Je tape mon code, je valide. je pose ma main, je montre mon œil. Me
voici. Mon empreinte digitale, mon pouce, ma paume, ma sueur, mon iris, mon
regard, mon haleine, ma voix, mon ADN. Mon corps livré. Et encore. Ils disent
:
Tu le sens, mon Navigo ? (p. 48-49)
Michel Fieux, Métrologie. Travaux préparatoires à une physique des interfaces, 1/3
(IMHO, Et Hop, 2008)
Ce très beau petit livre (avec des images parmi les mots et une mise en page
travaillée (pourquoi pas une version électronique ou un site qui prolongerait
les lignes et ajouterait des couleurs ?)) met des mots très justes sur les
raisons qui font que je n’aime pas le métro et dresse avec exactitude la carte
de ces transports fluides dont nos vies sont prisonnières.
Michel Fieux est né en 1958 dans le Gers, il est développeur
(« partiellement », dit-il) indépendant, spécialisé dans la conception
d’intranets. Ce premier livre est publié dans la toute nouvelle collection
« Et Hop », dirigée par Éric
Arlix.