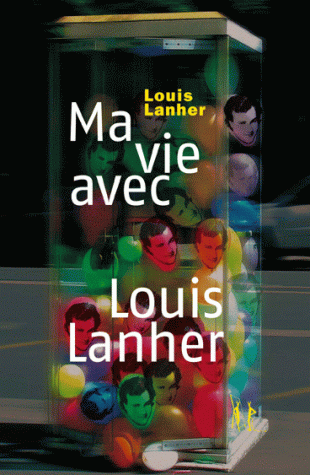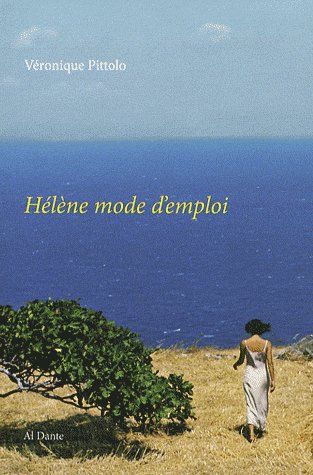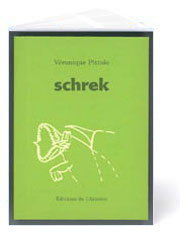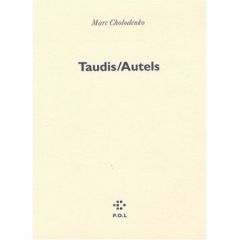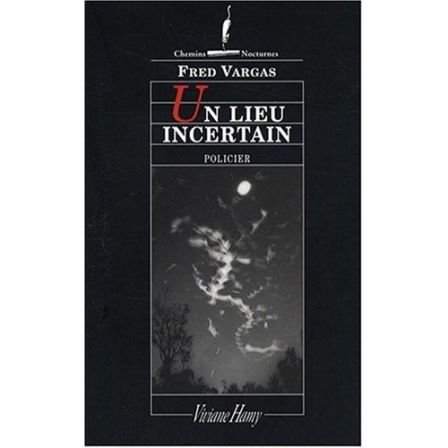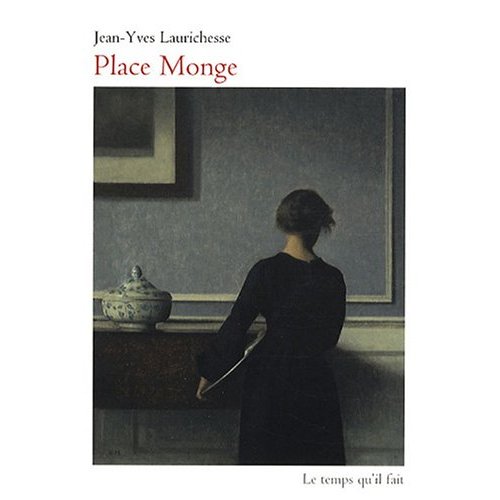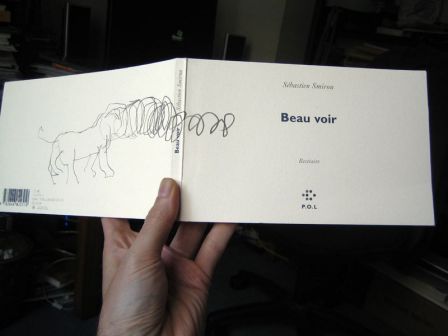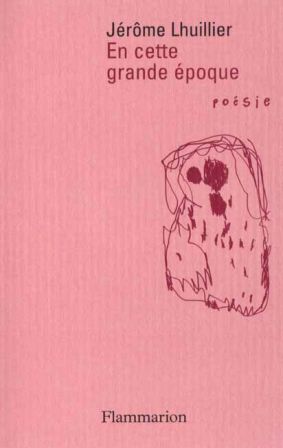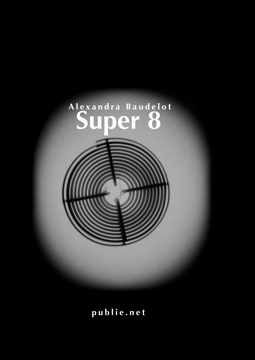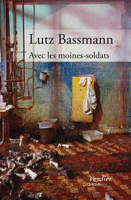Bien que toujours désireuse de modifier le cours de l’histoire,
l’Organisation avait renoncé à ses références anciennes. Elle savait que
l’humanité était fichue et elle ne nourrissait plus l’espoir de voir naître sur
terre une société prolétarienne juste et fraternelle. Elle souhaitait sauver en
urgence le peu qui restait encore à sauver, et, comme les outils utopiques du
passé se révélaient inopérants et même absurdes, elle fondait à présent sa
stratégie sur des forces obscures qu’autrefois elle avait dénoncées comme
surgies d’esprits arriérés ou typiques des régressions féodales : les
rêves, les imprécations schizophrènes, les transes chamaniques, le fakirisme.
Outre les bureaucrates maniaques de toujours, en haut de la hiérarchie, on
trouvait désormais des spécialistes de la métempsycose et des moines. Brown
avait le sens de la discipline et il leur obéissait, mais il regrettait les
temps mythiques, quand l’Organisation prônait la révolution mondiale ou, à
défaut, les assassinats de responsables et de criminels, et que les agents se
rendaient dans des lieux exotiques pour cribler de balles tel ou tel ignoble
individu ou détruire telle ou telle insupportable cible. Comme moi il
regrettait fortement ce temps-là. Atteint par un noir scepticisme, il ne voyait
pas dans sa propre activité une manière efficace de repousser l’extinction du
genre humain, ou du moins de préparer ce qu’il y aurait après l’avenir. Il
s'adaptait, il avait été entraîné pour s'adapter à n'importe quelle situation,
mais son enthousiasme militant était maintenant gangrené, pour ne pas dire
proche du zéro. Il ne comprenait plus ce qu'il faisait sur terre. Il sentait la
fin rôder, la sienne comme celle des autres. À maintes reprises, il avait
envisagé le suicide, mais, par fatalisme, il ne retournait pas contre lui son
arme de service et il continuait à accepter des missions, à voyager, à écouter
les élucubrations de ses chefs. Et, pour finir, sans excitation et sans joie,
il allait trouver les agents locaux qu'on lui désignait et il suivait à la
lettre leurs instructions délirantes. (« Crise au Tong Fong Hôtel », p.
54-55)
- Dans mon rêve, on ne voyait pas nettement si c’était une petite fille, dit
Cuzco.
Brown se racla la gorge.
- Je pense que c'était tout comme, dit-il.
- Dans mon rêve, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une araignée étrange,
dit Cuzco. Elle venait d'un au-delà inimaginable. Elle avait très peur.
Brown hocha la tête. Le jour éclairait l'océan. Il allait pleuvoir. Les vagues
étaient magnifiques, sans régularité elles venaient se briser à leurs pieds,
remuant des morceaux de tôle, des galets, des fragments de matière plastique,
du mazout. Elles étaient principalement vert foncé et gris.
C'est bien que vous l'ayez rassurée avec cette couverture, poursuivit
Cuzco.
- Je ne l'ai pas rassurée, dit Brown. Elle n'avait pas besoin de mon aide. Elle
a fait demi-tour et elle est retournée brûler au fond du Tong Fong Hotel.
Et certainement beaucoup plus loin encore, fit Cuzco.
- J'ignore toujours ce qu'il était prévu que j'accomplisse, quel acte précis,
avoua Brown.
- Peut-être qu'elle vous a vu pleurer, dit Cuzco.
- J'ai pleuré ? dit Brown.
Boïan Cuzco haussa ses épaules invraisemblables. Il y eut une pause dans le
bruit des vagues, puis le silence se brisa. Des crabes avaient été projetés sur
le rivage et, pour leur malheur, ils avaient atterri dans une flaque où
dominaient des composés goudronneux. Ils rampèrent un moment puis
s'immobilisèrent. Ils étaient petits, ils n'étaient pas de taille pour lutter
contre la glu. L'un d'eux s'agitait, le ventre à l'air, comme désireux de
prolonger malgré tout son semblant d'existence, ses inutiles souffrances, ou
peut-être ne s'apercevant même pas qu'il était en train de mourir.
- J'ai failli l'appeler, reprit Brown. Je me tenais comme un idiot en face de
l'espace noir, les yeux me piquaient. Je n'arrivais pas à respirer. Je ne
savais pas si ma mission se terminait là ou non. j'ai failli l'appeler, mais je
me suis ravisé. C'était trop absurde.
- Dans mon rêve, vous lui donniez un nom d'épave, dit Cuzco.
Il se leva. Brown ne l'avait encore jamais vu déplié et il le trouva grand,
bien que doté d'une charpente en désordre qui le forçait à se voûter. Il marcha
jusqu'à la flaque de goudron et secoua sa tête de cormoran. Il examinait les
bêtes qui agonisaient à ses pieds.
Brown le rejoignit. Les crabes avaient recommencé à se débattre. Parfois ils se
heurtaient d'un revers de pince. Le goudron ralentissait leurs gestes les plus
élémentaires.
- Ils sont condamnés, dit Brown.
- Condamnés à quoi, dit Cuzco.
Ils étaient là, tous les deux, inclinés au-dessus des agonisants.
Ils étaient là, tous les deux, en pleine lumière crépusculaire d'avant la
pluie.
Ils étaient là, tous les deux, et ils ne disaient plus rien de mémorable.
Dialogue sur la plage
Le pneu avait atterri sur la plage, finalement, il avait été rejeté au sec,
entre les crabes mazoutés et le chicot de ciment qui jadis avait été un
escalier ou un début de ponton. Il était abîmé à plusieurs endroits et on
voyait ses entrailles courbes, ses intérieurs où un peu d'eau de mer encore
brillait. Brown le regarda avec attention pendant un quart d'heure, puis il se
tourna vers Cuzco.
- Parfois je me demande si nous servons à quelque chose, dit-il.
Cuzco, cette fois-ci, n'avait pas son cahier sur lui ou près de lui. Peut-être
avait-il abandonné son projet d'écriture, peut-être avait-il égaré son stylo et
décidé de remettre à plus tard sa rédaction. Il avait un air halluciné, un air
d'oiseau marin halluciné, avec les joues couvertes de rayures, et des yeux
soudain rétrécis et sans paupières, qui lançaient des éclairs d'or.
- Qui ça, nous ? demanda-t-il.
- Vous et moi, l'Organisation, précisa Brown.
- Vous savez, Brown, dit Cuzco, en ce moment, une époque où l'humanité finit de
mourir, je ne vois pas ...
- Vous ne voyez pas quoi, Cuzco ? insista Brown, d'une voix forte, comme
s'il était en train de procéder à un interrogatoire.
- Servir à quelque chose, dit Cuzco avec une grimace, comme s'il lui déplaisait
profondément de parler. Je ne vois pas pourquoi vous posez comme ça le
problème. Les humains vivent leurs dernières années. Nous sommes là, avec eux,
voilà tout.
Brown reprit l'examen du pneu. La marée haute l'avait mis à l'abri des vagues,
mais il retournerait peut-être en mer quand celles-ci reviendraient le lécher
et le bousculer. Il allait peut-être aller et venir ainsi pendant quelques
jours, quelques semaines, entre terre et océan, avant d'échouer définitivement
quelque part, sur la décharge ou ensablé dans un haut-fond. Il était lacéré et
sale.
- Et puis, fit Brown, il y a aussi que je me demande où nous nous situons, au
bout du compte, sur l'échelle animale ou même humaine.
- En dessous de quoi nous nous situons ? dit Cuzco.
- Oui, ricana tristement Brown. Je me demande.
- Là est le problème, dit Cuzco. Cette fois, vous le posez bien, Brown. En
dessous de quoi. (« Crise au Tong Fong Hôtel », p. 77-81)
Lutz Bassmann, Avec les
moines-soldats (Verdier, Chaoïd, 2008)
Très beau moment romanesque que la rencontre du troisième type avec la
petite-fille-araignée terrorisée surgie des flammes d' « après
l'avenir » dans les deux « entrevoûtes » en miroir, les deuxième
et sixième « novelles », qui portent le même titre, « Crise au Tong
Fong Hôtel », et racontent la même histoire, mais pas tout à fait sous le même
angle de fuite.
post-scriptum : ainsi qu'un long entretien d’Antoine Volodine avec le
même Jean-Didier Wagneur, initalement publié dans Écritures contemporaines
8 : « Antoine Volodine – fictions du politique ». Textes réunis
et présentés par Anne Roche et Dominique Viart (Lettres Modernes Minard, 2006).
Repris sur le site Verdier : « On recommence depuis
le début », suite et
fin