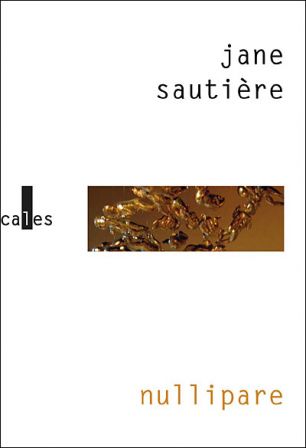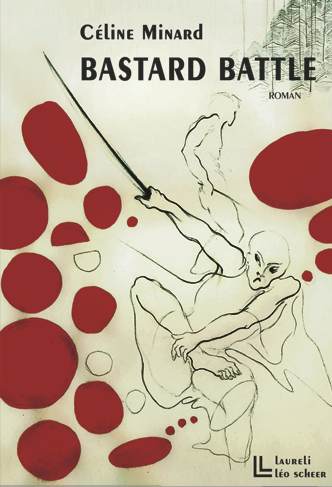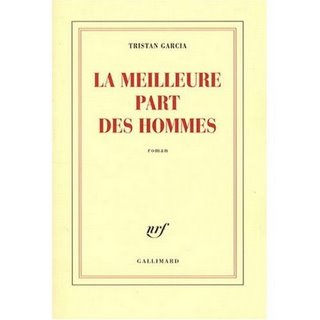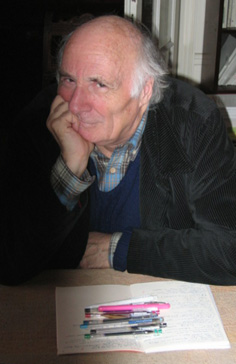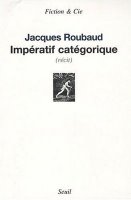Ils se donnent rendez-vous au sortir du virage, après Malmousque, quand la
corniche réapparaît au-dessus du littoral, voie rapide frayée entre terre et
mer, lisière d’asphalte. Longue et mince, elle épouse la côte tout autant
qu’elle contient la ville, en ceinture les excès, congestionnée aux heures de
pointe, fluide la nuit – et lumineuse alors, son tracé fluorescent sinue dans
les focales des satellites placés en orbite dans la stratosphère. Elle joue
comme un seuil magnétique à la marge du continent, zone de contact et non
frontière, puisqu’on la sait poreuse, percée de passages et d’escaliers qui
montent vers les vieux quartiers, ou descendent sur les rochers. La
dévisageant, on pense à un front déployé que la vie affecte de tous côtés, une
ligne de fuite, planétaire, sans extrémités : on y est toujours au milieu
de quelque chose, en plein dedans. C’est là que ça se passe et c’est là que
nous sommes. Un panneau d’affichage leur sert de repère : derrière le
poteau, le parapet révèle une ouverture sur un palier de terre sablonneuse semé
de chardons à guêpes et de gros taillis inflammables, lesquels s’écartent à
leur tour pour former des passages vers les rochers. On sait qu’ils vont venir
quand le printemps est mûr, tendu, juin donc, juin cru et aérien, pas encore
les vacances mais le collège qui s’efface, progressivement surexposé à la
lumière, et l’après-midi qui dure, dure, qui mange le soir, propulse tout droit
au cœur de la nuit noire. Chaque jour il y en a. Les premiers apparaissent aux
heures creuses de l’après-midi, puis c’est le gros de la troupe, après la fin
des cours. Ils surgissent par trois, par quatre, par petits groupes, bientôt
sont une vingtaine qui soudain forment bande, occupent un périmètre, quelques
rochers, un bout de rivage, et viennent prendre leur place parmi les autres
bandes établies çà et là sur toute la corniche. (p. 11)
Les petits cons de la corniche. La bande. On ne sait les nommer autrement.
Leur corps est incisif, leur âge dilaté entre treize et dix-sept, et c’est un
seul et même âge, celui de la conquête : on détourne la joue du baiser
maternel, on crache dans la soupe, on déserte la maison.
Nul ne sait comment cette plate-forme ingrate, nue, une paume, est devenue leur
carrefour, le point magique d'où ils rassemblent et énoncent le monde, ni
comment ils l'ont trouvée, élue entre toutes et s'en sont rendus maîtres ;
et nul ne sait pourquoi ils y reviennent chaque jour, y dégringolent,
haletants, crasseux et assoiffés, l'exubérance de la jeunesse excédant chacun
de leurs gestes, y déboulent comme si chassés de partout, refoulés, blessés, la
dernière connerie trophée en travers de la gueule ; mais aussi, ça ne veut
pas de nous tout ça déclament-ils en tournant sur eux-mêmes, bras tendu main
ouverte de sorte qu'ils désignent la grosse ville qui turbine, la cité maritime
qui brasse et prolifère, ça ne veut pas de nous, ils forcent la scène, hâbleurs
et rigolards, enfin se déshabillent, soudain lents et pudiques, dressent leur
camp de base, et alors ils s'arrogent tout l'espace. (p. 14-15)
Il saute comme un ange malingre - comme si la gravitation terrestre était un
frayage, comme si le ciel dissimulait des lignes de fuite qu'il fallait saisir
tels les pompons du manège (p. 80)
Ils ont longé la corniche jusqu'aux plages du Prado avant de bifurquer vers
le nord, Mario est assis à l'avant sur le fauteuil passager, la ceinture de
sécurité lui cisaille la gorge, il fume une Lucky sans tousser, a tourné tous
les boutons du tableau de bord, je peux mettre la radio ? La ville est
pleine et chaude encore, à cette heure, le trafic est dense derrière le port,
les trottoirs essorent une population épuisée qui ne veut pourtant pas se
coucher : touristes étrangers, estivants en goguette - faut profiter -,
pickpockets, familles qui traînent aux terrasses des pizzerias, grand-mères en
jeans cloutés et nourrissons endormis dans les poussettes, première vague de
noctambules, adolescents en grand appareil. Mais bientôt ce ne sont plus que de
grandes avenues frangées d'arbres fluorescents qui ne ventilent plus rien,
parcourues de bagnoles nerveuses, pleines à ras bord, vitres baissées musique à
fond, on approche des cités, les lumières sont blanches, les gens pendus aux
fenêtres fument dans l'air nocturne et l'écho des télévisions, des jeunes sont
regroupés au bas des immeubles ou traversent les immenses dalles de béton
bleutées, leurs voix résonnent sur l'esplanade lunaire, on leur crie de se
taire, ils brandissent un doigt, il flotte dans l'atmosphère une odeur de
joint, de plastique tiède, de vieilles épluchures et de papier journal. (p.
121)
Maylis de Kerangal, Corniche
Kennedy (Verticales, 2008)
Des minots qui jouent à défier les lois (celles de la gravitation et celles
de la société), un commissaire sommé d’appliquer une tolérance zéro qui les
envie secrètement, « la Plate », la corniche et Marseille comme scènes
d’un ballet en lignes de fuite, et surtout une écriture lente et ciselée,
magnifique.