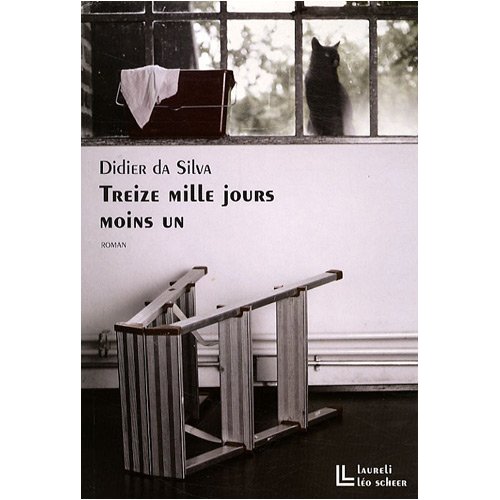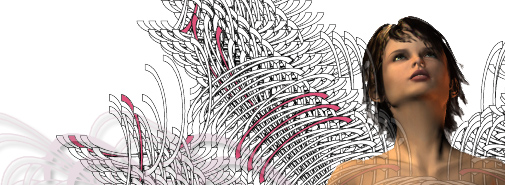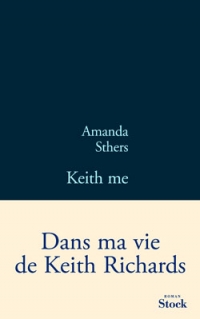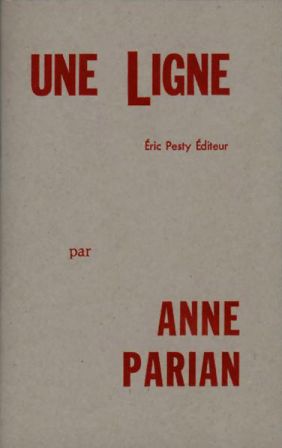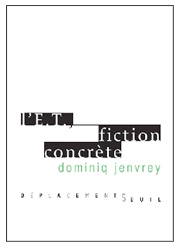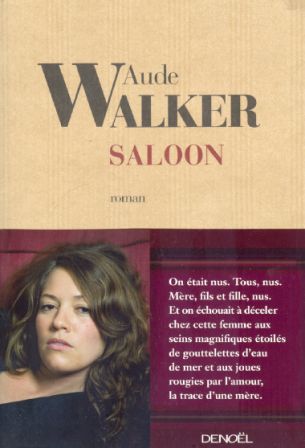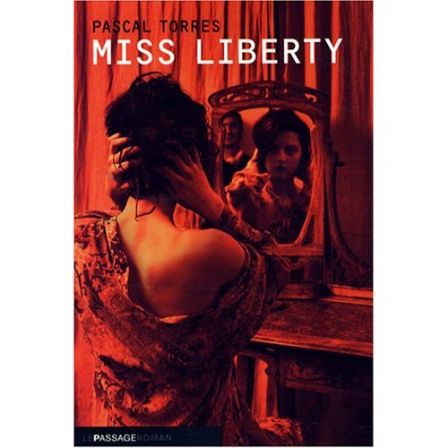Nous avons cinq pauses par jour, et nous avons une nuit.
Ces moments sont les champs de bataille temporels de notre guerre.
De 5 heures à 8 heures, nous travaillons.
De 8h15 à 11h15, nous travaillons.
De 11h30 à 14h30, nous travaillons à nouveau.
De 14h45 à 17h45 nous travaillons encore.
De 18h45 à 21h00, nous continuons de travailler.
Et de 21h15 à 00h15 nous travaillons enfin.
Un dehors de ces horaires, nous sommes libres et luttons pour tenter de le
rester.
Notre bureau, c'est notre vie.
Personne aujourd'hui ne se souvient du temps où les hommes n'habitaient pas
leur lieu de travail, pas plus que des siècles profonds où le travail consista
en une activité quelconque.
Ce que nous savons, c'est que les jours morts aujourd'hui s'étirent sans qu'il
y ait rien d'autre à faire que porter de l'eau à ébullition, la boire, tuer et
éviter de se faire tuer.
C’est ce monde que nos prédécesseurs nous ont laissé, probablement parce
qu'eux-mêmes en avaient hérité.
Ces box sont nos demeures, cette moquette notre terre, ces collègues nos
concitoyens, et malheur à celui qui renonce à ces quelques droits fondamentaux,
car pour un tel homme, il ne reste plus que la rue, et même si aucun d'entre
nous n'y a jamais mis les pieds, nous savons qu'aussi rude soit notre
condition, aussi pénible notre existence, il n'y a rien de pire que la rue. (p.
6)
L'histoire du travail est la première histoire qu'un travaillant connaît
quand il devient travaillant.
C'est l'histoire première, celle qui lui apprend qui il est, et pourquoi il est
là.
Dans cette histoire qui remonte aussi loin que le travail lui-même, il est dit
qu'il n'exista pas d'époque où le travail ne fut pas la seule et unique raison
d'être en vie. Le travail, et le combat pour le conserver.
Lorsque sortis de la nurserie, survivants incrédules au deuxième mois de notre
existence d'adultes, nous avons commencé à poser des questions à nos collèges,
toujours avons entendu les mêmes réponses, et toujours cette même histoire,
afin qu'à notre tour, bien plus tard, toujours n'avons pu que les répéter aux
remplaçants qui nous questionnèrent.
Il faut travailler car notre travail est notre dignité, l'unique chose qui
permette de nous différencier des sauvages que la rue a dévorés et dont la vie
n'est pas même utile à elle-même, électrons impassibles jetés sur l'orbite
chaotique de leur propre inconsistance.
Le travail est une foi, une évidence ultime qui nous rend humain et qui répond
à la seule question que nous aurions pu nous poser : pourquoi ?
Le travail est cette réponse, et cette réponse porte en elle le bulbe amorphe
du reste : si jamais nous cessions de travailler, que resterait-il à
faire ?
Dès que les premiers rayons du soleil changent l'obscure épaisseur nuageuse
en masse côtoneuse striée de pluie noire, nous nous postons devant nos écrans
afin de suivre l'évolution de l'impensable réseau de machines qui gère notre
monde. Disposés sur 80 lignes, 106 colonnes et 32 niveaux de netteté, les lots
de données défilent à rythme variable, en fonction de leur importance ou de
leur urgence. Nos yeux halaient l'information brute que les nurses nous ont
appris à décoder à l'aube de notre vie, dans les quatre sens, du haut vers le
bas, du bas vers le haut, de gauche à droite et de droite à gauche selon un
maillage que chacun s'amuse à personnaliser.
Nous surveillons les flux de capitaux.
Nous surveillons le cours des actions.
Nous surveillons la valeur des indices, les rapports de fonctionnement. les
bilans trimestriels, les fusions et acquisitions, les krach, les embellies, les
naissances et les morts, enchevêtrement fluide de chiffres et de mots qui
passent devant nos yeux comme une vivace nature en perpétuelle
accélération.
Chacun joue un rôle, le même, et ce rôle est garant du bon fonctionnement du
monde.
Le travaillant surveille. Et cette surveillance lui permet de continuer à
travailler.
Lors de nos premières heures de travail, si la fortune nous a permis de
rencontrer un collègue, et que ce collègue est assez amical pour nous répondre,
nous ne manquons pas de demander la marche à suivre en cas de problème. Que
faire si une anomalie est détectée, si un système est déréglé, ou si une erreur
est commise.
Le collègue amical apporte alors la réponse que tous les travaillants
connaissent :
il n'y a jamais d'erreur dans le système.
Nous ne travaillons pas pour surveiller. Nous surveillons pour
travailler.
Car sans travail, nous serions laids et sauvages, inutiles et indignes.
C'est ce que nous raconte l'histoire première, et chaque jour nous confirme
son exceptionnelle pertinence. (p. 17-18)